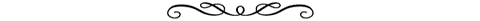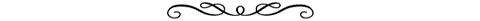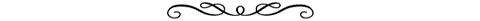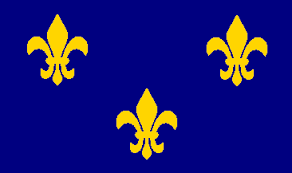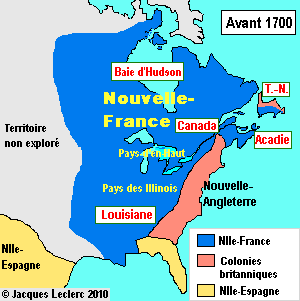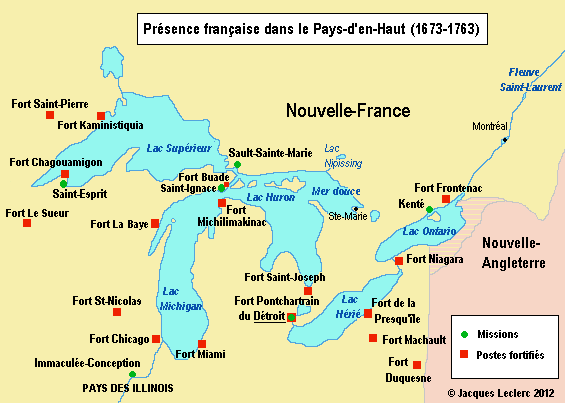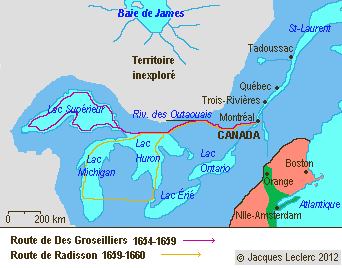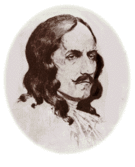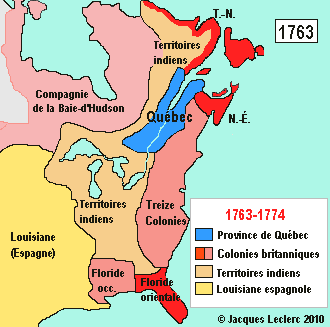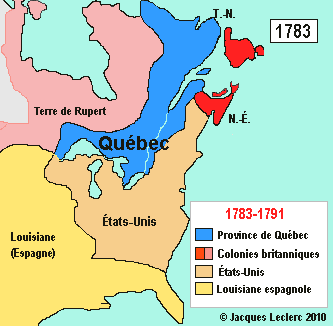Histoire de la
Nouvelle-France
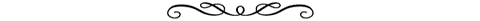
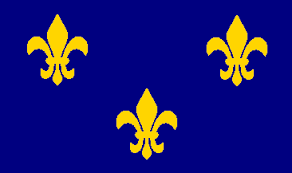 |
Le
Pays-d'en-Haut
(Région des Grands
Lacs)
(1604-1763)
|
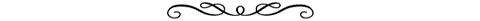
|
Avis: cette
page a été révisée par Lionel Jean, linguiste-grammairien. |
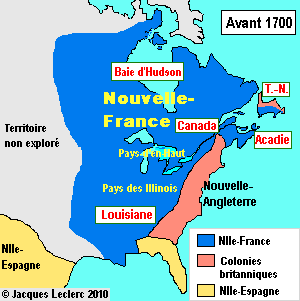 |
Avant le traité d'Utrecht de
1713, la Nouvelle-France
comprenait cinq colonies: le Canada
(incluant le «Pays d'en-Haut» ou région des Grands Lacs), l'Acadie
(aujourd'hui la Nouvelle-Écosse), la
mer du Nord (aujourd'hui la Baie
d'Hudson), Terre-Neuve (que la
France partageait avec la Grande-Bretagne sous le nom de
Plaisance) et la
Louisiane (voir
la carte agrandie de la Nouvelle-France avant 1713). Si le «Pays-d'en-Haut»
faisait partie du Canada, le «Pays
des Illinois» était rattaché à la Louisiane.
Après le traité d'Utrecht,
la Nouvelle-France a vu son territoire réduit, qui comprenait alors
le Canada, l'Acadie continentale (aujourd'hui le
Nouveau-Brunswick), l'Île-Royale (le Cap-Breton et l'île
Saint-Jean, aujourd'hui l'île du Prince-Édouard) ainsi que la
Louisiane. La Nouvelle-France avait perdu Terre-Neuve
(Plaisance), l'Acadie péninsulaire et la Baie d'Hudson.
En principe, chacune des
colonies était gérée par un gouverneur local et possédait sa propre
administration. Les colonies de l'Amérique française étaient en même
temps supervisées par un gouverneur général résidant à Québec ainsi
que par le roi et ses ministres à Versailles. |
Le Pays-d'en-Haut
relevait de l'administration directe du gouverneur général de la
Nouvelle-France, qui de toute
façon avait également autorité pour intervenir dans les affaires des autres
colonies de l'Amérique du Nord (Plaisance, Acadie, Louisiane). Aujourd'hui, même si le «pays
d'en haut» ne correspond pas à une région donnée du Québec, l'Office
québécois de la langue française recommande d'écrire l'appellation avec des
majuscules à «pays» et à «haut» ainsi qu'avec des traits d'union:
Pays-d'en-Haut.
L'expression
«pays-d'en-haut» semble être d'origine populaire, mais elle fut employée
relativement très tôt en Nouvelle-France. Non seulement le
comte de Frontenac, gouverneur
de la Nouvelle-France, l'employait, mais également le roi
Louis XIV. Au
début de la colonisation, le mot «haut» et l'expression «pays d'en haut» se
rapportaient à toute la région au nord du Saint-Laurent et «à l'ouest de
Montréal jusqu'à l'Ontario» (lac Ontario), ce qui correspondait à tout ce qu'il y avait
«en haut» des rapides de Lachine. Il semble que ce soit les jésuites qui, en
1658, aient fait ainsi référence à la région par les expressions «païs
superieurs» et «Algonquins des païs plus hauts», puis en 1668 en parlant des
«Missions d'en haut» et des «Sauvages d'en haut». À partir des années 1680,
l'usage était établi ainsi : «icy hault», «forts d'en hault», «le pais d'en
haut», «les Pays d'en Haut» ou «le Pays d'en haut», «la colonie d'en haut», etc. En
Nouvelle-France, on pouvait aussi employer le terme «l'Ouest» pour désigner
la région des Grands Lacs. Cette appellation de
«Pays-d'en-Haut» fut employée durant tout le Régime français,
c'est-à-dire de 1604 à 1763, date de la signature du traité de Paris qui
cédait la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.
À la fin du
XVIIe
siècle, l'expression connue comme le «Pays d'en haut» caractérisait tout le territoire de traite des fourrures
situé généralement autour de la région des Grands
Lacs (1699). Dans Mémoire sur les plans des seigneuries et
habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et Montréal, qui
donne des indications sur la faune et la flore (1712), Gédéon de
Catalogne (1662-1729), arpenteur, cartographe, seigneur et officier
français, écrivit ce qui suit:
|
Le
commerce de cette place estoit autre fois très avantageux
pas le grand nombre de sauvages qui y descendoient des
pays d'en haut
avec des
canots chargez de pelleteries, mais de puis que les congez
que Sa Ma[ges]té avoit accordez à la Colonie ont esté
suprimez, presque toutes ces nations vont porter leurs
pelleteries aux establissements Anglois [...]. |
Autour de 1750, les
frontières du «Pays-d'en-Haut» reculèrent plus loin vers l'ouest et le nord,
en suivant le rayon d'action de la traite des fourrures. L'emploi de
l'expression avait pris des connotations liées à la liberté, au commerce,
aux «Sauvages» et à l'expansion territoriale.
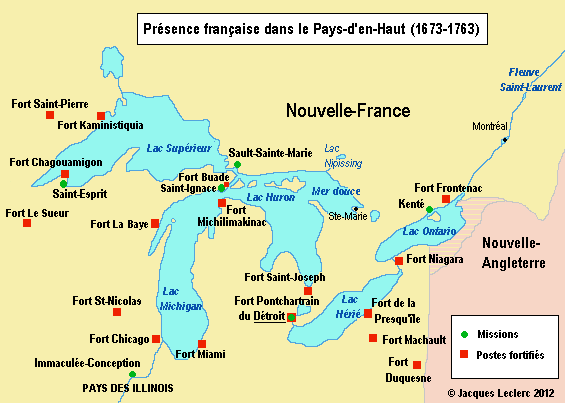 |
Dans les faits, le «Pays-d'en-Haut»
se trouvait aux confins de la Nouvelle-France, dans l'Ouest. Le territoire
du «Pays-d'en-Haut» comprendrait aujourd'hui la province de l'Ontario, ainsi que, en
totalité ou en partie, les États américains du Minnesota, du
Wisconsin, de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, de l'Ohio, de
la Pennsylvanie et de New York (voir
la carte actuelle).
En réalité, comme les frontières n'étaient pas fixées à
l'ouest, la région comprendrait aussi bien les provinces actuelles de
l'Alberta et de la Saskatchewan.
Le premier Européen à
s'aventurer dans le Pays-d'en-Haut fut Étienne Brûlé, un
Français qui explora une partie de la région de la baie
Géorgienne de 1610 à 1612. En 1613, Samuel de Champlain
entreprit l'exploration de la rivière des Outaouais et du lac
Nipissing. |
Dans un second voyage
(1615-1616), Champlain atteignit le lac Ontario et le lac Huron; il explora
aussi la baie Géorgienne que les Hurons appelaient le «lac d'Attigouatan»,
en dressa les premières cartes et lui donna le nom de «Mer douce»; en 1822,
la Royal Navy allait changer le nom de «Mer douce» en "Georgian Bay" en
l'honneur du roi George IV (1762-1830). Champlain renouvela son pacte avec
ses alliés amérindiens, notamment les Algonquins et les Hurons. Après
Champlain, plusieurs autres explorateurs français menèrent des expéditions
plus ou moins officielles. Ainsi, en 1626, un missionnaire récollet, le père
Joseph de la Roche Daillon (décédé en 1656), se rendit chez les Neutres qui
habitaient sur les bords du lac Érié; il y passa quelques mois à étudier la
langue des habitants et à les catéchiser.
2.1
Les autochtones
Cette vaste région des
Grands Lacs était habitée par un grand nombre de nations amérindiennes.
D'est en ouest vivaient trois grandes familles: d'abord les Iroquois, puis
les Algonquiens et ensuite les peuples sioux.
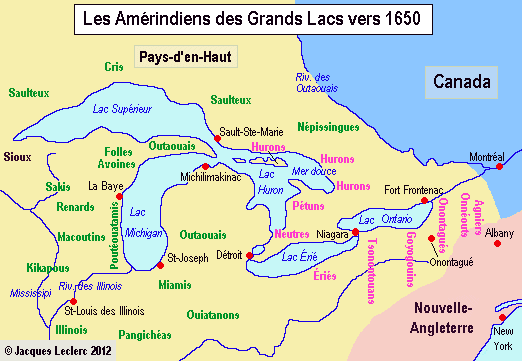 |
Au temps de la
Nouvelle-France, les Iroquois (voir
le texte) étaient alors réunis en une confédération de
cinq nations (d'où les Cinq-Nations): d'est en ouest les
Agniers (angl. Mohawks), les Onneiouts (angl.
Onéidas), les Onontagués (angl. Onondagas),
les Goyogouins (angl. Cayugas) et les
Tsonnontouans (angl. Senecas), cette dernière nation
étant aussi populeuse que les quatre autres réunies. La
«capitale» de l'Iroquoisie était Onontagué, située au sud du lac
Ontario.
Il existait d'autres
peuples iroquoiens
(en rose sur la carte) : les
Hurons (auj. Wandats) au nord du lac Huron, les
Pétuns (angl. Tobaccos), les Neutres (angl.
Neutrals) au sud du même lac et les Ériés (angl.
Cats Nation). Après avoir procédé à des pillages, les
Iroquois dispersèrent les Hurons (1649), les Pétuns (1649), les
Neutres (1651) et les Ériés (1653). |
Parmi les
peuples de la
famille algonquienne (en vert
sur la carte), il y avait au nord du lac Huron et du lac
Supérieur les Népissingues (angl.
Nipissing),
les Saulteux ou Ojibwés (angl. Ojibwa) et
les Cris (angl. Cree); au sud du lac Supérieur,
les Folles-Avoines (angl. Menominee), les
Outaouais (angl. Ottawa), les Sakis (angl.
Saki), les Renards (angl. Fox); autour du lac
Michigan, les Macoutins (angl. Macoutens), les
Miamis (angl. Miami), les Kikapous (angl.
Kickapoo),
etc. Les Français furent les premiers Européens à rencontrer les
Sioux, un peuple de la
famille siouane
(en noir sur la carte), qui résidait à l'ouest du lac
Supérieur, une région qui correspondrait aujourd'hui aux États
du Minnesota et du Wisconsin.
Dans une carte dressée en 1755 par le cartographe Jacques-Nicolas Bellin (voir le
document), la «Partie occidentale» de l'Amérique
française était divisée en plusieurs «pays» : «pays des
Renards», «pays des Mascoutens», «pays des Illinois», «pays des
Miamis», «ancien pays des Hurons», etc. Autrement dit, selon la
tradition française de l'époque, il existait autant de «pays»
que de «nations» amérindiennes.
2.2 Les
débuts européens
Pendant plusieurs
décennies, seuls les coureurs des bois et les missionnaires français
s'aventurèrent dans le Pays-d'en-Haut. Mais, jusqu'au milieu du
XVIIe
siècle, ils furent peu nombreux. Le premier établissement d'une mission jésuite
fut fondé à Sainte-Marie-aux-Pays-des-Hurons en 1639. Plus d'une dizaine
d'années plus tard, en 1648, le petit village de Sainte-Marie (aujourd'hui
Midland) abritait 66 Français, soit le cinquième de toute la population de
Nouvelle-France. En raison des attaques régulières des Iroquois, la petite
communauté dut évacuer les lieux l'année suivante en incendiant le poste qui lui
avait servi de demeure pendant près d'une décennie. Dans son Histoire et
description générale de la Nouvelle-France (1744), le jésuite
François-Xavier de Charlevoix (1682-1761) affirme que c'est grâce à leur
attachement à la religion catholique et à l'œuvre des missionnaires que les
autochtones demeurèrent dans l'alliance franco-amérindienne. En réalité, le
Pays-d'en-Haut fut une colonie française sans peuplement européen.
Au milieu du
XVIIe
siècle, un important bouleversement survint au Canada. En 1649, les Iroquois
anéantirent les Hurons, principaux fournisseurs de fourrures en Nouvelle-France.
Le commerce des fourrures chuta de façon draconienne. Privé du revenu provenant
de la traite des fourrures, le Canada n'était plus en mesure d'assumer les
dépenses reliées à sa défense. Les Français furent dans l'obligation de trouver
d'autres sources d'approvisionnement.
2.3
Radisson et Des Groseilliers
Au même moment, les
guerres iroquoises menaçaient les Français installés dans la vallée du
Saint-Laurent. La région des «Pays-d'en-Haut» furent alors coupée du reste du
Canada à partir de la rivière des Outaouais, causant par le fait même
l'étranglement du marché des fourrures. De part et d'autre de l'Atlantique, on
évoqua la possibilité d'abandonner le Canada si rien n'était fait pour protéger
l'économie des pelleteries.
|

Des Groseilliers et Radisson |
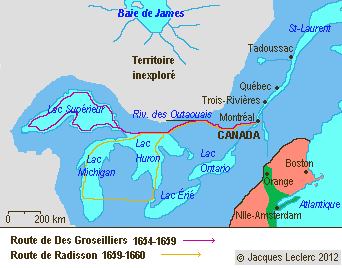 |
En août 1654, Médard Chouart des
Groseilliers (1618-1696), un
Français (né dans le
Brie) devenu coureur des bois et
interprète, partit avec des
compagnons pour explorer la région
des Grands Lacs: en passant par la
rivière des Outaouais, il se rendit
jusqu'aux lacs Huron, Érié et
Michigan. Deux ans plus tard, Des
Groseilliers et ses camarades
revinrent dans la colonie avec une
cinquantaine de canots remplis de
fourrures. Malgré l'opposition du
gouverneur
Pierre du Voyer d'Argenson
(1658-1661), Des Groseilliers
repartit en expédition au mois
d'août 1659 avec Pierre-Esprit
Radisson (v. 1636-1710), son
beau-frère, également français (né à
Paris). Leur périple les conduisit
jusqu'à l'extrémité du lac
Supérieur. |
De retour à la mi-août
1660, ils dirigèrent un convoi de canots comprenant 300 hommes et 200 000 livres
de fourrures, à la grande joie des marchands qui s'apprêtaient à retourner en
France, ruinés. Au cours de leurs voyages, les deux aventuriers avaient entendu
les Cris affirmer qu'il existait une région très riche en fourrures de castors,
située près de la mer du Nord, que les Anglais appelaient la baie d'Hudson.
Entre-temps, Radisson et Des Groseilliers avaient noué de solides alliances avec
un grand nombre de nations amérindiennes, notamment les Iroquois, les Sioux, les
Cris, les Hurons, les Outaouais, les Saulteux (Ojibwés) et les Sioux dakotas. Il
est même permis de croire que ces voyages des Français dans les territoires des
Grands Lacs avaient grandement favorisé le développement des alliances
franco-amérindiennes.
2.4 La
prise de possession officielle
 |
Le Pays-d'en-Haut sera
officiellement exploré par l'officier Simon-François
Daumont de Saint-Lusson, mandaté
par l'intendant Talon.
Le 3 septembre 1670, Jean Talon le
nomma commissaire subdélégué (un collaborateur de l'intendant) «pour
la recherche de la mine de cuivre au pays des Outaouais, Nez-Percés,
Illinois, et autres nations découvertes et à découvrir en l'Amérique
Septentrionale du côté du lac Supérieur ou mer Douce». Le 14 juin
1671, le sieur de Saint-Lusson prit possession de la région des
Grands Lacs au nom du roi de France, lors d'une cérémonie tenue à
Sault-Sainte-Marie (voir l'illustration de gauche de C.W.
Jefferys, 1895). Cette cérémonie devait marquer, aux yeux des
autres nations européennes, l'entrée de ce territoire et de ses
habitants sous la gouverne du roi de France. Dès lors, cette partie
de continent appartenait au roi de France et les 14 nations
amérindiennes étaient assujetties aux lois et coutumes de Sa
Majesté; en retour, ces nations pouvaient compter sur sa protection.
Le territoire comprenait «tous les autres pays, fleuves, lacs et
rivières contigües et adjacentes, iceux tant descouverts qu'à
descouvrir».
En principe, les Indiens
adoptaient le «Grand Onontio des Français», le roi de France, comme
leur «père». Dans le langage diplomatique, ce terme de parenté ne
sous-entendait aucun pouvoir coercitif de la part du «père» envers
ses «enfants». |
Ainsi, Nicolas Perrot (1644-1717), explorateur, diplomate
et commerçant en fourrures, déclarait en 1670 à des représentants d'une dizaine
de nations assemblées au Sault-Sainte-Marie qu'ils étaient dorénavant «sujets du
roi de France» et que celui-ci disposait des moyens nécessaires pour les forcer
à vivre en paix (propos rapportés par Bacqueville de La Potherie dans
Histoire de l'Amérique septentrionale):
|
Je prends
possession de cette terre au nom de celui que nous appellons
notre Roi, cette terre est sienne, & tous ces peuples qui
m'entendent sont ses Sujets, qu'il protegera comme ses enfans :
il veut qu'ils vivent en paix, il prendra leurs affaires en
main. Si quelques ennemis se soulevent contr'eux il les détruira
: s'ils forment entr'eux quelques differens il veut en être le
juge. |
Dans les faits, le
Pays-d'en-Haut restait avant tout un territoire contrôlé par les Amérindiens.
Cependant, en les prenant «sous leur protection», les autorités françaises
exprimaient leur volonté d'établir leur hégémonie sur ces derniers. Les Français
ne voulaient pas devenir des alliés comme les autres. L'historien français
Bacqueville de La Potherie (1663-1736) écrira à ce sujet, dans son Histoire
de l'Amérique septentrionale (1722), que les premiers Français à s'être
rendus dans la région du Pays-d'en-Haut étaient considérés comme des «Esprits»
ou des «Dieux» par les autochtones, qui «admiroient tout ce que les François
leur apportoient [...], les couteaux, les haches, le fer surtout [...], les
fusils». Il suffisait à une nation de posséder des fusils français pour se
croire à l'abri de ses ennemis et, de cette façon, les Français devenaient les
médiateurs de tous les différends indiens. Dans un Mémoire de 1671,
l'intendant Talon rendait ainsi
compte au roi d'une assemblée tenue la même année par Nicolas Perrot à
Sault-Sainte-Marie:
|
Elles
[nations] connaissent déjà que le nom du Roy est si répandu dans
touttes ces contrées parmy les Sauvages que seul il y est
regardé comme l'arbitre de la paix et de la guerre, touttes se
destachent insensiblement des autres Europëens, et à l'exception
des Irroquois, dont je ne suis pas encore asseuré, on peut
presque se promettre de faire prendre les armes aux autres quand
on le désirera. |
En 1671, Louis Jolliet se
rendit au nord du lac Michigan, accompagné du père Jacques Marquette à titre de
missionnaire et d'interprète. Ils découvrirent le fleuve Mississipi, mais
rebroussèrent chemin avant d'atteindre le golfe du Mexique, de crainte de «se
jeter dans les mains des Espagnols de la Floride s'ils avançoient davantage».
Le Pays-d'en-Haut fut
considéré avant tout comme une région stratégique pour la Nouvelle-France, non
comme une colonie de peuplement. L'objectif était de mieux contrôler les
Iroquois et d'arrêter l'expansion des colonies de la Nouvelle-Angleterre vers
l'ouest. Néanmoins, de nombreux Français s'y installèrent : c'étaient des
colons, des «voyageurs» et des coureurs des bois.
3.1 Les
missions chrétiennes
Il faut souligner une
première présence française importante, celle des missionnaires.
Désireux d'œuvrer à la conversion des nations amérindiennes de ce
«pais merveilleusement peuplé» (d'Amérindiens), les missionnaires prirent une
part active, dès 1626 mais surtout à partir de 1634, dans les équipes
d'explorateurs qui se rendaient dans le Pays-d'en-Haut.
Ainsi, les
missionnaires jésuites firent de la Huronie un pays de mission; ils
fondèrent plusieurs missions autour
de celle de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons,
ce qui constitua à cette époque la seule entreprise coloniale dans la région
des Grands Lacs. En 1649, en raison de la menace
iroquoise, les jésuites incendièrent
l'établissement de Saint-Marie-au-pays-des-Hurons et partirent avec des Hurons
fonder une autre mission le long du lac Huron, Sainte-Marie.
Puis,
entre 1665 et 1667, une certaine phase d'expansion fut entreprise grâce à des
explorateurs nommés par le gouverneur de Québec. Vers 1670, l'intendant Talon
favorisa plusieurs expéditions afin d'étendre les possessions françaises dans le
but de parvenir à la «mer de l'Ouest» qui, croyait-on, devait relier le
continent à la Chine. C'est dans cette perspective que les
missionnaires français, le jésuites, les
sulpiciens et les récollets, fondèrent les missions de Saint-Esprit à
Chagouamigon (1665), du Sault-Sainte-Marie (1668), de Saint-François-Xavier
(1669) et de Saint-Ignace à Michillimakinac (1670).
Du fait de leurs contacts
constants avec les Amérindiens, les missionnaires devinrent les détenteurs d'un
important savoir sur les langues et les mœurs des autochtones, notamment les
langues algonquiennes et
iroquoiennes. Étant parmi les
rares Français à connaître ces langues, ils servaient d'interprètes dans les
rencontres avec les nations auxquelles les Français désiraient s'allier. Les
missionnaires tentèrent bien de franciser les autochtones en les convertissant à
la foi chrétienne... tout en leur transmettant des maladies infectieuses. Les
épidémies décimèrent progressivement les populations amérindiennes avant même
qu'elles ne puissent se franciser.
À partir de la seconde
moitié du XVIIe
siècle, les missionnaires virent toutefois leur rôle diminuer sensiblement dans
la région des Grands Lacs. En effet, confrontés aux impératifs de la
colonisation française, les missionnaires perdirent graduellement leur rôle de
principaux représentants du gouverneur général auprès des nations amérindiennes
du Pays-d'en-Haut, et ce, au profit des commandants des forts qui vinrent s'y
installer à partir des années 1680.
3.2 La
construction des forts français
Convaincu de la justesse
du Mémoire de l'intendant Talon proposant «un establissement sur le lac
Ontario» dans le but de contrôler les Iroquois, le gouverneur général de la
Nouvelle-France, le comte de Frontenac,
quitta Montréal le 29 juin 1673, accompagné de son interprète et riche marchand
Charles Le Moyne, sieur de Longueuil et de Châteauguay, ainsi que de 400 hommes
du régiment de Carignan-Salières, et se rendit en canot au nord-est du lac
Ontario pour y construire le fort Cataracoui,
du nom de la rivière appelée Katarokewen par les Iroquois.
À la mi-juillet, Frontenac
reçut princièrement les chefs des
Cinq-Nations iroquoises. Il leur offrit de faire la paix, de profiter du
fort pour y troquer leurs fourrures, tout en leur suggérant de faire apprendre
le français à leurs enfants. Ce fort, construit aux frais de Frontenac (15 000
livres pour son établissement et sa garnison), avait pour but de protéger
Montréal et de favoriser l'expansion de la colonie par l'érection d'un poste de
traite de fourrures dans la région des Grands Lacs. Frontenac allait participer
lui-même à la traite des fourrures; tous les ans, il allait se rendre à «son»
fort avec une flottille de canots chargés de marchandises à troquer avec les
Iroquois. L'objectif officiel de Frontenac était d'obliger les Iroquois à se
soumettre à la paix universelle des Français (la pax gallica), mais son
but personnel était de court-circuiter ses compétiteurs en interceptant les
fourrures à leur source, avant qu'elles ne parviennent à Montréal.
Louis XIV
allait d'ailleurs reprocher à Frontenac son commerce illicite en le rappelant en
France en 1682 pour le remplacer par
Joseph-Antoine Lefèbre de
La Barre, qui
allait se révéler un gouverneur fort peu compétent au point de vue militaire.
En 1677, René-Robert
Cavelier de La Salle (1643-1687), un protégé du gouverneur Frontenac, fit
reconstruire le fort Cataracoui comme une véritable forteresse en pierre
entourée d'un fossé. Devenu le fort Frontenac,
il permettait aux Français de contrôler le lucratif commerce des fourrures dans
le bassin des Grands Lacs. Cavelier de La Salle devint l'administrateur et le
commandant du fort Frontenac et y fit construire plusieurs bâtiments
supplémentaires. Il y fit également venir des animaux domestiques et incita des
colons à venir s'installer près des forts français. Dans les faits, les premiers
forts furent construits à proximité des principaux villages amérindiens où les
jésuites avaient généralement déjà fondé une mission dans les années 1660 et
1670. De La Salle fit bâtir en 1678 le fort Niagara
au sud-ouest du lac Ontario. Puis, pour contrôler l'Ouest, il fit ériger en 1679
le fort Saint-Joseph donnant sur la rivière
des Miamis, ainsi que, l'année suivante, le fort
Crèvecœur, plus au sud, dans le
Pays des Illinois (voir
la carte des forts français).
En 1684, sous
de La
Barre, et en 1687 sous
Denonville, le
gouvernement colonial, soutenu par Versailles, entreprit des expéditions
militaires d'envergure contre les nations iroquoises. En représailles, quelque
1500 guerriers iroquois attaquèrent en 1689 la petite colonie de Lachine à
l'ouest de Montréal et massacrèrent 24 colons et en capturèrent plus de 60
autres. La férocité de l'attaque terrorisa les habitants de la région de
Montréal. Par la suite, le fort Frontenac fut partiellement détruit sous l'ordre
du gouverneur Jacques-René de Brisay,
marquis de Denonville, tandis que la garnison retournait à Québec. Le
gouverneur croyait à tort que l'éloignement du fort empêchait sa bonne défense
et qu'on ne pouvait pas le ravitailler de manière adéquate.
Redevenu gouverneur de la
Nouvelle-France, le comte de Frontenac
ordonna la reconstruction de «son» fort en 1695; celui-ci fut renforcé par 300
soldats sous la gouverne de François-Charles de Bourlamaque et par 160 colons.
Par la suite, le fort Frontenac (aujourd'hui Kingston) servira comme base
pratique pour les explorations françaises vers l'intérieur de l'Amérique du
Nord, le Pays-d'en-Haut, le
Pays des Illinois
(Haute-Louisiane) et la
Basse-Louisiane (Louisiane proprement dite). Il est légitime de se demander
pourquoi les différentes nations alliées des Français acceptaient ou désiraient
que des forts soient construits sur leurs terres. C'est que par ces
constructions les Amérindiens pouvaient profiter sur une base régulière des
avantages que leur procurait leur alliance avec les Français, sans être dans
l'obligation de se rendre jusqu'à Montréal, ce qui leur évitait de longs et
fastidieux voyages. À partir de l'année 1683-1684, des troupes des Compagnies
franches de la Marine furent envoyées en Nouvelle-France afin d'assurer la
défense des garnisons dans les principaux postes du Pays-d'en-Haut (voir
la carte des forts français).
3.3 Les
expéditions militaires
Le Pays-d'en-Haut devint
de plus en plus une région militarisée afin de faire face à la menace constante
que les Iroquois faisaient planer sur les alliés des Français et aussi pour
empêcher l'expansion des colonies britanniques vers l'ouest des Appalaches. Pour
chacun des postes fortifiés établis dans la région des Grands Lacs, un
commandant fut désigné par le gouverneur général dans le but d'entretenir les
relations avec les nations alliées. Les commandants des forts réussirent
progressivement à supplanter les missionnaires et à s'imposer au yeux des
autochtones comme les principaux représentants du gouverneur. De toute façon,
les Amérindiens préféraient transiger avec des militaires de carrière,
c'est-à-dire des «chefs de guerre», plutôt qu'avec les «Robes noires» qui leur
faisaient la morale et les menaçaient des terreurs de l'enfer. Désormais, les
Indiens pouvaient refuser la «conversion» catholique comme condition de leur
alliance.
Plusieurs expéditions
militaires furent entreprises dans le Pays-d'en-Haut en vue d'anéantir les
nations iroquoises: en 1684 (de
La Barre),
en 1687 (Denonville),
en 1693 (Frontenac)
et en 1696 (Frontenac).
Dans toutes ces expéditions, dont trois d'envergure (1684, 1687 et 1697), la
présence de centaines de guerriers autochtones alliés, de même que de 100 à 150
Français de l'Ouest, s'avérait une nécessité pour les troupes des Compagnies
franches de la Marine. Les guerriers amérindiens représentaient entre 20 % et 33
% de l'effectif total de l'armée (environ 2000 hommes); quant à la milice, elle
constituait parfois de 35 % jusqu'à 50 % de cet effectif. C'est en 1687, avec
une troupe de 2200 hommes de la Marine, accompagnée d'Amérindiens et de la
milice canadienne, que le gouverneur
Denonville assaillit la nation iroquoise la plus éloignée de la colonie, les
Tsonnontouans. Le 19 juillet, il prit
officiellement possession de leur territoire au nom de
Louis XIV.
Les autorités françaises
firent construire plusieurs autres forts, dont le fort Buade (1683), le fort
Sainte-Croix (1683), le fort Saint-Nicolas (1685), le fort Bon Secours (1685),
le fort Saint-Antoine (1686), le fort Le Sueur (1695), le Fort La Pointe (1696),
etc. (voir la carte des forts français).
Versailles décida toutefois en 1696 de fermer la plupart des postes de traite
dans le Pays-d'en-Haut, notamment les forts Frontenac, Michillimakinac et
Saint-Joseph des Miamis, pour cause «d'une insupportable dépense» ("Mémoire du
roi pour Frontenac et Champigny" du 16 mai 1696), mais en réalité le marché des
fourrures était saturé en Europe, après une surproduction d'une vingtaine
d'années. Un seul poste devait dorénavant assurer la présence française dans la
région: celui de Détroit. Le gouverneur de la Nouvelle-France ne fut plus
autorisé à envoyer des troupes dans cette région, sans le consentement préalable
de Versailles. Il est vrai que Louis XIV se montra toujours très économe quand
il s'agissait de dépenser de l'argent pour ses colonies, préférant conserver le
Trésor pour son palais de Versailles ou ses guerres européennes.
3.4
L'expansion coloniale après 1713
Après la perte de la
région de la Baie d'Hudson au traité
d'Utrecht de 1713, Versailles autorisa la construction de nombreux autres
forts afin de favoriser l'expansion vers l'Ouest, puisque le Nord était devenu
inaccessible. On érigea le fort La Baye (1717), le fort Ouiatenon (1717), le
fort Beauharnois (1727), le fort de la Presqu'île (1753), le fort Machault
(1754), le fort Dusquesne (1754), etc.
Voir la carte des forts français.
Grâce à ses alliances
amérindiennes et à ses prises de possession du territoire, la Nouvelle-France
contrôlait toute la région des Grands Lacs, y compris le sud du lac Ontario
depuis la Grande Paix de Montréal de 1701, et progressait plus au sud vers le
Pays des Illinois et, par la
suite, vers la Louisiane qui avait été fondée en 1682. Ainsi, la ville de La
Nouvelle-Orléans fut fondée en 1718 par Jean-Baptiste Le Moyne, sieur de
Bienville. Par la suite, un nombre croissant de Français et de Canadiens
s'établirent en Louisiane, plus précisément à La Nouvelle-Orléans ou à
Bâton-Rouge, à Pointe-Coupée ou le long du Natchez. En 1722, le siège du
gouvernement fut installé à La Nouvelle-Orléans qui comptait alors 203
habitants.
Au fur et à mesure que
s'implantaient les forts militaires français, la région vit augmenter
considérablement le nombre de coureurs des bois dans le Pays-d'en-Haut, ce qui
allait rendre les autochtones moins indispensables. Jusqu'à un certain point,
les coureurs des bois propageaient la langue française dans les forêts de
l'Amérique septentrionale, en plus de servir d'interprètes auprès des autorités
coloniales. Leur présence favorisa la désignation des lieux selon des
dénominations françaises, et ce, non seulement dans le Pays-d'en-Haut, mais
aussi, plus au sud, dans le Pays des
Illinois et jusqu'en Louisiane.
4.1 La
politique de francisation
Dès les premiers contacts avec les
Amérindiens, les autorités françaises ont pensé pouvoir pratiquer une politique
de francisation à leur égard. L'objectif des autorités était double : d'une
part, il s'agissait de propager le modèle culturel français, et en particulier
le christianisme et la langue française, d'autre part, il fallait favoriser le
peuplement de la colonie. En 1635, l'année de sa mort, le fondateur de Québec,
Samuel de Champlain, avait confié à ses alliés algonquins : «Un jour, nos
garçons marieront vos filles, et nous ne serons plus qu'un seul peuple.» C'était
là une façon de pallier le lent démarrage du peuplement de la colonie. En 1627,
en vertu des documents qui rendaient officielle la création de la Compagnie des
Cent-Associés, les Amérindiens convertis au catholicisme devenaient
juridiquement des «naturels Français»:
|
4. Que les
descendants des Français qui se fixeraient dans le pays, ainsi que
les Sauvages qui embrasseraient la foi catholique, seraient censés
et réputés naturels français, et jouiraient en France de tous les
droits de sujets français, sans être tenus de prendre aucune lettre
de déclaration ou de naturalité. |
Si la politique de
francisation s'est avérée difficile, voire impossible, dans la vallée du
Saint-Laurent, alors que la population française était plus nombreuse que celle
des autochtones, il est légitime de se demander ce qu'il en était dans le
Pays-d'en-Haut, puisque, selon
l'intendant
Jean Bochart de Champigny
(1686-1702) après son retour en France (1705),
«le nombre des
sauvages est beaucoup superieur a celuy des François».
De fait, au cours de
tout le Régime français, la population autochtone du Pays-d'en-Haut demeura très
faible par rapport à celle du Saint-Laurent et encore davantage par rapport aux
Amérindiens.
Il n'y a jamais eu plus de 2000 Français, militaires, traiteurs,
colons et gens de métier) vivant en permanence dans l'Ouest, contre quelque 20
000 autochtones, notamment des Algonquiens et des Iroquois. Néanmoins, dans une
lettre au ministre Pontchartrain en
1699,
Lamothe-Cadillac croyait que, grâce à l'établissement du fort de Détroit, il
serait plus facile de convertir les Indiennes une fois qu'elles auront appris à
parler le français et qu'on les aura civilisées, on pourra marier plusieurs avec
des soldats français :
|
Lorsqu'il y
aura des sauvagesses qui parleront bon françois et qui seront
instruites en nostre foy, s'il y a des soldats qui les veulent
espouser, ou autres François, il y faut donner les mains, et si le
Roy vouloit faire quelque gratification en faveur de ces mariages,
ce seroit encore mieux et cela engageroit ces pauvres filles à se
convertir plus facilement [...] si bien que les enfans qui en
proviendroient ne parleroient plus que françois et auroient de
l'aversion pour la langue sauvage, comme l'expérience le fait voir
tous les jours dans le Canada. |
Pour Cadillac, l'un des moyens de s'attacher les Amérindiens consistait à marier
les Indiennes à des Français et ainsi de les franciser et les convertir à la religion catholique.
Cette politique du métissage ne faisait pas l'unanimité. Le ministre
Pontchartrain hésitait à interdire ces unions, alors que le
gouverneur Philippe Rigaud de Vaudreuil
signalait l'importance de ne «jamais mesler un mauvais sang avec un bon». En
Louisiane, le gouverneur Bienville
et le commissaire-ordonnateur Salmon
croyaient que les Métis étaient «plus coquins que les sauvages mêmes» (lettre au
ministre Maurepas en date du 3 mai
1735).
Évidemment, ces Français,
qui vécurent dans cette grande région de traite des fourrures avec des épouses
indiennes et des enfants métis, formaient une classe bien différente des
habitants de la vallée du Saint-Laurent. Ils avaient aussi le grand mérite de
maîtriser les techniques militaires amérindiennes et l'art de survivre dans un
environnement hostile. Non seulement ils pouvaient servir d'éclaireurs et
d'interprètes auprès de l'armée française, mais ils participaient à toutes les
expéditions militaires organisées dans le Pays-d'en-Haut par les autorités
coloniales (cf. les gouverneurs
Frontenac, de La Barre et Denonville).
4.2 Le
métissage et l'acculturation des coureurs des bois
Bien
que les autorités françaises aient interdit aux Français de se rendre dans le
Pays-d'en-Haut sans autorisation, ce fut une véritable ruée vers Grands Lacs
pour la traite des fourrures. Attirés par l'appât du gain, les coureurs des bois
affluèrent dans la région. En raison de l'absence totale de femmes blanches, ces
hommes trouvèrent des «compagnes» dans les villages autochtones. C'est ainsi que
l'extrême rareté des Européennes dans le Pays-d'en-Haut a entraîné la croissance
du métissage entre Français et Indiennes. Les missionnaires ont souvent critiqué
«le libertinage des François aves les Sauvagesses», mais ils n'ont pu convaincre
les coureurs des bois de pratiquer l'abstinence sexuelle, surtout que les femmes
indiennes manifestaient une sexualité peu marquée par la honte et les interdits,
comme c'était le cas en France et dans la vallée du Saint-Laurent.
Les
mariages mixtes furent donc perçus dans le Pays-d'en-Haut comme un excellent
moyen pour encadrer et assimiler les indigènes. En 1699, lorsque
La Mothe-Cadillac voulut fonder Détroit,
il proposa de marier les Français à des «Sauvagesses» converties au
catholicisme: «Les enfans, qui
en proviendroient ne
parleroient plus que françois.» En réalité, à cette époque, le rêve de
francisation s'était estompé, et il n'est pas sûr que Cadillac ait cru un mot de
ce qu'il écrivait. Dans une lettre adressée le 22 septembre 1699 à Pierre Le Moyne d'Iberville,
Louis XIV semblait accepter les mariages mixtes:
|
Sa Majesté
a étudié la recommandation formulée par le sieur d'Iberville selon
laquelle il devoit etre notamment permis d'épouser de jeunes
Indiennes. Sa Majesté n'y voit aucun inconvénient pourvu qu'elles
soient chrétiennes, auquel cas Sa Majesté donne son entière
approbation. |
Toutefois, le mariage n'a pas
nécessairement entraîné l'assimilation des Indiennes. Au contraire, elles
constituèrent dans bien des cas un agent d'acculturation des Français. Ainsi, au
lieu d'adopter les mœurs et coutumes des Français, les Indiennes les auraient
«ensauvagés» en vivant comme les autochtones. En 1706, le
gouverneur général, Philippe de Rigaud
(père), marquis de Vaudreuil, interdit
formellement à La Mothe-Cadillac
«de laisser marier des
François avec des Sauvages [...] persuadé qu'il ne faut jamais mesler un mauvais
sang avec un bon».
|
L'esperience que l'on a en ce pays que tous les François qui ont
Epousé des Sauvagesses sont devenus libertins feneans et d'une
independance insuportable, et que les enfants qu'ils ont eu ont esté
d'une feneantise aussy grande que les sauvages mesmes, doit
empescher qu'on ne permette ces sortes de mariages.
|
Vaudreuil admettait à sa façon l'échec
de l'assimilation des autochtones par le mariage. Pour les administrateurs
français, les Métis, appelés généralement les «sang-mêlés», furent perçus comme
des «êtres dégénérés». Le
missionnaire français
François
Le Maire
(1675-1748), qui avait œuvré en Louisiane, déclarait pour sa part :
«Toute
sauvagesse est toujours sauvagesse, c'est a dire, volage, et de tres difficile
retour quand elles sont une fois dereglées.» Même catholiques, les
Amérindiennes élevaient leurs enfants métis «à l'indienne», donc en leur
apprenant la langue indienne locale, ce qui contribuait à l'«ensauvagement» des
maris français. Les enfants restaient dans la tribu et devenaient des Indiens à
part entière. Les sources sont presque inexistantes sur la francisation des
Indiennes, mais il est probable que peu d'entre elles se soient francisées, du
moins dans le Pays-d'en-Haut, car dans la vallée du Saint-Laurent l'assimilation
des autochtones a été importante.
4.3 Le rôle
économique des Indiennes
Pour
les Français qui vivaient dans le Pays-d'en-Haut, les Indiennes se révélaient
une aide non seulement précieuse, mais souvent indispensable pour mener à bien
leurs activités de traite. Il était avantageux pour les Français de courtiser
celles qu'on appelait aussi les «femmes de chasse», car elles avaient appris dès
leur jeune âge à se déplacer en forêt et connaissaient bien la langue locale du
territoire. Ces femmes ouvraient la porte de leur clan ou de leur tribu à leur
compagnon blanc, ce qui lui offrait la protection des autochtones. Ces Indiennes
reprenaient au profit du mari blanc les tâches traditionnelles telles la
cueillette des fruits, la capture du petit gibier, la préparation des repas;
elles s'occupaient du bois de chauffage, lavaient le linge «au bord du lac»,
confectionnaient des mocassins, apprêtaient les peaux, etc. Toutes ces femmes
autochtones ont donc joué un rôle central dans le commerce des fourrures au
Pays-d'en-Haut. Elles devenaient souvent un élément essentiel dans les alliances
entre les coureurs des bois et les partenaires de traite autochtones. On
comprendra pourquoi le savoir-faire et les liens de parenté des Indiennes, de
pair avec l'absence totale de femmes blanches, devinrent pour les traiteurs de
puissantes attractions pour les rechercher pour épouses.
Si le métissage n'a pas
entraîné l'assimilation des peuples autochtones, il a donné naissance à un
peuple distinct, les Métis, qui fondèrent leurs propres communautés le long des
rives des Grands Lacs. Certains de ces Métis ont parlé le français, même si leur
langue contenait beaucoup de mots amérindiens rappelant partiellement leur
origine; ils conservèrent aussi une grande part de la culture autochtone.
Après la Conquête
de 1760, les Métis en arriveront néanmoins à délaisser leur langue amérindienne.
Au début du XIXe siècle,
la région des Grands Lacs comptera plus de 15 000 Métis qui parleront pour la
plupart le français ou l'anglais.
4.4 La
ville de Détroit
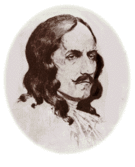 |
En 1701, Antoine Laumet
de La Mothe-Cadillac, commandant du fort de Michillimakinac
(1694-1996) et de tous les forts du Pays-d'en-Haut, construisit un
fort appelé «Fort Pontchartrain du Détroit», en l'honneur du
comte de Pontchartrain, ministre de la Marine de
Louis XIV. Ce
fort était situé à l'extrémité ouest du lac Érié. L'année suivante,
Cadillac retourna à Québec pour obtenir le monopole du commerce des
fourrures. Il devint actionnaire de la Compagnie de la Colonie.
Après avoir été accusé de trafic d'alcool et de fourrures, il fut
blanchi par le roi en 1705. Cadillac voulait foncer une ville,
Détroit, qui deviendrait «le Paris de la Nouvelle-France». Il
demanda des hommes de troupe, qu'il entendait employer à des fins de
peuplement; il voulait aussi encourager la migration d'habitants de
la colonie en les attirant par le commerce des fourrures. |
Les Hurons, les Loups et
les Outaouais vinrent s'établir dans les environs immédiats du nouveau fort. En
1706, Détroit comptait 216 personnes, dont 28 familles. Afin de poursuivre sa
politique de peuplement, Cadillac procéda à la concession de terres en
distribuant 68 emplacements et 31 terres à Détroit. En 1708, il sollicita du roi
la ratification des seigneuries données à sa fille et à son fils et de celle
qu'il s'était réservée pour lui-même. Il déclara qu'il y avait 120 maisons dans
le fort de Détroit et quelque 1200 Amérindiens vivant dans les environs.
Toutefois, au cours de cette période où le développement de Détroit progressait,
Cadillac provoquait la controverse tant à Québec qu'à Versailles. Il vendait
«ses» fourrures aux Anglais et «son» alcool aux Indiens. Pire, il se mit à dos
le gouverneur Philippe de
Rigaud de Vaudreuil.
En novembre 1707, le
ministre Pontchartrain chargea François Clairambault d'Aigremont d'enquêter sur
les événements dans l'Ouest et de faire un rapport. Après dix-neuf jours passés
à Détroit, celui-ci conclut que Cadillac exploitait les habitants, qu'il se
pratiquait plusieurs actes illégaux dans le commerce des fourrures, dont une
certaine quantité serait détournée vers les colonies anglaises. Selon
D'Aigremont, la population de Détroit s'élevait à 63 habitants, dont plusieurs
soldats. Le rapport de D'Aigremont porta un dur coup au fondateur de Détroit et
à son établissement.
Antoine Laumet de La
Mothe-Cadillac fut muté en Louisiane comme gouverneur. Le commandement de
Détroit fut confié au sieur François Dauphin de La Forest, un militaire réputé
pour son incompétence. Cette mutation correspondait à un désaveu de la part des
autorités envers l'établissement de Détroit. Elles abandonnèrent tout projet de
développement du Pays-d'en-Haut. Déjà, au recensement de 1710, il ne restait à
Détroit que six familles établies sur des terres et onze autres à l'intérieur du
fort. De fait, à part quelques exceptions, dont Détroit et Sault-Sainte-Marie,
la Nouvelle-France s'était montrée incapable de soutenir des populations
permanentes dans le Pays-d'en-Haut. Néanmoins, à la fin du Régime français,
Détroit comptera encore plus de 800 résidants répartis des deux côtés de la
rivière sur quelque 15 kilomètres. Ailleurs, il y aura quelques milliers de
Métis, résultat de la cohabitation durable entre Blancs et Amérindiens.
4.5 Le
français «de l'intérieur»
Aux confins de la
Nouvelle-France, le français servait de langue véhiculaire à Détroit et dans la
région immédiate. En raison du contexte très particulier, le français qu'on
utilisait à Détroit témoignait d'une certaine spécificité par rapport à celui
employé dans la vallée du Saint-Laurent. C'est surtout le lexique qui a été
touché, car les Français et les Canadiens qui vivaient à Détroit utilisaient
certains termes particuliers inconnus à Montréal et à Québec, des termes liés au
climat, à la géographie, à la faune et à la flore. En 1743 et 1752, le père
Louis-Philippe Potier (1708-1781), un missionnaire
d'origine belge, a rapporté dans Façons de parler proverbiales, triviales,
figurées, etc., des Canadiens au
XVIIIe siècle près
de deux
milliers d'expressions inusitées pour lui et employées par les Canadiens,
incluant les emplois du Pays-d'en-Haut et de la Louisiane (pays des
Illinois et région du Mississipi). Le
père L.-P. Potier voulait décrire les expressions et les mots qui se
différenciaient du français de l'époque. Dans son ouvrage, le père Potier ne
signale pas explicitement de différences entre le français de la vallée
laurentienne et celui de la colonie de Détroit. Cependant, il note des emplois
qu'il a remarqué à Détroit, sans les distinguer s'ils sont spécifiques ou non
dans une région en particulier. Or, certains anthropologues et linguistes
américains ont mentionné dans des études plus récentes un «français de la
frontière», un "Midwestern French speech area". Potier a relevé une
cinquantaine de mots en ce qui concerne la région de Détroit, dont écorces («couverture de
toit», «bardeaux»), entourage (en charpenterie: «pièces sur pièces»),
taquet («attache en cuir»), boeuf illinois («bovin d'origine
européenne»), fève illinoise («haricot sec avec une tache noire»),
folle-avoine («riz sauvage»), têtes de femmes («mottes de terre dans
les prairies»), tapager («faire du tapage»), tapé («fou» ou «un
peu fou»), etc. Les travaux du père Potier attestent sans aucun doute la longue
présence francophone dans cette enclave longtemps isolée des autres centres et
principales communautés françaises de la Nouvelle-France.
Pour sa part, le
linguiste Peter W. Halford
(1942-2002),
premier linguiste à consacrer sa
carrière à l'étude du français du Détroit (Université de Winsor),
a étudié les
travaux du père Potier. Il décrit (dans «En route vers le Pays des Illinois et
le pays d'en Haut: quelques aspects du vocabulaire du Détroit»)
le français en usage dans cette colonie
comme «un bel exemple de continuité et de modification, de maintien et
d'innovation». Halford mentionne que, selon les sources consultés, le
vocabulaire «de l'intérieur» (ou de la frontière) est clairement celui du
français de la Nouvelle-France du XVIIIe siècle, avec uniquement quelques
éléments lexicaux qui auraient surpris les habitants des anciens centres dans la
vallée laurentienne. Évidemment, il n'est pas toujours aisé de cerner au juste
quel était le vocabulaire quotidien du Pays-d'en-Haut, car la quasi-totalité des
voyageurs, des coureurs des bois, des engagés et des premiers colons ne nous ont
laissé aucune trace écrite.
Mais Peter W. Halford
signale qu'il est néanmoins possible de relever un certain nombre de
désignations qui sont inusitées ou rares ailleurs en Amérique septentrionale, en
raison de l'importance des voies d'eau dans les «voyages» de l'époque. Il cite
quelques exemples: coulée («chenal»), chenail («chenal, canal»),
raccros («petite anse»), rigolet («petit chenal») et roulin
d'eau («vague»). Des termes relatifs à la flore et à la faune ont été
répertoriés avant l'arrivée du père Potier, et ils le sont encore de nos jours.
Parmi les plantes propres au Pays-d'en-Haut, signalons les suivantes:
assimine («fruit de l'assiminier),
citron («pomme de
mai, fruit du podophile pelté),
noyer ou noix de France («noyer» ou «fruit du noyer noir»),
noyer blanc («noyer tendre»). La faune aussi a ses
particularités : boeuf sauvage
(«bison»), boeuf
illinois («bovin de race européenne»), rat des bois
(«opossum»: marsupial d'origine algonquienne, oposon),
caille des prairies
(«alouette»), canard de France
ou canard
français («canard colvert» ou «canard malard»). On trouve aussi
quelques termes spécifiques à la traite des fourrures: bateau du cent
(canot capable de transporter cent paquets des voyageurs»), brasse de tabac
(«mesure de tabac roulé»), couteau boucheron («sorte de couteau de
boucher»), piroguée («contenu d'une pirogue»), paquet («bale de
fourrures»), souliers sauvages («mocassin à l'indienne»). Il y avait
aussi plusieurs autres mots employés à l'époque dans ce «français de
l'intérieur», mais qui sont aujourd'hui complètement sortis de l'usage.
Beaucoup plus que dans la
vallée du Saint-Laurent, le Pays-d'en-Haut a vu se juxtaposer deux
civilisations, celle des Français et celle des Amérindiens, avec de part et
d'autre de multiples transferts culturels. Cette partie du Canada de l'époque
fut davantage qu'un simple réservoir pour la traite des fourrures : elle devint
un cadre privilégié dans l'alliance entre les Français et les Amérindiens et un
pôle indissociable du métissage franco-indien, tout en participant à l'identité
culturelle de la Nouvelle-France.
Après le traité de Paris
de 1763, les Britanniques s'emparèrent de tous les emplacements français. La
plupart des forts français furent détruits, sauf les plus importants construits
en pierre. Puis toute la zone des Grands Lacs fut détachée de ce qui était
devenu la «province de Québec», et érigée provisoirement en «Territoire indien».
Durant plusieurs années, les francophones qui vivaient dans l'ancien «Pays-d'en-Haut
survécurent relativement en paix et isolés; occupant les deux rives de la
rivière du Détroit, ils conservèrent leurs coutumes, leur religion et leur
langue.
Cependant, après la
guerre de l'Indépendance américaine (1775-1783), l'Empire du Nord britannique
dut rendre tout le sud des Grands Lacs aux États-Unis (voir la
carte). Tous les Canadiens et Amérindiens qui y vivaient devinrent alors
américains. Ils devaient s'assimiler progressivement dans leur nouveau pays.
Puis le nord des Grands Lacs, lequel restait aux mains de la Couronne
britannique, vit apparaître de nombreux loyalistes qui avaient quitté les
États-Unis pour la «province de Québec». Plus de 6000 loyalistes
dits de l'Empire uni (United Empire Loyalists) colonisèrent le littoral
du fleuve Saint-Laurent, depuis le lac Saint-François jusqu'au lac Ontario, de
même que les rives du lac Ontario jusqu'à la baie de Quinté (Kenté), puis les
environs de la ville de Niagara (appelée alors "Newark») et une partie des
berges de la rivière du Détroit. Le peuplement anglophone de l'ouest de la
«province de Québec» était commencé.
En 1791, la province de
Québec fut divisée en Haut-Canada (Ontario) et en Bas-Canada, ce qui n'était pas
sans rappeler l'ancienne appellation de «Pays-d'en-Haut». Après la guerre
anglo-américaine de 1812, des vagues d'immigration massives, venues notamment du
Kentucky, de la Nouvelle-Angleterre et de Grande-Bretagne, affluèrent à un point
tel que les Canadiens français se trouvèrent rapidement en situation
minoritaire. C'est grâce en partie à nouvelle vague d'immigration venue cette
fois de la vallée du Saint-Laurent dans la seconde moitié du
XIXe
siècle, que la minorité francophone
réussira à se maintenir dans cette région qui fait maintenant partie de la
province de l'Ontario.
La toponymie française
fixée par les explorateurs et pionniers français resta présente sur les
territoires du Haut-Canada (voir
la liste) et des États-Unis comme un ultime héritage de la Nouvelle-France.
Néanmoins, beaucoup de toponymes furent traduits en anglais et devinrent des
dénominations officielles:
Peach Island (île à la Pêche), Turkey Island (île aux Dindes),
Bob-lo Island (île aux Bois-Blancs), Little River (Petite-Rivière),
River Rouge (rivière Rouge), River Raisin (rivière aux Raisins),
etc. Paradoxalement c'est du côté américain que les toponymes français sont restés
intacts (voir
la liste).
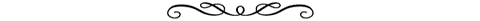
Dernière version mise à
jour:
02 avr. 2023
Bibliographie portant sur
la Nouvelle-France