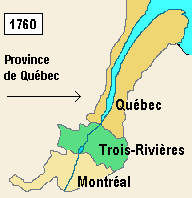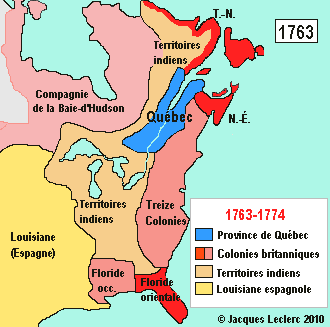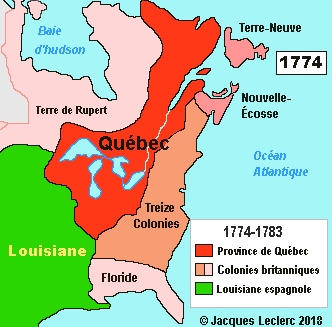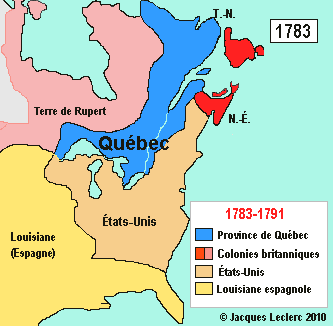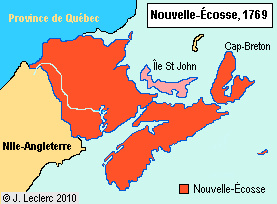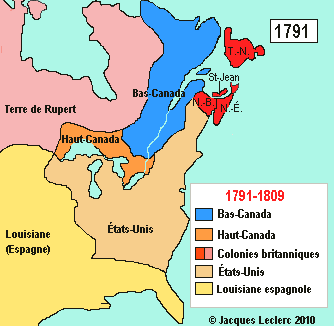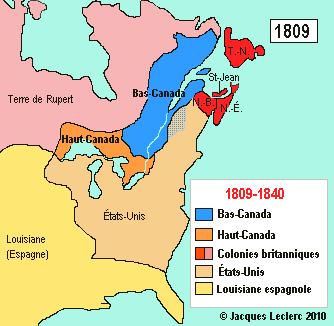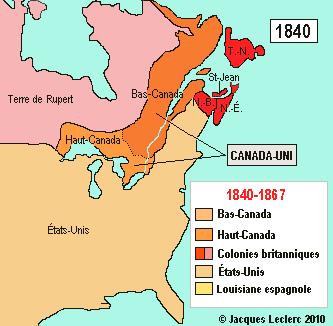Histoire du français au Québec
Section 2
![[Union Flag of 1801]](images/G-B_drap.gif) |
(2) Le Régime britannique
(1760-1840)
Une majorité française
menacée
|
Plan de l'article
C'est au printemps de 1756 que débuta
en Europe la guerre de Sept Ans (1756-1763).
La plupart des grandes puissances européennes de l'époque étaient impliquées
dans cette guerre qui opposait, d'un côté, la Prusse, la Grande-Bretagne et le
Hanovre, et de l'autre, l'Autriche, la Saxe, la France, la Russie, la Suède et
l'Espagne. Certains historiens parlent aussi d'une sorte de «première guerre
mondiale», car le conflit couvrait le monde entier, de l'Europe aux Indes, des
Antilles aux Philippines et de l'Amérique du Nord à l'Asie. Ainsi, le conflit
aux Indes opposait la France à la Grande-Bretagne, alors que celui en Amérique
du Nord opposait la Couronne anglaise et ses colonies de la Nouvelle-Angleterre
aux Français et à leurs alliés amérindiens.
Alors que la
France croyait qu'elle devait miser sur ses victoires en Europe, la
Grande-Bretagne croyait plutôt que la guerre devait se gagner dans les colonies,
d'où cet effort colossal pour préparer une flotte pouvant maîtriser les mers du
monde. Contrairement à la France, la Grande-Bretagne avait vu le potentiel
économique que représentait l'Amérique du Nord. Pour la France, la
Nouvelle-France n'avait qu'un intérêt stratégique: elle servait à repousser ou à
arrêter l'expansion des Britanniques en Amérique du Nord. Ses colonies
rapportaient peu, mais elles ne coûtaient pas très cher.
1.1 Une question de
vocabulaire
Cependant, pour l'Amérique du Nord,
on parle davantage de guerre de la Conquête
(1756-1760) qui, tout en coïncidant avec la guerre de Sept Ans (1756-1763), se
termina trois ans avant la guerre en Europe. Or, la guerre de la Conquête, qui porte
plusieurs noms, a eu des conséquences déterminantes en Amérique du Nord. Si l'on
utilise généralement en français les appellations
guerre de la Conquête (War of the Conquest) et
guerre de Sept Ans (Seven Years' War),
on emploie plus souvent en anglais les termes French
and Indian War («guerre contre les Français et les Indiens» ou
«Guerre franco-indienne»), Seven Years' War
(guerre de Sept Ans), ou encore War for Empire
(«guerre pour l'Empire»), parfois British Conquest
(«Conquête britannique»). Mais les deux appellations les plus
significatives sont dans aucun doute guerre de la
Conquête pour les francophones du Canada et
French and Indian War pour les anglophones pour lesquels cette
dernière expression témoigne de l'imbrication des alliances franco-indiennes.
Pendant que
Louis XV gouvernait le royaume de France
(1715-1774), George II gouvernait la
Grande-Bretagne (1727-1760), mais ce roi anglais était un francophone de
naissance. Jusqu'à l'âge de quatre ans, il n'a parlé que le français pour
apprendre ensuite l'allemand en tant que prince de la Maison de Hanovre. Une
fois roi d'Angleterre, il apprit également l'anglais et l'italien, mais il ne
maîtrisa jamais ces deux langues. George III
(1760-1820), qui succéda à George II dont il était le petit-fils, est né en
Grande-Bretagne et eut l'anglais comme langue maternelle. Cependant, la santé de
George III commença à se détériorer dès les années 1780, car il souffrait de
troubles mentaux. Il régna avec des hauts et des bas jusqu'à ce qu'il accepte la
régence en 1811. Durant cette période qui va de 1760 à 1840, les souverains
anglais furent George III, George IV (1820-1830), Guillaume IV
(1830-1837) et la reine Victoria dont le long règne allait se terminer en
1901.
1.2 La chute de la
Nouvelle-France
Afin de
prendre Québec, il fallait que les nombreux navires de guerre de la
Grande-Bretagne puissent franchir le fleuve Saint-Laurent qui était pratiquement
inconnu des Anglais. L'Angleterre fit appel à James Cook qui mena ses
inspections sous le couvert de la nuit, plaçant des bouées pour indiquer les
bas-fonds, les rochers et les dangereux courants. Son minutieux travail, surtout
entre l'île d'Orléans et la côtes nord, allait permettre à la flotte britannique
et aux navires de ravitaillement d'atteindre sans encombre la forteresse de
Québec. Ses cartes marines parurent si complètes qu'elles allaient servir aux
navigateurs pendant plus d'une centaine d'années.
Au cours de cette guerre, les armées
britanniques du jeune major général James Wolfe assiégèrent Québec et taillèrent
en pièces les troupes
franco-canadiennes du général Montcalm (un Français), lors de la bataille des
Plaines d'Abraham du 13 septembre 1759. Pourtant, lors de cette bataille ultime,
Montcalm pouvait disposer de 10 000 hommes contre les 9000 de Wolfe (dont 33 %
de Rangers — des futurs Américains —, 25 % d'Irlandais, 23 % d'Anglais, 15 %
d'Écossais et 4 % de Suisses et d'Allemands). Au moment de la bataille des
Plaines d'Abraham, il ne restera plus que 4440 hommes valides, car il y avait
déjà plus de 850 morts, un millier de blessés et 1600 soldats détachés pour
détruire les villages environnants. Pour sa part, Montcalm disposait de 4400
hommes. Les deux armées étaient, au point de vue du nombre, de force à peu près
égale. Toutefois, l'armée britannique était composée uniquement de soldats
réguliers, bien entraînés et habitués à combattre en terrain découvert. Au
contraire, l'armée française était formée de 2000 réguliers, le reste étant
composé de miliciens et d'Amérindiens (1600), de volontaires canadiens et
acadiens (600), souvent inexpérimentés dans les batailles
à l'européenne, et mal armés, car ne disposant que de simples fusils dépourvus
de baïonnettes; de plus, en arrivant sur les Plaines, ces hommes étaient
fatigués de leur longue marche depuis Beauport.
Par ailleurs, les forces franco-canadiennes
étaient commandées par deux chefs (Vaudreuil et Montcalm) aux vues
diamétralement opposées. Le secrétaire d'État à la Marine de 1758 à 1761,
Nicolas Berryer, comte de
la Ferrière, nommé ministre grâce à la protection de Madame
de Pompadour, avait eu l'idée insolite d'imposer à la Nouvelle-France un commandement à
deux têtes. Ce personnage, qui ne connaissait rien à la guerre, au demeurant un
bon chef de police, détenait entre
ses mains le destin de la Nouvelle-France. Pendant que Montcalm commandait
l'armée française, Vaudreuil dirigeait la milice et les troupes du Canada.
Vaudreuil demeurait responsable des plans de campagne, mais Montcalm pouvait
décider ce qu'il voulait. Voici ce qu'avait écrit Louis-Antoine de Bougainville,
délégué spécialement auprès de la Cour, le 20 novembre 1758, à M. de Vaudreuil
et au général Montcalm :
|
M. Berryer ne voulut
jamais comprendre que le Canada était la barrière de nos autres colonies
et que les Anglais n'en attaqueraient jamais aucune autre, tant qu'ils
ne nous auraient pas chassés de celle-là. Le ministre aimait les
paraboles et me dit fort pertinemment qu'on ne cherchait point à sauver
les écuries quand le feu était à la maison. Je ne pus donc obtenir, pour
ces pauvres écuries, que 400 hommes de recrue et quelques munitions de
guerre. |
Le 13 octobre 1761, alors que la
Nouvelle-France était perdue, Louis XV allait devoir démettre de ses fonctions
le ministre Berryer en raison de son incompétence manifeste et le remplacer par
le duc Étienne-François de Choiseul.
Après la capitulation de Montréal en 1760, Voltaire ira jusqu'à donner une
grande fête à Ferney (Suisse) pour «célébrer le triomphe des Anglais à Québec».
En fait, Voltaire voulait célébrer non pas le triomphe de l'Angleterre sur la
France, mais le triomphe de la liberté sur le despotisme. Il croyait que la
perte du Canada serait la délivrance des colonies britanniques et, par la suite,
l'affranchissement de toute l'Amérique. L'une des lettres les plus célèbres de
Voltaire sur le Canada est celle qu'il écrivit, le 6 septembre 1762, au comte
César Gabriel de Choiseul
(1712-1785), futur duc de Praslin, qui avait remplacé en 1761 son cousin
Étienne-François au poste de secrétaire d'État des Affaires étrangères:
|
Si je ne voulais que
faire entendre ma voix, Monseigneur, je me tairais dans la crise des
affaires où vous êtes. Mais j'entends les voix de beaucoup d'étrangers,
toutes disant qu'on doit vous bénir si vous faites la paix à quelque
prix que ce soit. Permettez-moi donc monseigneur, de vous en faire mon
compliment. Je suis comme le public, j'aime mieux la paix que le Canada,
et je crois que la France peut être heureuse sans Québec. Vous nous
donnez précisément ce dont nous avons besoin. Nous vous devons des
actions de grâces. Recevez en attendant avec votre bonté ordinaire le
profond respect de Voltaire. |
Voltaire admirait les Anglais. Il avait
séjourné trois ans à Londres et avait appris l'anglais tout en s'imprégnant des idéologies
de ce pays. S'il n'aimait pas le Canada, Voltaire avait en revanche une opinion beaucoup
plus positive de l'île Royale et la forteresse de Louisbourg (voir
le texte).
- La bataille des
Plaines
Ce matin du 13
septembre 1759, le général Montcalm, qui contrôlait l'armée française,
croyait alors qu'il ne pouvait attendre les renforts de
Louis-Antoine de Bougainville pour coincer les Britanniques entre deux feux, mais
il ne pouvait pas savoir (ce que nous connaissons aujourd'hui) qu'il aurait eu
amplement le temps d'attendre deux ou trois heures parce que l'armée britannique était déjà
au complet et ne pouvait se renforcer davantage. Il pensait que le risque d'attendre
était plus grand que celui d'attaquer immédiatement. Montcalm avait pris la
décision d'incorporer à chaque régiment de l'armée un corps de miliciens
canadiens et acadiens, dont il se méfait. Il aurait commis
l'imprudence de faire avancer ses troupes en terrain découvert, ce qui était un
risque énorme, puisque la puissance de feu adverse pouvait pleinement s'exercer,
avec une armée britannique composée uniquement de soldats
réguliers et professionnels. Puis il imposa à
cette milice une bataille rangée à l'européenne, ce qui la paralysa en moins de
quinze minutes. Montcalm donna aussitôt un ordre de
repli derrière les remparts de Québec, le tout dans un désordre
catastrophique. La milice finit par retrouver ses
moyens et mitrailla férocement les Britanniques. Montcalm reçut
une blessure mortelle, Wolfe fut tué ainsi que son second, le général Monckton.
Visualiser
une vidéo sur la bataille des Plaines en cliquant ICI, s.v.p.
Au total:
658 tués ou blessés chez les Britanniques, 644 chez les
Français, le nombre de Français et de Canadiens et d'Acadiens tombés durant la
bataille demeurant à peu près équivalent à celui des Britanniques. En fait, les
combats avaient duré près de cinq heures, soit de 7 h du matin, au moment où les
Britanniques se sont présentés sur les plaines, jusqu'à midi. Le gros des pertes
françaises a eu lieu lors de la bataille rangée, tandis que les Britanniques ont
subi leurs pertes importantes aux mains des miliciens canadiens et des
Amérindiens, qui couvraient la retraite des Français.
Dans la nuit du 13 au 14
septembre, juste avant de
mourir, Montcalm exprima ses regrets à Vaudreuil et lui recommanda de reprendre
le combat avec l'armée française qui était encore intacte, car elle n'avait pas
participé à la bataille des Plaines. Jusqu'à ce moment-là, rien n'était joué:
aucun des deux camps n'avait gagné ni perdu. Puis tout se précipita du côté
français.
- La retraite
Par malheur, Gaston-François de
Lévis, le commandant en second des troupes françaises, était à Montréal. Il
se passa quatre jours avant son arrivée à Québec, soit le 17 septembre. Quant à Vaudreuil, il n'eut aucune influence sur les officiers
français, qui refusèrent de suivre le gouverneur canadien, un «colonial» peu
crédible à leurs yeux. Cédant à la panique, celui-ci ordonna la retraite de l'armée française et
il alla se réfugier avec les troupes à 12 lieues (environ 50 km) de Québec, vers la
rivière Jacques-Cartier, laissant le commandement
de la ville à
Jean-Baptiste-Nicolas-Roch de Ramezay, qui ne disposait plus que
de 2000 hommes. Ayant pris le commandement de l'armée française désorganisée,
Lévis estima que quitter Québec avait été une grave erreur. Le 18 septembre 1759,
de Ramezay,
ignorant que Lévis se préparait à reprendre la ville,
sur les plus
pressantes instances des notables et des marchands, à court de vivres et
intimidés par le déploiement des forces britanniques, rendit
la ville aux Britanniques, avec en mains
le texte de la capitulation prévue par Montcalm (voir
le texte des 11 articles). Les notables craignaient «de
tomber sous le joug de l'ennemi pour devenir les victimes de leur fureur» et
croyaient qu'il «n'est point honteux de céder quand on est dans l'impossibilité
de vaincre». Lorsque Lévis
arriva devant Québec, il était trop tard, la reddition avait été acceptée par le
général Towshend. Lévis s'écria: «Il
est inouï que l'on rende une place sans qu'elle ne soit attaquée ni investie.»
Il dut alors rebrousser chemin et se diriger vers la rivière
Jacques-Cartier.
Au printemps de 1760, Lévis
revint à Québec et gagna la bataille de Sainte-Foy contre les Britanniques.
Québec fut de nouveau assiégée, mais les Français manquèrent de munitions et de
vivres. La bataille de Sainte-Foy fut l'une des plus sanglantes de la Conquête:
193 soldats tués et 640 blessés chez les Français, contre 259 morts et 829
blessés chez les Britanniques. Lévis devait attendre des renforts de France avant de lancer l'assaut
décisif: ils n'arrivèrent jamais, l'incompétent ministre
Berryer ayant trouvé le moyen
de faire partir en retard les navires promis avec les 400 hommes. Les premiers navires qui se présentèrent à l'embouchure du
Saint-Laurent arboraient le pavillon anglais...
- La capitulation de
Montréal
L'objectif des Britanniques pour la
campagne de 1760 était la prise de Montréal, dernier bastion français en
Amérique du Nord ; le commandant en chef de l'armée britannique, Jeffrey
Amherst, ordonna au général James Murray de remonter le Saint-Laurent avec ses
troupes. Murray s'installa à Longueuil, en face de Montréal, avec son armée en attendant celle
d'Amherst et celle de William Haviland.
Le lendemain, le 6 septembre, l'armée britannique,
qui comptait 17 000 hommes, se présenta devant les remparts de Montréal.
Les Britanniques et les Français parlementèrent au cours de la journée du 7
septembre. Le général Jeffrey Amherst (le successeur de James Wolfe) avait prévenu
les défenseurs français qu'il était prêt à tout: «Je suis venu prendre le Canada
et je ne me contenterai de rien de moins.» Le 8 septembre 1760, sans avoir livré bataille
mais voulant protéger les droits des Canadiens, leur intégrité physique, leurs
biens, leur religion et leurs lois,
le gouverneur général de Vaudreuil se résolut à signer la capitulation (voir
le texte des 55 articles) du Canada, de
l'Acadie française et des postes de l'Ouest (les Pays-d'en-Haut) aussi éloignés que le «Pays des Illinois».
Signèrent le général en chef Amherst et le gouverneur général Vaudreuil.
Ce traité de capitulation était rigoureux
pour les militaires français : Amherst refusa d'accorder à l'armée française les
honneurs de la guerre. L'armée française devait immédiatement se rembarquer pour
la France. Quant aux fonctionnaires civils qui n'étaient pas canadiens, ils
devaient aussi rembarquer pour la France avec leurs familles. Les Acadiens, qui
s'étaient réfugiés au Canada pour éviter une déportation toujours en exercice,
ne reçurent aucune garantie (art. 39). Les habitants canadiens avaient la
possibilité de rentrer en France, s'ils le désiraient. S'ils restaient, la
capitulation leur assure la possession des biens tant seigneuriaux que
roturiers. Les autochtones étaient maintenus sur les terres qu'ils habitaient.
Les articles 27 à 36 garantissaient le libre exercice de la religion catholique.
Pour ce qui est de la nomination du futur évêque (Mgr Pontbriand venant de
décéder) et de ses pouvoirs, Amherst écrit en marge de l'article 30 : Refusé. Il
refusa de se prononcer sur deux autres demandes importantes : que les Canadiens
continuent de jouir de la Coutume de Paris (c'est-à-dire les lois françaises) et
qu'ils ne soient pas obligés de prendre les armes contre la France. Amherst se
contente de répondre qu'ils deviennent sujets du roi d'Angleterre.
S'il voulait éviter un véritable bain de sang et la dévastation complète du
Canada, les Britanniques ayant déjà démontré leur férocité en Acadie avec la
déportation des Acadiens, le gouverneur général de la Nouvelle-France n'avait plus d'autre choix. Exaspéré d'une si longue lutte, le général Amherst refusa «fort incivilement»
aux troupes françaises les «honneurs de la guerre». Humilié, le chevalier de
Lévis brûla les drapeaux français plutôt que de les remettre aux Anglais.

- La fin des
alliances franco-amérindiennes
Alors que la guerre de la Conquête se
poursuivait, la fin des alliances franco-amérindiennes était commencée. Dès le
mois d'avril 1759, plusieurs représentants des Mohawks du Sault-Saint-Louis
(devenu Caughnawaga,
puis Kahnawake) présentèrent des propositions de paix aux Britanniques,
qui les acceptèrent. En avril 1760, le général Jeffrey Amherst rédigea une
proclamation destinée à gagner à sa cause les alliés indiens de la France. Il
déclara que Sa Majesté ne l'avait pas envoyé pour priver les Indiens de leurs
terres ou de leurs biens et promit que, en retour pour leur soutien, les Indiens
conserveraient les droits qui leur reviennent, y compris leurs territoires de
chasse. Lors d'une rencontre le 30 août à Oswegatchie (ancien fort Lévis,
aujourd'hui Johnstown, Ontario) avec les «Indiens domiciliés», c'est-à-dire ceux
qui habitaient Lorette, Odanak, Wôlinak, Sault-Saint-Louis, les Deux-Montagnes
(Oka) et Akwesasne (Ontario), William Johnson, colonel et commissaire aux
Affaires indiennes, sut habilement les convaincre de rester neutres durant la
guerre en retour de la promesse de ne pas être traités comme des ennemis par la
suite.
Le 5 septembre 1760, pendant que le
général Murray attendait l'ordre de fondre sur Montréal, une quarantaine de
Hurons combattant pour les Français avaient décidé de rendre les armes, de
quitter Montréal et de conclure
une paix séparée en se rendant auprès du général anglais, afin de se «soumettre à
Sa Majesté britannique» pour retourner sains et saufs chez eux à Lorette (près
de Québec), où vivait le reste de la tribu composée d'une centaine de personnes.
Pour ce faire, il leur fallait un sauf-conduit que le général Murray leur
accorda (voir le texte). Quelques
semaines auparavant, les mêmes Hurons avaient participé à la bataille de
Sainte-Foy; ils estimaient avoir des raisons pour craindre la vengeances des
Britanniques.
Après la capitulation de Montréal, le 8
septembre 1760, soit les 15 et 16 septembre, les délégués des Sept-Nations
signèrent un traité (comprendre un échange de colliers de wampum ou
enfilade de coquillages) en présence des Anglais à
Caughnawaga officialisant leur
neutralité. Dans une lettre au premier ministre britannique, William Pitt,
William Johnson confirma que les Indiens avaient ratifié le traité. La guerre
avec les Indiens était terminée... jusqu'à la révolte du chef Pontiac dans les
Pays-d'en-Haut. Pour les Français,
il leur fallait attendre le traité de Paris du 10 février 1763.
1.3 Les conséquences
immédiates de la guerre
Le 18 octobre,
le gouverneur Pierre Rigaud de Vaudreuil partit de
Québec sur un navire britannique et débarqua à Brest le 28 novembre. Louis XV rendit Vaudreuil personnellement responsable
d'avoir capitulé «sans les honneurs de la guerre», ce qui était considéré à
l'époque comme
une infamie qui frappait toute l'armée française. Le dernier gouverneur de la
Nouvelle-France, un Canadien, devait payer pour cet échec militaire
déshonorant. Enfermé à la Bastille, Vaudreuil allait être
finalement disculpé de toute accusation, le 10 décembre 1763, après un interminable procès
de deux ans, l'un des plus fameux du siècle, et quinze
mois de détention, par le tribunal du Châtelet qui jugea l'«Affaire du Canada».
Le roi voulut faire la lumière sur la corruption qui aurait contribué à la
perte du Canada. En conséquence, les hauts fonctionnaires français rapatriés furent tous appelés
à comparaître et certains furent condamnés, dont l'ex-intendant François Bigot,
à «1000 livres d'amende, à un million et demi de restitution, à la confiscation
de ses biens et au bannissement à vie».
En septembre 1764, Louis XV permit à Vaudreuil de recevoir la grand-croix de l'Ordre de
Saint-Louis, qui lui avait été décernée en 1756-1757, mais que l'on avait
jusque-là différé de lui remettre. Le marquis de Vaudreuil allait décéder en 1778
à l'âge de 80 ans au château de Colliers à Muides-sur-Loire (près de Chambord).
- La nouvelle
puissance dominante
Au point de vue diplomatique, la
Grande-Bretagne s'imposait dorénavant comme la plus grande puissance mondiale.
Sa flotte et son armée lui permettaient de contrôler toute l'Amérique du Nord et
l'Inde, ainsi que la plupart des mers du monde. Quant à la France, elle sortait très
affaiblie par le conflit.
Pour certains historiens, la perte de la Nouvelle-France constitue dans
l'histoire de la France «la plus grande défaite du monde français». La monarchie
française ne s'en remit jamais. Par
comparaison, les défaites de Napoléon peuvent être considérées comme
«négligeables». Mais pour la France, la perte de la Nouvelle-France semblait minime en
comparaison de ce que serait la perte des Treize Colonies de la
Nouvelle-Angleterre pour la
Grande-Bretagne. Douze ans plus tard, ces colonies se
soulèveront contre la mère patrie et ce sera grâce au soutien de la marine
française qu'elles pourront accéder à l'indépendance.
Ironie du sort, la Grande-Bretagne
allait perdre les Treize Colonies qu'elle détenait depuis longtemps, pour ne
conserver essentiellement que les anciennes possessions françaises : l'Acadie,
l'île du Cap-Breton, l'île Saint-Jean (île du Prince-Édouard), le Canada et la
colonie de Terre-Neuve (Plaisance).
- Les exactions et
les destructions
Cependant, les méthodes des
Britanniques en Nouvelle-France furent aussi extrêmement cruelles lors de cette
longue guerre. Il suffit de penser à la déportation des Acadiens et l'incendie
de leurs fermes et de leurs maisons, sans oublier la façon dont les Britanniques
ont traité les civils en les entassant comme du bétail dans des navires infects
pour les envoyer «en territoire ennemi», en séparant les familles, alors que la
moitié des déportés allait mourir de maladies et de privations. Au Canada, les
troupes du général Wolfe furent aussi sans pitié. Wolfe avait comme mission de «nettoyer les côtes», ce qu'il fit
avec un zèle ravageur. La moitié des villes du Canada fut détruite, la plupart des maisons
et des fermes le long du Saint-Laurent ont été incendiées. Le général Wolfe avait
mis à contribution les Rangers de la Nouvelle-Angleterre, dont la mission était
d'incendier et de détruire sur leur passage toutes les habitations, de tuer tout
le bétail et les chevaux, et de ravager entièrement les campagnes.
En route vers
Québec, alors qu'il traversait l'Atlantique, James Wolfe avait pris la décision, à bord du Neptune, un navire de guerre de 90 canons, de
dévaster le pays. Voici ce qu'il écrivait à Amherst le 6 mars 1759, démontrant
ainsi bien sa résolution dans un contexte qui avait été celui de la déportation
des Acadiens :
| If, by accident in
the river, by the enemy's resistance, by sickness or slaughter in
the army, or, from any other cause, we find that Quebec is not
likely to fall into our hands (persevering however to the last
moment), I propose to set the town on fire with shells, to destroy
the harvest, houses and cattle, both above and below, to send off as
many Canadians as possible to Europe and to leave famine and
desolation behind me; but we must teach these scoundrels to make war
in a more gentleman like manner. |
[ S'il
arrivait que, soit lors d'un accident maritime, soit par résistance
de l'ennemi, soit par maladie, soit que nos troupes aient été
décimées, nous réalisions que Québec malgré tous nos efforts, a peu
de chance de tomber entre nos mains (en persévérant cependant
jusqu'au dernier moment), je me propose de l'incendier par nos tirs
de boulets, de détruire les récoltes, les maisons et le bétail, tant
en aval qu'en amont, d'exiler le plus grand nombre possible en
Europe, et de ne laisser derrière moi que famine et désolation; mais
nous devons apprendre à ces crapules à faire la guerre d'une manière
qui soit plus digne d'un gentilhomme.] |
Wolfe mit ses menaces à exécution, mais
non à la manière d'un gentilhomme. Non seulement le général anglais n'épargna aucune ferme sur les
deux côtés du Saint-Laurent, mais les habitants qui résistèrent furent aussitôt
tués, parfois pendus haut et court s'ils étaient pris avec des armes à la main.
Wolfe n'hésita pas à l'occasion de demander à ses Rangers de scalper «à
l'indienne» les habitants. Il fit incendier les villages abandonnés, même
vides de femmes, d'enfants et de vieillards. Il ne faut pas oublier qu'il ne
restait plus beaucoup d'hommes valides dans les campagnes. Tous ceux qui étaient
en état de porter les armes, y compris de nombreux Acadiens, étaient rassemblés
à Québec, à Carillon, sur le lac Ontario, à Niagara, dans les postes du lac Érié
et de la partie de la vallée de l'Ohio. La ville de Québec fut pratiquement
rasée, alors que l'armée française était stationnée à Beauport, et qu'il ne
restait essentiellement que des civils à l'intérieur des fortifications.
Le Canada vit périr le dixième de sa population.
Avant de prendre Québec, James Wolfe
envoya aux Canadiens, à partir de l'île d'Orléans où son armée était cantonnée,
un «Manifeste» destiné à assurer leur neutralité, sinon à les terroriser (voir
le texte en cliquant ICI, s.v.p.). Ce Manifeste était un leurre, car
Wolfe avait semé la désolation des deux côtés du fleuve, alors que la plupart
des habitants demeuraient impassibles et impuissants. Le 24 mai 1758, Wolfe
exprimait ainsi ses sentiments de vengeance au lieutenant-général George
Sackville:
| It would give me
pleasure to see the Canadian vermin sacked and pillaged and justly
repaid their unheard-of cruelty. |
[J'aurai
plaisir, je l'avoue, à voir la vermine canadienne saccagée, pillée
et justement rétribuée de ses cruautés inouïes.] |
La vengeance constituait une bonne
partie des motivations de Wolfe qui écrivit que, si les Français continuaient
d'employer les «Sauvages», il ferait fusiller tous les prisonniers de guerre, que
ce soit des Français ou des Canadiens. On sait que le général
Wolfe, lui-même un gentilhomme et un chrétien, sachant aussi parler le français
qu'il avait appris à Paris au cours de l'hiver 1752-1753, était rempli de haine et de
fanatisme contre les Français et surtout contre la religion qu'ils pratiquaient. Il avait
maintenant l'occasion d'assouvir sa vengeance. Wolfe avait écrit le 22 août:
«J'ai l'intention de brûler toute la campagne depuis Kamouraska jusqu'à
Pointe-Lévy.» L'entreprise de destruction (plus de 4000 fermes), qui dura tout le
mois d'août et une partie du mois de septembre de 1759. Seules les églises
furent épargnées, parfois les presbytères. Durant toutes ces semaines, la fumée des fermes en feu
obscurcit constamment le ciel du Saint-Laurent. De plus, le général obligea les
soldats britanniques à des actes abominables, dont des viols, des tortures, des
scalps, des massacres, etc., une boucherie incroyable contre des civils. La
plupart des soldats ne les ont probablement pas commis de bonne grâce. Chose
certaine, George Townshend, qui prit le commandement de l'armée britannique après
la mort de Wolfe, le désapprouvait, de même qu'une bonne partie des officiers
britanniques. Ainsi, James Gibson, aumônier naval des forces britanniques, écrivit,
horrifié :
|
I fear that the campaign ended
in the total ruin of this country. We have burned all wheat fields on
foot and all the houses on each side of the River 30 miles which means
all lands inhabited up to Quebec. |
[Je crains que la campagne
ne se solde par la ruine totale de ce pays. Nous avons brûlé
tous les champs de blé sur pied et toutes les maisons sur 30 milles
de chaque côté du fleuve, ce qui veut dire toutes les terres
habitées jusqu'à Québec.] |
S'il y avait eu à l'époque la notion de
«crime de guerre», Wolfe aurait sûrement comparu devant un tribunal
international.
À l'automne de 1758, en
Nouvelle-Écosse, les troupes de
Robert Monckton (Moncton) avaient procédé
méthodiquement à la destruction des maisons, du bétail et des
récoltes des Acadiens. Les Canadiens savaient que les généraux qui avaient pris
Québec étaient ceux qui avaient orchestré la déportation des Acadiens et saccagé
l'Acadie, donc qu'ils pouvaient commettre les mêmes exactions au Canada :
Robert Monckton, le bras droit de Wolfe, en avait été le concepteur, assisté par
James Murray,
puis Jeffrey Amherst, le grand patron responsable de la décision finale, appelé «le
Brûlot» par les Acadiens. Les
Canadiens avaient des motifs d'avoir peur, d'autant plus que les mœurs de
l'époque n'étaient pas particulièrement tendres, mais féroces et barbares.
Avant de prendre Québec, Wolfe fit
bombarder la ville durant deux mois et demi; la ville fut presque entièrement
détruite. Pourtant, Wolfe savait que ses habitants avaient été évacués, de même
que les troupes françaises. Les historiens se sont demandé pourquoi le général
Wolfe s'était autant acharné sur Québec. C'était évidemment pour forcer Montcalm à
intervenir et le sortir de ses retranchements.
Il est probable que les mêmes atrocités
auraient pu être perpétrées
par les Français. Depuis le mandat de Frontenac, les incendies, les meurtres et
les scalps étaient monnaie courante en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre. Il est manifeste que les raids français à
l'encontre des colonies anglaises avaient laissé des traces indélébiles. Il n'en
demeure pas moins que la politique de dévastation systématique du général Wolfe suscite
encore aujourd'hui un certain malaise. Quant aux Amérindiens, ils ne
représentaient plus rien pour les Britanniques, le génocide allait pouvoir
commencer.
- Les décès et les
départs
Le Canada avait perdu,
on le sait, au cours de cette
guerre le dixième de sa population, soit plus de 7000 personnes, d'après les
historiens. En réalité, la population enregistra un recul de 10 000 personne sur
un total de 70 000 en raison des décès dus aux maladies et à la famine. Les mœurs de l'époque n'étaient pas
très édifiantes en temps de guerre, et les Britanniques allaient utiliser les
mêmes exactions contre les colons de la Nouvelle-Angleterre lors de la guerre
d'Indépendance, en détruisant leurs fermes et leurs récoltes. Quant ils
voulaient gagner, les Britanniques ne faisaient pas de quartier. Ils se
comportaient comme les «Sauvages» dont ils dénonçaient la férocité. À la fin de
la guerre, ce sont les populations civiles qui avaient payé le lourd tribut des
exactions anglaises, l'armée française étant sortie pratiquement indemne, bien
que grandement humiliée.
Il y a eu
aussi les départs de Français et de Canadiens du pays. L'article 4 du
traité de Paris de 1763 accordait
dix-huit mois aux habitants pour vendre leurs biens et quitter le pays en toute
liberté, s'ils le souhaitaient. Dans les faits, une assez grande liberté de
circuler semble avoir subsisté au-delà de cette date limite. Quant au nombre
total des départs, il demeure assez difficile à évaluer. Dès la
capitulation de Québec (1759), quelque 1200
marins et officiers de la marine marchande avaient quitté la colonie, sans compter
un certain nombre d'administrateurs, de civils et de négociants français.
Après la capitulation générale de Montréal (1760), plus de 2560 officiers
et soldats, accompagnés de leur suite, s'embarquèrent pour la France sur
22 navires. Toute la noblesse française (env. 200 personnes) quitta le pays,
ce qui représente une véritable décapitation;
seule la
noblesse canadienne resta. Il faudra deux ou trois générations avant que
les Canadiens ne se donnent de nouveaux leaders. Entre 1754 et 1770, plus de 4000 Canadiens de
naissance ou établis par mariage allaient aussi quitter le Canada, ce qui
représentait néanmoins 5,7 % de la population (sur 70 000). Ces Canadiens
et Français allaient
se disperser dans l'ensemble du royaume de France et dans les autres colonies
françaises. Cependant, en vertu du traité («Capitulation de
Montréal») conclu entre le gouverneur général Pierre de Rigaud de Vaudreuil et
le général Jeffrey Amherst, ceux qui restaient au pays devenaient ipso facto
des sujets britanniques:
|
Article XLI
Les
François, Canadiens et Acadiens, qui
resteront dans la colonie, de quelque état
et condition qu'ils soient, ne se seront ni
ne pourront être forcés à prendre les armes
contre Sa majesté très Chrétienne ni ses
Alliés, directement ni indirectement, dans
quelque occasion que ce soit; le
gouvernement britannique ne pourra exiger
d'eux qu'une exacte neutralité. Ils
deviennent sujets du Roi. («Capitulation de
Montréal») |
Amherst reconnaîtra, dans les ordres
généraux adressés à ses troupes, que les Canadiens
étaient devenus, en raison de leur défaite, des
«sujets britanniques» et qu'en conséquence ils
avaient le droit à la protection du souverain
anglais.
|

Jeffrey
Amherst |
Après la
capitulation de Montréal (1760) par le gouverneur Vaudreuil, les
Britanniques prirent le commandement de la colonie de ce qui était encore
juridiquement la Nouvelle-France.
Pendant que se poursuivait l'occupation
militaire du Canada, le général anglais Jeffrey Amherst, le successeur de Wolfe, procéda à l'organisation d'un régime
administratif provisoire, car, tant que la guerre continuait en Europe, le
sort du pays demeurait incertain. Jeffrey Amherst fut
le premier gouverneur sous
le régime de la loi martiale au Canada, soit de 1760 à 1763.
En 1761, les francophones formaient 99,7 % de la population; le poids
du nombre interdisait aux Anglais de pratiquer une politique colonisatrice
trop radicale. Le nombre d'anglophones n'était en effet pas très élevé, il
ne dépassait pas les 600 en 1765. |
Pragmatique, le conquérant adopta le statu quo.
Étant donné que le peuple ne pouvait obéir aux ordres que s'il les
comprenait, les autorités britanniques émirent leurs ordonnances en
français et permirent aux Canadiens d'occuper de nombreux postes dans
l'administration et la justice.
2.1 Le maintien du
français par défaut
L'administration de la
colonie conquise
s'organisa donc en français, par défaut peut-on dire. D'ailleurs, gouverneurs et officiers supérieurs
étaient bilingues et pouvaient communiquer directement avec les Canadiens. Les actes notariés continuèrent d'être rédigés en
français, de même que les registres de l'état civil tenus par les curés.
Autrement dit, rien ne paraissait avoir changé. Cependant, la connaissance de la langue anglaise
allait devenir dorénavant
très utile pour assurer la promotion sociale et économique; l'élite
canadienne se mit lentement à l'apprentissage de la nouvelle langue.
2.2 L'organisation administrative
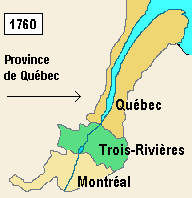 |
Au point de vue administratif,
la colonie fut divisée en trois entités
distinctes, qui correspondaient aux trois anciens gouvernements de Québec, des
Trois-Rivières et de Montréal. La différence, c'est qu'il s'agissait de
trois «pays» maintenant distincts, chacun ayant sa capitale (Québec,
Trois-Rivières et Montréal), son
administration propre, son armée, etc.
Pour passer d'un secteur à l'autre, il fallait
un passeport accordé par le gouverneur du lieu, car les frontières étaient protégées par des garnisons militaires.
Même l'Église catholique ne pouvait plus désigner un représentant unique qui
pouvait exercer une autorité sur l'ensemble des trois colonies. |
2.3 La nouvelle monnaie
|
1 denier |
= |
monnaie de cuivre |
00,02 $ |
|
1 sol (sous) |
= |
12 deniers |
00,20 $ |
|
1 livre |
= |
20 sols ou 240
deniers |
03,75 $ |
|
1 écu |
= |
6 livres en or |
22,50 $ |
|
1 louis d'or |
= |
4 écus |
90,00 $ |
|
Il en était ainsi de la
monnaie qui était plus ou moins différente selon les trois secteurs
de la colonie. Durant le régime
militaire, la monnaie française et la monnaie anglaise étaient
toutes deux acceptées. Mais le tout devenait complexe
à comptabiliser.
Ainsi, la livre sterling en argent, la pound, suivait un cours différent à
Québec (cours d'Halifax), à Montréal (cours de New York) et aux
Trois-Rivières (les deux cours). À Québec, la livre anglaise valait
24 livres françaises; à Montréal, 14 livres françaises.
|
De plus, la livre française était une monnaie «imaginaire» (une monnaie de
compte), car aucune pièce d'une livre n'a été émise ni mise en circulation.
Il fallait
distinguer aussi les écus en or, les écus en argent, les sols (ou
sous), dont les sols «vieux» et les sols «marqués», les
liards (le quart d'un sol), les louis, les deniers, les pistoles (10
livres), sans oublier la
piastre (piastra) espagnole, la piastre (piastra) portugaise, la guinée
(guinea) anglaise, etc.
Il fallait 12 deniers pour faire un sol (ou sous), 3 deniers pour un
liard, mais 20 sols ou 240
deniers pour faire une livre française, 120 sols (ou 4 x 30 sols) pour une
piastre espagnole. Pour les monnaies les plus élevées, un écu valait 6 livres en
or et 1 louis d'or valait 4 écus. Il fallait distinguer aussi le louis d'or
(double-louis, louis et demi-louis) valant 24 livres et le louis d'argent (demi-écu de 30 sols,
quart d'écu de 15 sols, sixième d'écu de 10 sols, douzième d'écu de 5 sols). Comme si ce n'était pas suffisant, les pièces
ne portaient pas toutes un chiffre pour en indiquer la valeur, ce qui impliquait
d'interminables discussions et variations dans les échanges commerciaux; il
fallait donc peser les pièces. En
fait, comme en France, le denier étant la monnaie courante, la livre de 240
deniers (20 sols) jouait le rôle de monnaie de compte.
Après la signature du
traité de Paris de 1763, la livre sterling remplaça définitivement la
monnaie française en étant subdivisée en 20 shillings (ou chelins),
chacune de 12 pence (singulier : un penny), avec la piastre espagnole circulant à une valeur de
5 shillings (selon le cours d'Halifax). La guinée anglaise valait 21 shillings
ou une livre et un shilling, alors que la livre anglaise valait 240 pence. Le
système monétaire anglais connaissait aussi le mark qui valait les deux tiers
d'une livre, un mark équivalait à 160 pennies ou à 13 shillings et 4 pennies.
Évidemment, c'était avant la décimalisation des monnaies.
De cette courte période militaire, il n'y que peu à dire dans la mesure où
une sorte de statu quo
se perpétuait.
En réalité, Londres a laissé perdurer le système français durant environ cinq
années, c'est-à-dire jusqu'à ce que le gouverneur James Murray réorganise la
colonie.
Avec le
traité de Paris du 10 février 1763,
l'empire français en Amérique était définitivement terminé, y compris la
Louisiane qui était devenue espagnole. Seules les îles Saint-Pierre et Miquelon
restaient françaises. Forcément, les articles de la capitulation de Montréal
devenaient caducs comme clauses temporaires et transitoires.
Les capitulations de Québec (voir
le texte original) et de Montréal (voir
le texte) furent rédigées
en français, ainsi que le
traité de Paris de 1763. Donc, les documents officiels
qui ont fait du Canada une colonie britannique ont été rédigés en
français, même si la France avait perdu la guerre. Voici ce qu'on peut lire dans un article séparé (art. 2) au
sujet de la langue:
|
Article séparé - 2
Il a été convenu et arrêté que la
Langue Françoise,
employée dans tous les Exemplaires du présent Traité, ne formera point
un Exemple, qui puisse être allégué, ni tiré à conséquence, ni porter
préjudice, en aucune Manière, à aucune des Puissances Contractantes; Et
que l'on se conformera, à l'avenir, à ce qui a été observé, et doit être
observé, à l'égard, et de la Part, des Puissances, qui sont en usage, et
en Possession, de donner, et de recevoir, des Exemplaires, de semblables
Traités, en une autre Langue que la Françoise.
|
Ce genre de disposition
n'a rien à voir avec un quelconque droit linguistique. Cet article ne concerne
que la langue du traité. Bref, aucune garantie n'est accordée à la langue
française, ni aux lois de la Coutumes de Paris. Les droits concernent le libre
possession des biens, la liberté du commerce, la liberté d'émigrer au cours des
dix-huit prochains mois et le libre exerce de la religion catholique, mais
uniquement dans la mesure où le permettent les lois de l'Angleterre.
3.1 Le choix
de la France
Dans un premier
temps, Louis XV tenta d'échanger le Canada contre l'île du Cap-Breton jugée plus
rentable que le Canada. Dans son Mémoire historique sur la négociation de la
France et de l'Angleterre, depuis le 26 mas 1761 jusqu'au 20 septembre de la
même année, le duc de Choiseul que le roi de France était prêt à renoncer au
Canada moyennement dédommagement:
|
La liberté de la pêche et
un abri sans fortification étaient la compensation de la cession totale
du Canada. |
Le
général
James Murray, l'un des
principaux acteurs anglais de la Conquête, avait confié en juin 1760 à un officier
français du régiment de Béarn
qu'il avait en haute estime,
Maurès de Malartic (1730-1800),
au sujet des intentions des Anglais pour le
Canada:
|
Si nous sommes sages, nous ne le garderons pas. Il faut que la
Nouvelle Angleterre ait un frein à ronger et nous lui en donnerons
un qui l'occupera en ne gardant pas ce pays-ci. |
Au cours des
négociations de paix de l'été 1761,
le duc Étienne-François
de Choiseul fit
une confidence au négociateur britannique, Hans Stanley (1721-1780), qui mérite d'être
rapportée:
|
Je m'étonne que votre grand Pitt attache tant d'importance à
l'acquisition du Canada, territoire trop peu peuplé pour devenir
jamais dangereux pour vous, et qui, entre nos mains, servirait à
garder vos colonies dans une dépendance dont elles ne manqueront pas
de s'affranchir le jour où le Canada sera cédé.
|
De son côté, le ministre
William Pitt
se considérait vainqueur de la guerre de Sept-Ans (1756-1763). En tant que tel,
il se montra intraitable. La Grande-Bretagne avait raflé la mise. Non seulement,
elle avait conquis le Louisbourg, le Canada et l'Acadie, mais elle venait de
prendre le contrôle des «îles à sucre», c'est-à-dire la Martinique et la
Guadeloupe, ainsi que leurs dépendances. Bref, toutes les
possessions
françaises, y compris Belle-Île au sud de la Bretagne, se trouvaient entre les
mains du roi George III. Toutefois, le roi anglais ne pouvait tout garder sans
s'aliéner l'appui des autres puissances européennes. Son sens politique lui
dictait une certaine modération. Il accepta donc de rétrocéder à la France des
colonies, sans préciser lesquelles. Louis XV s'est trouvé à devoir choisir entre
le Canada ou les Antilles !
- Les «îles à sucre»
plutôt que le Canada
Louis XV a préféré
céder le Canada pour conserver plutôt les «îles à sucre» des Caraïbes, notamment la Guadeloupe, la
Martinique, Sainte-Lucie et surtout Saint-Domingue (Haïti), considérées au plan
économique comme des colonies rentables.
Par exemple, les seules
exportations de sucre de la Guadeloupe rapportaient deux fois plus que toutes
les exportations de fourrure du Canada
considéré, pour sa part, comme une vaste
territoire glacé et sans importance stratégique.
La canne à sucre était au
XVIIIe
siècle un peu ce que sera le pétrole au
XXe
siècle!
D'ailleurs, de
nombreux hommes d'affaires ainsi que des politiciens britanniques auraient
préféré, eux aussi,
conserver les Antilles, qu'ils avaient capturées et enlevées à la France, et
rendre par le fait même le Canada aux Français.
Lors des pourparlers de
paix, qui se déroulèrent de 1762 et 1763, la France ne revendiqua jamais le Canada; il n'en fut même
pas question. Le 22
février 1762, le secrétaire d'État britannique,
lord Egremont, reçut une lettre de la main du duc Étienne-François de
Choiseul déclarant
clairement que le roi de France «trouve juste que l'Angleterre conserve le
Canada», mais qu'il voulait en dédommagement «la restitution de la Martinique et
de la Guadeloupe». Les îles en question allaient être rendues à la France, et
l'Angleterre allait garder le Canada.
En fait,
la perte du Canada pouvait constituer une douce revanche pour la
France, en favorisant la querelle entre les colonies britanniques et la
Grande-Bretagne. C'était comme une sorte de
prix de consolation. Au moment de signer
le
traité de Paris de 1763, le comte César-Gabriel de Choiseul aurait chuchoté à
son entourage: «Nous les tenons», en parlant des Britanniques.
C'est Louis XVI qui allait prendre prendre sur lui la revanche de la France lors
de l'indépendance américaine de 1783.
C'est le
traité de Paris, signé et négocié au
nom de Louis XV par le ministre des Affaires étrangères (13 octobre 1761
- avril 1766), le comte César-Gabriel de Choiseul (1712-1785), duc de Praslin
— à distinguer de son cousin le duc
Étienne-François de
Choiseul —, qui
scella définitivement le sort du Canada et de la Nouvelle-France, et non pas les batailles perdues ou gagnées
en Amérique ou en Europe! Les article 4 et 8 du
traité de Paris sont
révélateurs:
|
Article 4
Sa Majesté Très Chrétienne
renonce
à toutes les prétentions qu'Elle a formées autrefois, ou pû former, à la
Nouvelle Écosse ou l'Acadie [...] De plus Sa Majesté Très Chrétienne
cède
et garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute propriété, le Canada
avec toutes ses dépendances, ainsi que l'île du Cap Breton, et toutes
les autres iles, et côtes, dans le golphe et fleuve St Laurent [...].
Article 8
Le Roi de la Grande Bretagne
restituera
à la France les isles de la Guadeloupe, de Marie-Galante, de la
Désirade, de la Martinique et de Belle-Isle [...]. |
Les termes employés dans le
traité de Paris en disent long
sur le rapport de force jouant en faveur de la Grande-Bretagne: le roi français
renonçait à ses prétentions sur l'Acadie, et cédait le Canada qu'il
n'avait plus, tandis que le roi anglais restituait des colonies qu'il occupait.
Autrement dit,
Louis XV renonçait au Canada, même si on ne l'y forçait pas, et jetait son
dévolu sur les îles sucrières.
- Un bon débarras!
Contre toute attente, le traité de Paris fut plutôt
bien accueilli en France. En février 1763, quelques semaines avant la
signature du traité de Paris, Voltaire, qui n'avait jamais aimé le Canada, avait
écrit cette lettre au duc Étienne-François de Choiseul, alors ministre de la
Guerre:
|
Le 6 septembre
1762
Monseigneur,
Préoccupé
dans la crise des affaires où vous êtes, je
voudrais vous faire entendre ma voix et
celles de beaucoup d'étrangers. Je suis
comme le public, j'aime mieux la paix que le
Canada et je crois que la France peut être
heureuse sans Québec. Recevez, avec votre
compréhension ordinaire, le profond respect
de Voltaire. |
Dans son dernier rapport à Louis XV en
1770, alors qu'il quittait ses fonctions, le duc de
Choiseul écrivit qu'il n'y
avait aucun regret à avoir abandonné le Canada : «Je crois que je puis avancer
que la Corse est plus utile de toutes les manières à la France que ne l'était ou
ne l'avait été le Canada.» La Corse avait été achetée aux Génois en 1768 —
pour 200 000 livres tournois, somme devant être payée chaque année pendant dix
ans —
afin de
rétablir la maîtrise de la France en Méditerranée. En réalité, les Français
n'étaient pas malheureux d'avoir perdu le Canada, mais ils étaient humiliés d'avoir été
«vaincus» par la Grande-Bretagne. Même les Britanniques eurent du mal à croire
que la France avait abandonné le Canada si aisément.
La France avait
pourtant engagé en 1759 plus de 25 millions de livres françaises pour le Canada,
mais elle était maintenant à court d'argent et de vaisseaux, la guerre en Europe
accaparant toutes les énergies.
Pour la France, le
Canada était avant tout un gouffre financier; il coûtait plus cher qu'il ne
rapportait, surtout depuis la perte de Louisbourg, la seule colonie rentable de
toute la Nouvelle-France!
Bref, c'était un bon débarras!
- Un choix stratégique
pour les
Britanniques
Le ministre
Choiseul
n'avait pas
compris que les Britanniques voulaient le Canada avant tout comme base
stratégique, c'est-à-dire une tête de pont, pour se défendre dans les guerres à venir contre
les Treize Colonies. Les 70 000
habitants de la vallée du Saint-Laurent pourraient fournir à l'armée britannique
une partie de la logistique dont elle aurait besoin dans l'éventualité d'une
guerre majeure contre les Yankees.
La prédiction de Choiseul à Hans Stanley, le chargé d'affaires pour la
Grande-Bretagne en France, allait se
réaliser quinze ans plus tard. Mais, pour le moment, ce fut
la vision expansionniste et belliciste du diplomate américain Benjamin Franklin, qui l'emporta, car
celui-ci avait convaincu les
ministres britanniques que jamais les Treize Colonies ne se ligueraient contre
«leur propre nation» et qu'il faudrait plutôt que la mère patrie se comporte de
façon très hostile pour envisager un tel scénario invraisemblable, par exemple
en remettant le Canada à la France. Pourtant, les Treize Colonies allaient se
révolter contre la Grande-Bretagne dès 1775. Franklin sera même l'un des plus ardents
partisans de l'indépendance et de la
rébellion contre l'Angleterre.
Si Montcalm
avait gagné la bataille des Plaines, il n'est pas certain que la Grande-Bretagne aurait été
en mesure de répéter l'expérience l'année suivante (1760), compte tenu de l'énorme effort
entrepris en 1759. Dans l'éventualité d'une victoire des Français, il en aurait
résulté un grand désarroi tant en Grande-Bretagne qu'en Nouvelle-Angleterre, ce
qui aurait contribué à changer le cours des événements, mais ce n'est pas ce qui
s'est passé.
Les
Britanniques ont donc conservé le Canada, mais ils ont accordé aux Français des droits de
pêche au large des côtes de Terre-Neuve.
Dès les négociations avec la Grande-Bretagne en 1761, les représentants du
gouvernement français avaient affirmé que la pêche à Terre-Neuve demeurait plus
précieuse que le Canada et la Louisiane réunis «comme source de richesse et de
puissance».
L'honneur était sauf pour la France.
- La garantie des droit
civils et religieux
En acceptant les capitulations de Québec
et de Montréal, les successeurs de Wolfe avaient
garanti les droits civils et religieux, ainsi que les propriétés des Canadiens.
|
Article 4
Sa Majesté Très
Chretienne renonce à toutes les Pretensions, qu'Elle a formées
autrefois, ou pû former, à la Nouvelle Ecosse, ou l'Acadie, en toutes
ses Parties, & la garantit toute entiere, & avec toutes ses Dependances,
au Roy de la Grande Bretagne. De plus, Sa Majesté Trés Chretienne cede &
garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute Proprieté, le Canada
avec toutes ses Dependances, ainsi que l'Isle du Cap Breton, & toutes
les autres Isles, & Côtes, dans le Golphe & Fleuve S' Laurent, &
generalement tout ce qui depend des dits Pays, Terres, Isles, & Côtes,
avec la Souveraineté, Proprieté, Possession, & tous Droits acquis par
Traité, ou autrement, que le Roy Très Chretien et la Couronne de France
ont eus jusqu'à present sur les dits Pays, Isles, Terres, Lieux, Côtes,
& leurs Habitans, ainsi que le Roy Très Chretien cede & transporte le
tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la
Maniere & de la Forme la plus ample, sans Restriction, & sans qu'il soit
libre de revenir sous aucun Pretexte contre cette Cession & Garantie, ni
de troubler la Grande Bretagne dans les Possessions sus-mentionnées. De
son Coté Sa Majesté Britannique convient d'accorder aux Habitans du
Canada la Liberté de la Religion Catholique; En Consequence Elle donnera
les Ordres les plus precis & les plus effectifs, pour que ses nouveaux
Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion
selon le Rit de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de
la Grande Bretagne.-Sa Majesté Britannique convient en outre, que les
Habitans François ou autres, qui auroient eté Sujets du Roy Très
Chretien en Canada, pourront se retirer en toute Sûreté & Liberté, où
bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourvû que ce soit à
des Sujets de Sa Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi
que leurs Personnes, sans être genés dans leur Emigration, sous quelque
Pretexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procés
criminels; Le Terme limité pour cette Emigration sera fixé à l'Espace de
dix huit Mois, à compter du Jour de l'Echange des Ratifications du
present Traité. |
Dès 1760, la Nouvelle-France était passée sous administration britannique. Le
général Jeffrey Amherst nomma James Murray gouverneur militaire provisoire de Québec.
Après le traité de
Paris, qui entérinait la suprématie de la Grande-Bretagne sur le monde, le
gouvernement britannique assura aux habitants qui décidaient
de rester au Canada le droit de conserver leurs propriétés
et de pratiquer leur religion catholique «en autant que le permettent les
lois de la Grande-Bretagne». Or, les lois de la Grande-Bretagne ne permettaient
pas grand-chose à ce sujet!- L'absence
de protection linguistique
Au sujet de la langue, soulignons qu'aucune disposition du
traité de cession ne garantissait aux Français, aux Canadiens ou aux Acadiens quelque droit que ce soit
en la matière. La
France de Louis XV n'a aucunement songé à faire insérer une
quelconque disposition linguistique dans le traité, ce que la Grande-Bretagne n'aurait
certainement pas refusé. Les négociateurs français savaient probablement comment
protéger les biens et défendre les intérêts des
personnes, notamment en matière de religion, mais la survie de la langue ne
les préoccupait guère. La France fera de même en 1803 lors de la vente par
Bonaparte de la
Louisiane aux Américains (traité d'achat de
la Louisiane) et en 1954 lors de
la cession de Pondichéry à l'Inde (traité officiel
de la cession de Pondichéry).
En somme, la langue française ne semble pas préoccuper les Français en dehors de leur pré
carré.
- Une guerre de
religion
Nous pouvons imaginer sans peine que la
chute de la Nouvelle-France fut perçue en Nouvelle-Angleterre comme une grande
victoire de Dieu sur les «papistes». Les cloches sonnèrent à toute volée dans
toutes les villes. Le pasteur Eli Forbes (1726-1804), un aumônier des troupes
coloniales du Massachusetts, en donnait ainsi ce témoignage en 1763:
|
God has given us to sing this day the downfall of
New France, the North American
Babylon, New England's rival. |
[Dieu a permis, en ce
jour, que nous chantions la chute de la Nouvelle-France, la Babylone
nord-américaine, rivale de la Nouvelle-Angleterre.] |
Comme Eli Forbes, la victoire britannique
fut perçue
par les Britanniques comme une «guerre sainte» :
|
Thus God was our salvation and our strength ; yet he who directs the
great events of war suffered not our joy to be uninterrupted, for we
had to lament the fall of the valiant and good General Wolfe, whose
death demands a tear from every British eye, a sigh from every
Protestant heart. Is he dead? I recall myself. Such heroes are
immortal; he lives on every loyal tongue ; he lives in every
grateful breast ; and charity bids me give him a place among the
princes of heaven. |
[Ainsi Dieu était notre
salut et notre force; pourtant, lui qui dirige les grands événements
de la guerre n'a pas partagé notre joie ininterrompue, car nous
n'avions à déplorer la fin de l'héroïque et bon général Wolfe, dont
la mort exige une larme de tout œil britannique, un soupir de tout
cœur protestant. Est-il mort? Je me le rappelle à moi-même. De tels
héros sont immortels; Wolfe vit dans chaque langue loyale; il vit dans
chaque poitrine reconnaissante; et la charité me commande de lui
laisser une place parmi les princes du ciel.] |
Ce genre de perception était très courant à l'époque dans
une société puritaine où les Français étaient considérés comme des «imposteurs»,
des «adversaires du Christ», des «faux Christs» et des Antéchrists.
La plupart des pasteurs protestants ont cru que la chute de la
Nouvelle-France était une œuvre voulue par Dieu pour punir les Français
de leurs nombreux péchés. Les victoires françaises étaient aussi perçues
par les Français comme une bénédiction divine pour les récompenser de leur piété
envers la vraie religion. On n'en sort pas !
3.2 La disparition
de la Nouvelle-France et de ses entités
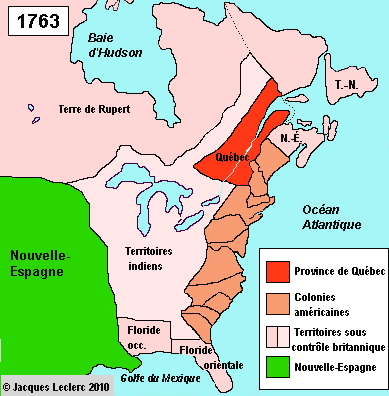 |
Selon les
dispositions du traité de Paris de 1763, la Grande-Bretagne contrôlait
dorénavant un immense territoire couvrant la Terre de Rupert, la baie d'Hudson,
le Canada (l'actuelle province de Québec, la grande région des Grands Lacs et la
vallée de l'Ohio), l'île de Terre-Neuve, l'île du Cap-Breton, l'Acadie (qui
deviendra la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick), l'île
Saint-Jean (île du Prince-Édouard), toute la Nouvelle-Angleterre
(treize colonies) et la Floride prise aux Espagnols. Le traité de
Paris se trouvait à confirmer que la Grande-Bretagne était devenue
le plus grand empire du monde et que l'Amérique du Nord serait
dorénavant anglaise. De son
empire en Amérique du Nord, la France ne conservait que les îles de
Saint-Pierre-et-Miquelon au sud de Terre-Neuve et des droits de pêche.
Quant à la lointaine Louisiane,
elle avait été cédée à l'Espagne; le 3 novembre 1762, donc un an avant le traité
de Paris, l'Espagne avait signé l'acte d'acceptation de la Louisiane (Acte
d'acceptation de la Louisiane par le roi d'Espagne) à Fontainebleau. C'est
le duc Étienne-François de Choiseul (1719-1785) —
cousin de César-Gabriel de Choiseul —,
alors secrétaire d'État aux Affaires étrangères (de 1758 à 1761), qui avait
négocié ce traité secret entre la France et l'Espagne, un pays allié.
|
En fait, des problèmes financiers avaient convaincu le ministre Choiseul qu'il
valait mieux larguer la Louisiane afin de faire des économies, et ce, sans
aucune consultation auprès de la population concernée. Le ministre préférait
recevoir six millions de livres de l'Espagne, comme prévu au traité de
Fontainebleau pour l'abandon de la Louisiane, plutôt que d'en dépenser le
double pour la conserver. Tout à ses amours avec la comtesse du Barry, Louis XV
ne voulait surtout pas entendre parler de la Louisiane et de ses habitants. Son
bien-aimé cousin, le roi d'Espagne, n'avait qu'à prendre soin lui-même de sa nouvelle
colonie! Quant à la France, il ne lui restait plus de son immense
empire en Amérique du Nord (8 millions km²) que le minuscule
archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon (242 km²). De façon paradoxale, la France abandonnait son empire au
moment où le français allait devenir la langue véhiculaire de l'Europe. C'était
le prélude à l'invasion de l'anglais qui découlerait des victoires de la
Grande-Bretagne.
3.3 Une colonie désormais britannique
Au moment où, vraisemblablement, les autorités coloniales apprennent la
signature du traité de Paris (10 février 1763), l'évêque de Québec, M
gr
Étienne Montgolfier, demanda à
tous les curés de chanter un Te Deum en action de grâces pour «le
bienfait de la paix». Le dimanche suivant la réception de ce mandement, tous les
curés durent lire la directive épiscopale aux paroissiens :
|
Soyez exacts à
remplir les devoirs de sujets fidèles et attachés à leur prince ; et
vous aurez la consolation de trouver un roi débonnaire, bienveillant et
appliqué à vous rendre heureux, et favorable à votre religion. [...]
Rien ne peut vous dispenser d'une parfaite obéissance, d'une scrupuleuse
et exacte fidélité, et d'un inviolable et sincère attachement à votre
nouveau Monarque et aux intérêts de la nation à laquelle nous venons
d'être agrégée.
|
De son côté, le cardinal Castelli écrivit de Rome, le 17 décembre 1766, à l'abbé
de l'Isle-Dieu: « De leur côté, il faudra que les ecclésiastiques et l'évêque
oublient sincèrement à cet égard qu'ils sont Français.»
L'abbé de l'Isle-Dieu,
qui résidait en France, était le grand vicaire général du Canada et de l'Acadie
(jusqu'à
la nomination de M
gr
de Pontbriand).
Il paraissait évident que, dans la colonie du Canada,
l'appartenance française devait s'effacer devant l'appartenance
catholique. Dans l'esprit et l'intérêt de l'Église, la religion avait priorité
sur la langue et la culture. Telle allait être désormais la trame de l'histoire
de l'Église catholique au Canada français: alliance de l'État et de l'Église,
loyalisme envers les autorités constituées, primauté de la religion sur d'autres
caractéristiques culturelles.
La Conquête britannique de la Nouvelle-France et du Canada entraîna non
seulement une rupture politique, mais aussi une rupture économique, sociale et,
comme il se doit, linguistique. En devenant une colonie britannique, le pays se
vit décapité de sa classe dirigeante française en transférant le pouvoir
politique et économique aux conquérants anglais. Dès lors, les habitants du
Canada n'étaient plus des Français, mais des sujets britanniques.
|
Les gouverneurs
de la province de Québec
Jeffery Amherst
(1760-1763)
Thomas Gage
(1763-1764)
James Murray
(1764-1768)
Guy Carleton
(1768-1778)
Frederick Haldimand
(1778-1786)
Guy Carleton
(1786-1796)
|
|
On assista à la réduction de
l'univers économique des Canadiens français qui, pour survivre, se
replièrent sur l'agriculture, l'artisanat et le petit commerce. Les Canadiens durent apprendre à vivre dans une
Amérique britannique. La société canadienne-française développa des réflexes de survivance axés sur la défense
de sa religion, de sa langue et de ses droits. Toute
l'histoire des Canadiens français sera marquée par cette trilogie
religion
- langue - loi, c'est-à-dire la religion catholique, la langue française et les lois
civiles françaises. |
La Conquête anglaise marqua aussi le début de la «traversée du désert» qui
entamait le processus de détérioration du statut de la langue française au
Canada. Malgré les visées assimilatrices des conquérants, les francophones
allaient survivre grâce à leur opiniâtreté, à leur isolement, à leur surnatalité
et... aux erreurs de leurs maîtres. Mais il faut retenir surtout que, à partir
de cette période, l'histoire de la langue française au Canada devint le
reflet d'une langue dominée.
Le régime britannique dotera aussi les Canadiens de nouveaux outils
pour se défendre, dont la presse (journaux), les imprimeries, les bibliothèques publiques
(une pour commencer) et le recours aux avocats, sans oublier une Église
catholique devenue officiellement la porte-parole du nationalisme
canadien-français. En même temps, l'Église va figer les francophones dans
l'agriculture et prendre le contrôle des écoles, des hôpitaux, de la presse,
etc.
À partir de cette époque, le terme de «Canadiens»
(ou Canadians en anglais) désigna les descendants des colons français qui s'étaient établis en
Nouvelle-France et qui avaient continué à parler français, par opposition aux
«Britanniques» (ou British) ou aux «Anglais», les nouveaux occupants et
les nouveaux immigrants, qui parlaient anglais, voire l'écossais ou l'irlandais.
Mais tout ce beau monde était dorénavant des «sujets britanniques», y
compris les francophones du Canada. Quant aux Français de la Louisiane, ils
étaient devenus des Espagnols.
3.4 Le
génocide des autochtones
La
conquête anglaise allait aussi entraîner un grand désastre au plan
humain : le génocide des populations
autochtones. La chute de la Nouvelle-France laissait la plupart des
autochtones à la merci des Britanniques, qui rendirent caduques toutes les alliances
franco-amérindiennes. Les Iroquois alliés des Britanniques, parfois appuyés par
des soldats, décidèrent aussitôt de se dédommager des coûts subis par la guerre
en pillant les villages algonquins, en incendiant et accaparant tout ce qu'ils
pouvaient. De leur côté, beaucoup de militaires britanniques se montrèrent
arrogants, des spéculateurs avides de terres firent des pressions et,
contrairement aux Français, les nouveaux administrateurs se révélèrent peu
empressés de combler les autochtones de présents pour s'en faire des alliés. Il
est vrai que les Français avaient longtemps excellé dans l'art de couvrir les
autochtones de cadeaux. Avec la disparition de la Nouvelle-France, les
Amérindiens trouveront un gouvernement britannique beaucoup moins
accommodant. Contrairement à la France, la Grande-Bretagne n'avait pas
besoin d'alliés autochtones, y compris les Iroquois.
Les Amérindiens allaient vite s'en rendre compte.
Au plan militaire, aucun groupe d'autochtones ne représentait une réelle menace
pour les britanniques. À l'exception des Iroquois, maintenant des Mohawks, et
des Hurons, aucune nation n'avait de présence significative et organisée dans ce qui
sera la nouvelle province de Québec. Les autochtones furent laissés à eux-mêmes,
car les Britanniques n'en avaient pas besoin. Avec la prise
du Canada par les Britanniques, les nouvelles autorités allaient commencer à
assigner aux autochtones des territoires déterminés. Après la guerre de l'Indépendance américaine, la majorité des
autochtones furent repoussés à la fois par les Américains et les Britanniques,
car ils nuisaient au développement des nouveaux colons.
Ce fut l'époque où des prophètes autochtones
firent leur apparition dans les tribus. Leurs propos soulevaient l'enthousiasme
en prêchant l'indianité et la renaissance des valeurs amérindiennes. Selon le
«Maître de la vie», il fallait «jeter les Blancs à la mer», c'est-à-dire les
Britanniques!
Mais les autochtones n'étaient pas de taille à se mesurer à la plus grande
armée du monde.
En 1763, le chef outaouais Pontiac
(vers 1714–1769)
rassembla une coalition de tribus autochtones (les Outaouais, les Miamis, les
Wyandots, les Chippewas, les Potawatomies, les Shawnees, les Renards, les
Winnebagos, etc.) et détruit tous les postes de la région des Grands Lacs, à
l'exception de Niagara et Détroit. Ainsi, les autochtones massacrèrent ou
amenèrent en captivité les garnisons et les réfugiés vaincus; ils firent plus de
2000 morts. Le général Jeffrey Amherst envisagea même de renoncer au colonies
d'Amérique du Nord. Mais les autorités britanniques ne firent pas de quartier :
la répression fut sanglante et terrible. Par la suite, les diverses tribus
firent la paix les unes après les autres et, en 1766, tous les Amérindiens
avaient enterré la hache de guerre. Le chef Pontiac se rendit même au grand
rassemblement organisé au fort Oswego par le surintendant britannique des
Affaires indiennes, William Johnson, afin de signer avec les autres chefs
amérindiens le traité qui mettait fin aux «conflit de l'Ohio».
En 1764, le général Amherst proposait de contaminer des couvertures à
petite vérole et de les distribuer aux Indiens, afin de les rendre malades et de
les faire mourir. Voici un passage de sa correspondance du 16 juillet 1763 avec
le colonel Henri Bouquet, d'origine suisse:
|
You will do well to try
to innoculate the Indians by means of blankets, as well as every method
that can serve to extirpate this execrable race. |
[Vous feriez bien
d'essayer d'infecter les Indiens au moyen de couvertures, ainsi que par
toute autre méthode visant à exterminer cette race exécrable]. |
En fait, les Britanniques connaissaient bien la faiblesse immunitaire des
autochtones, de même que les effets dévastateurs qu'auraient sur eux la variole.
Une épidémie de variole s'est effectivement répandue parmi les Amérindiens à
cette époque, mais le colonel aurait apparemment refusé d'obtempérer aux ordres
d'Amherst qui détestait les Amérindiens. Si son intention d'éradiquer les
Amérindiens était évidente, il est possible que la mise en pratique de cette
volonté n'ait pas eu lieu à ce moment-là, puis remise à plus tard. Cette épidémie serait alors le premier
cas de guerre biologique recensé en Amérique du Nord.
Les mots qui
revenaient le plus souvent dans les documents laissés par le général Amherst
étaient en anglais: Vermin («vermine»), Savage («sauvage»), Total Extermination
(«extermination totale») ou Total
Extirpation («éradication totale»). Selon l'historien Denis Vaugeois,
Amherst n'aurait rien inventé, car il était courant à l'époque d'inoculer la
variole pour décimer des populations considérées comme indésirables. Aujourd'hui, Amherst serait jugé comme
criminel de guerre.
Au final, les Amérindiens durent se soumettre, ce qui
allait entraîner
un long processus d'assujettissement. Les années qui suivirent la défaite
française apportèrent à la plupart des autochtones un surcroît de maladies, de
famines et de décadence culturelle. Durant les deux siècles qui allaient suivre,
les autochtones passeront du statut de seconde zone (maintenant occupé par les
Canadiens) à celui de troisième zone. Très rapidement, les autochtones seront
non seulement exclus de tout rôle social, mais géographiquement isolés, et
vivront dans la pauvreté et la misère, parqués dans des «réserves». Beaucoup de langues amérindiennes
allaient être en voie d'extinction. Même la plupart des Iroquois plièrent bagage et émigrèrent vers les Treize
Colonies, sauf à Sault-Saint-Louis (aujourd'hui Kahnawake) et à Oka (Kanesatake),
plutôt que s'installer sur le territoire de la nouvelle province de Québec.
Après le traité de Paris (1763), la Grande-Bretagne pouvait désormais doter
ses colonies d'Amérique du Nord d'un cadre politique et juridique conforme aux
intérêts de la Couronne. Le gouvernement de Sa majesté se trouvait dorénavant devant 13
colonies autonomistes, une nouvelle province habitée par un peuple conquis et
hostile, ainsi qu'un immense territoire inexploré et habité par des autochtones
qu'il méprisait. La solution trouvée par la Grande-Bretagne fut la
Proclamation royale (Royal Proclamation)
du 7 octobre 1763, considérée comme le
texte fondateur de ce qui allait devenir le Canada d'aujourd'hui.
Avec la Proclamation royale, toute référence au Canada et à la
Nouvelle-France était abolie. Dorénavant, le Canada s'appelait
Province of Quebec (province de
Québec). À cette époque, le mot «province» (< latin vincere: «vaincre»)
désignait un «pays conquis» par opposition à une «colonie», une région peuplée
de colons comme en Nouvelle-Angleterre. Cette distinction est importante:
l'ancien Canada n'était plus une «colonie» mais une «province». Cependant,
l'expression "Province of Quebec" n'apparaît pas dans le texte de la
Proclamation royale. On y trouve le mot "Province" appliqué pour le "Government of Quebec".
Le texte distingue aussi les "Colonies" et les "Provinces" en Amérique:
"those Colonies and Provinces in America". En réalité, la province de Québec
demeurait une colonie britannique, mais ne portait pas ce nom, contrairement à
celles de la Nouvelle-Angleterre. D'ailleurs, le texte mentionne trois nouvelles
colonies: "Our said Three new Colonies" («Nosdites trois nouvelles colonies»).
4.1 La réorganisation des colonies
britanniques
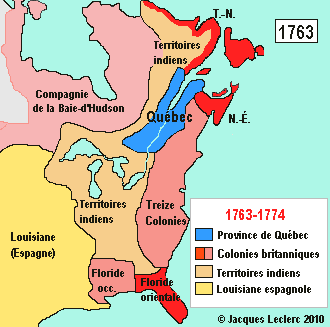 |
En effet, la Proclamation royale ne concernait pas seulement la province de Québec, mais aussi les
autres colonies de l'Amérique du Nord, dont les Treize Colonies et les
Florides, ces dernières étant aussi des «provinces». En effet, la Proclamation royale créait trois nouvelles
provinces appelées Province of Quebec ("province de Québec"), East Florida
("Floride orientale") et
West Florida ("Floride occidentale"), en plus de prévoir sur une base temporaire une
«réserve indienne», les Indian Territories ("Territoires
indiens") à partir du côté ouest
de la chaîne des Appalaches et couvrant la partie ouest des Treize
Colonies. En fait, n'ayant pas été arpentés, ces territoires demeuraient
avec des limites assez floues au nord et à l'ouest.
- Le Québec
La Proclamation royale délimitait officiellement les frontières de la
nouvelle province de Québec en la réduisant à la zone habitée,
c'est-à-dire la vallée du Saint-Laurent. Rappelons-le, toute référence au Canada fut volontairement
exclue afin de bien marquer la rupture entre la Nouvelle-France et la
nouvelle province britannique. Désormais, tout le reste de l'Amérique devenait inaccessible
aux Canadiens. |
- Les Treize Colonies
Quant aux Treize Colonies ("Thirteen Colonies"), leur expansion territoriale était stoppée net
vers l'ouest, ce qui signifiait que le développement des territoires de
l'Amérique du Nord relevait exclusivement du bon vouloir du roi. C'était là
une façon pour la Grande-Bretagne d'asseoir son autorité sur ses colonies
autonomistes. Cette politique à l'égard des Treize Colonies souleva la colère
de colons, parce que nombre d'entre eux s'étaient
déjà installés dans les nouveaux territoires devenus «britanniques»; ils durent rendre les
terres aux Indiens et revenir en Nouvelle-Angleterre.
- Les Florides
Il y avait aussi le cas des Florides. Selon les termes du traité de Paris de 1763, la France
cédait ses colonies à la Grande-Bretagne, sauf la Louisiane qui revenait à
l'Espagne. Mais celle-ci cédait à son tour le territoire situé à l'est et au
sud-est du Mississippi à la Grande-Bretagne. Par la
Proclamation royale de 1763,
les Britanniques divisèrent le territoire de la Floride en deux parties, la
Floride orientale (Est Florida), avec comme capitale Saint Augustine, et
la Floride occidentale (West Florida), avec comme capitale Pensacola.
Dans ces territoires, les habitants blancs parlaient le français, l'espagnol ou
l'anglais, alors que les populations autochtones parlaient des langues
amérindiennes.
- Les territoires indiens
Les territoires indiens ne pouvaient pour le moment être contrôlés par
l'armée britannique. Il fallait les réserver pour un usage futur de la part de
la Couronne. On créait ainsi la première «réserve indienne» en Amérique du Nord.
Quoi qu'il en soit, les autorités britanniques savaient que cette situation ne
pouvait être que provisoire et que, avec l'immigration éventuelle de colons
anglais, il serait plus facile de déloger les autochtones s'ils devenaient trop
encombrants. En attendant, il s'agissait d'apaiser les craintes indiennes de
toute arrivée massive de colons blancs sur leurs terres, le tout étant destiné à
pacifier les anciens alliés des Français. C'est pourquoi la Proclamation reconnaissait
l'existence du droit des autochtones, toujours appelés Indians («Indiens») dans la
Proclamation royale, et désignait la Couronne anglaise
comme protectrice de ce droit. Bien sûr, les Britanniques n'ont pas créé les
«territoires indiens» pour le bien-être des autochtones.
En fait, la Couronne se réservait le monopole dans l'acquisition des terres
indiennes: «Si quelques-uns des Indiens, un jour
ou l'autre, devenaient enclins à se départir desdites terres, elles ne
pourront être achetées que pour Nous, en Notre Nom, à une réunion publique
ou à une assemblée desdits Indiens, qui devra être convoquée à cette fin par le
gouverneur ou le commandant en chef de la colonie, dans laquelle elles se
trouvent situées.» Autrement dit, seuls le roi et ses héritiers avaient
l'autorité d'acheter des parties de cette immense réserve indienne de ses
habitants autochtones, car dorénavant nul, que ce soit une personne morale ou
une personne physique, ne pouvait acquérir des terres par le truchement de
traités conclus directement avec les Indiens. Tous les futurs traités conclus
avec les autochtones du Canada allaient donc être menés directement avec le
représentant dont la Couronne symbolise la souveraineté de l'Empire britannique.
Les autorités ont
créé ces territoires indiens dans le but d'éviter les débordements incontrôlés
de leurs Treize Colonies vers l'ouest, afin de favoriser les surplus de population vers
le nord, c'est-à-dire le Québec et la Nouvelle-Écosse (qui englobait alors le
Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard). La Proclamation interdisait aux
habitants des Treize Colonies de s'installer et d'acheter des terres à l'ouest
de la ligne de partage des eaux qui court le long des Appalaches.
La Proclamation royale prévoyait comment devaient se dérouler les négociations
pour acheter les terres des populations
amérindiennes de l'Amérique du Nord. C'est pourquoi elle a été appelée la «Grande
Charte
amérindienne» ou la «Charte des droits des autochtones». La
Proclamation royale de 1663 fut
jugée par
William Murray (1705-1793), premier lord Mansfield et magistrat en chef de la Cour du banc du roi,
comme étant la Constitution de facto du Canada
(«Province of Quebec») jusqu'à la
l'Acte de Québec de 1774.
4.2
La
province de
Québec
 |
Le premier gouverneur anglais de la
nouvelle «province de Québec», James Murray (qui parlait français
avec facilité), devait mettre en application la politique du gouvernement
britannique: faire du Québec une nouvelle colonie en favorisant l'immigration
anglaise et l'assimilation des francophones, en implantant la religion officielle
de l'État — l'anglicanisme — et en instaurant de nouvelles structures
politiques et administratives conformes à la tradition britannique. La Proclamation
royale prévoyait que le gouverneur devait convoquer une assemblée générale des représentants
du peuple, quand les circonstances le permettraient. Cette convocation ne vint
jamais.
Dès 1764, James Murray
établit les premières institutions judiciaires et décréta que
dorénavant il fallait juger «toutes les causes civiles et
criminelles conformément aux lois de l'Angleterre et aux ordonnances
de cette province». De plus, tout employé de l'État devait prêter le
«serment du test» ("Test
Oath"), lequel comportait une abjuration de la foi
catholique et la non-reconnaissance de l'autorité du pape. |
Ces mesures étaient destinées à écarter presque automatiquement tous les Canadiens français (à l'exception de quelques huguenots,
donc protestants, restés au pays) des fonctions publiques telles que
fonctionnaire, greffier, avocat, apothicaire, capitaine, lieutenant, sergent,
etc. Les Britanniques interdirent que les contrats soient rédigés en français
et que le système judiciaire soit administré en français.
- La politique de toléranceMais James Murray se rendit vite compte que les objectifs d'assimilation de
la Proclamation royale étaient tout à fait irréalistes, parce que 99 % de la
population était française et catholique. Il fut donc impossible d'appliquer à la
lettre les lois civiles anglaises; le gouverneur
Murray (1763-1766) dut faire preuve de
tolérance. Il se rendit compte aussi que la population canadienne subissait des
injustices flagrantes qu'une minorité anglaise — les Montrealers —
imposait aux nouveaux conquis. Il écrivait au gouvernement de Londres en 1764:
|
Little, very
little, will content the new subjects, but nothing will satisfy the
licentious fanatics trading here but the expulsion of the Canadians, who
are perhaps the bravest and the best race upon the globe. A race who,
could they be indulged with a few privileges, which the laws of England
deny to Roman Catholics at home, would soon get the better of every
natural antipathy to their conquerors, and become the most faithful and
most useful men in the American Empire. |
[Peu, très peu
suffira à contenter les nouveaux sujets, mais rien ne pourra satisfaire
les fanatiques déréglés qui font le commerce, hormis l'expulsion des
Canadiens, qui constituent la race la plus brave et la meilleure du
globe peut-être, et qui, encouragés par quelques privilèges que les lois
anglaises refusent aux catholiques romains en Angleterre, ne maqueront
pas de vaincre leur antipathie nationale à l'égard de leurs conquérants,
et deviendront les hommes les plus fidèles et les plus utiles dans
l'Empire américain.] |
James Murray considérait qu'il fallait protéger les sujets français de Sa
Majesté parce qu'éventuellement ils constitueraient un rempart face aux
Treize Colonies; c'était en somme un acte de prévention. Comme preuve de la fidélité des
Canadiens, il signalait avec une évidente satisfaction «qu'il n'y a pas plus de
270 âmes, hommes, femmes et enfants, qui vont émigrer de cette province à la
suite du traité de Paris» ("that there are no more than two hundred and seventy
souls, men, women, and children, who will emigrate from this province in
consequence of the Treaty of Paris").
Mais Murray se mit à dos les marchands
anglais, les Montrealers, qui ne tardèrent pas à
se liguer contre lui, l'accusant de ne pas respecter la
Constitution et de ne pas prôner la cause de l'anglicanisme anglais. Murray dut
regagner l'Angleterre dès 1766. Il fut lavé des accusations portées contre lui
et conserva officiellement son poste de gouverneur jusqu'au 12 avril 1768, tout
en demeurant en Angleterre. Entre-temps, il continua de défendre la cause des
Canadiens. Le 20 août 1766, il fit un rapport à lord Shelburne, alors secrétaire
d'État (1766-1768) dans le gouvernement de William Pitt:
|
I glory in having been
accused of warmth and firmness in protecting the King's Canadian
Subjects and of doing the utmost in my Power to gain to my Royal Master
the affection of that brave hardy People; whose Emigration, if ever it
shall happen, will be an irreparable Loss to this Empire, to prevent
which I declare to your Lordship, I would chearfully submit to greater
Calumnies & Indignities if greater can be devised, than hitherto I have
undergone. |
[Je me fais gloire
d'être accusé d'avoir accordé une ferme et chaleureuse protection aux
sujets canadiens du roi et d'avoir fait tout ce que je pouvais pour
gagner à mon royal maître l'affection de ce peuple brave et courageux,
dont l'émigration, si jamais elle se produisait, serait une perte
irréparable pour cet empire, afin d'éviter que je déclare à votre
seigneurie, je me soumettrais volontiers à de plus grandes calomnies et
indignités si de plus grandes peuvent exister que celles que j'ai subi
auparavant.] |
Le 27 octobre 1764, il écrivit même à lord Eglinton : "I cannot be witness to
the misery of a people I love and admire" («Je ne peux être témoin de la misère
d'un peuple que j'aime et que j'admire»). Au cours de son mandat, Murray aura
permis aux Canadiens de ne pas s'assimiler et de conserver leur religion
catholique.
 |
Toutefois, Londres finit par désavouer Murray qui fut remplacé par
Guy Carleton (1766-1778). Le nouveau
gouverneur
poursuivit la politique de conciliation envers les Canadiens.
Il laissa la hiérarchie catholique exercer ses
fonctions, dispensa du serment du test (destiné à exclure les catholiques de
toute charge administrative) les Canadiens dont il avaient
besoin pour les postes publics et toléra qu'on puisse plaider en français en
recourant aux lois civiles d'avant la Conquête.
Commentant
cette situation, l'historien et archiviste québécois André Vachon (1933-2003)
décrivit ainsi la situation dans son Histoire
du notariat canadien (Québec, 1962): |
|
L'on assista alors à ce spectacle insolite d'une
population française de 70 000 âmes gouvernée par des
conseillers de langue anglaise, représentants de quelque deux cent
marchands et fonctionnaires anglais installés aux pays: d'une population
française jugée suivant des lois dont elle ignorait le premier
mot, et par des juges qui ne comprenaient pas les parties, pas plus que
celles-ci ne comprenaient les juges; les jurés mêmes, aussi
de langue anglaise, n'entendait rien aux témoignages des parties
de langue française. De tout cela ne pouvait résulter qu'incertitudes,
confusions et quiproquos.
|
- La prédominance de l'anglais
Devant ce fait, les Canadiens français boudèrent systématiquement
les tribunaux et la fonction publique, laissant toute la place aux Anglais
qui remplacèrent rapidement les cadres francophones dans les domaines de
l'information, du commerce, de l'économie, de l'industrie et de
l'administration. Dans la revue Langue française (no
31, déc. 1976, Paris, Larousse, p. 6-7), le linguiste québécois Jean-Claude Corbeil
écrivait ce qui suit:
|
L'Angleterre, par ses représentants, dirige l'économie
du pays, exige que le commerce se fasse par l'intermédiaire de sociétés
installées soit dans les colonies anglaises du littoral atlantique,
soit en Angleterre même. Les commerçants français,
ou bien ont quitté le pays, ou sont ruinés par la défaite.
Ceux qui persistent ne connaissent pas et ne sont pas connus des sociétés
anglaises, ou encore n'obtiennent pas crédit de ces sociétés.
Les commerçants des colonies américaines envahissent le Québec
et s'y comportent comme en territoire conquis.
|
C'est donc l'anglais qui, après 1763, servit naturellement de langue
véhiculaire porteuse de la «civilisation universelle». Dans les
faits, l'anglais ne remplaça pas toujours le français, mais il le relégua certainement dans un rôle de second ordre. Propriétaires
de leurs terres, les Canadiens se replièrent alors sur l'agriculture pour
s'assurer le minimum vital: la nourriture et le logement.
- Les reculs en éducation
Au lendemain de la Conquête, il n'existait pas d'école anglo-protestante
dans la colonie. Très tôt, le clergé protestant et les parents anglophones
exercèrent des pressions sur le gouverneur afin d'obtenir des établissements
d'enseignement propres aux valeurs anglo-saxonnes. La première école anglo-protestante
ouvrit ses portes en 1766 à Québec. Au cours des décennies suivantes, les
autorités britanniques inaugureront une trentaine d'écoles primaires anglophones
dans les principaux centres urbains de la province de Québec, y compris Sorel et
Gaspé.
Les écoles francophones subirent, pour leur part, un recul
important en raison d'une baisse importante des effectifs enseignants et d'une
pénurie généralisée des manuels scolaires, les livres provenant de France étant
dorénavant interdits. Durant quelques décennies, il pouvait n'exister qu'une
seule grammaire par classe. À la fin du XVIIe siècle, le nombre des
établissements scolaires franco-catholiques dans la province de Québec
s'établissait ainsi: une quarantaine d'écoles primaires réparties entre les
régions de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal, ainsi qu'une trentaine de
petites écoles dans les régions plus éloignées. Pour ce qui est de
l'enseignement secondaire, il était assuré au séminaire de Québec et au Collège
de Montréal à partir de 1773.
Mais ce sont les autorités britanniques qui contrôlaient les
budgets accordés à l'éducation; elles privilégièrent forcément les anglophones
aux dépens des francophones. Au cours de la décennie de 1790, les anglophones
détenaient une école pour 588 habitants, alors que les francophones n'en
possédaient qu'une seule pour pour 4000. Il est vrai que les Canadiens
francophones ne voyaient plus beaucoup d'intérêt à envoyer leurs enfants se
faire instruire, alors qu'ils savaient que les carrières intéressantes leur
étaient refusées.
Compte tenu du manque d'enseignants, de la pénurie des manuels et
du repli des Canadiens dans les régions rurales, l'analphabétisme se développa
de façon quasi généralisée.
4.3 Une voie sans issue
La
Proclamation royale de 1763 se révéla vite un
véritable carcan
pour la nouvelle colonie britannique. Même le commerce
des fourrures – le secteur le plus dynamique de l'économie — périclita
parce qu'il n'était plus possible de s'approvisionner dans le réservoir pelletier
des Grands Lacs et celui du Nord. L'instauration des lois civiles anglaises menaçait la langue française et
minait le fondement de la société canadienne-française. La prestation du serment du test avait
fini par exclure les
Canadiens de l'Administration publique et les avait soumis à l'arbitraire
d'une minorité protestante et anglophone. De plus, le fait de ne pas reconnaître
l'autorité du pape rendait impossible la nomination d'un successeur
à l'évêque de Québec (M
gr
de Pontbriand étant décédé
à un fort mauvais moment en 1760) et, par voie de conséquence, vouait à l'extinction
le clergé catholique, qui ne pouvait plus ordonner de nouveaux prêtres.
En 1766, le procureur général de la province de Québec de 1766 à 1769,
Francis Masères (1731-1824) — écrit aussi sous la forme de Maseres —, un Anglais d'origine huguenote peu sympathique à l'égard
des francophones, affirmait que les Canadiens «ignorent presque tous la langue
anglaise et qu'ils sont absolument incapables de s'en servir dans un débat». Il
prônait d'ailleurs ouvertement l'assimilation des Canadiens:
|
It is a question of maintaining
peace and harmony and of merging, so to speak, into a single one, two
races which at the moment practise two different religions, speak
languages which are reciprocally foreign, and are led by their instincts
to utter different laws. The mass of inhabitants is comprised of Frenchmen
originally from old France or of Canadians born in the colony, speaking
the French language only, and making up a population estimated at ninety
thousand souls or, as the French would have it from memory, at ten
thousand heads of household. The remainder of the inhabitants is composed
of natives of Great Britain or Ireland or of British possessions in North
America, which at the moment reach the number of 600 souls. Nevertheless,
if the province is managed in a manner pleasing to the inhabitants, this
number will increase daily with the arrival of new colonists, who will
come with the intention of taking up business or agriculture, so that in
time it might become equal, even superior, to that of the French
population.
|
[Il s'agit de maintenir dans la paix et
l'harmonie et de fusionner, pour ainsi dire en une seule, deux races qui
pratiquent actuellement deux religions différentes, parlent des langues
qui leur sont réciproquement étrangères et sont par leurs instincts portés
à proférer des lois différentes. La masse des habitants est composée de
Français originaires de la vieille France ou de Canadiens nés dans la
colonie, parlant la langue française seulement et formant une population
évaluée à quatre-vingt-dix mille âmes ou, comme les Français l'établissent
par leur mémoire, à dix mille chefs de famille. Le reste des habitants se
compose de natifs de la Grande-Bretagne ou d'Irlande ou des possessions
britanniques de l'Amérique du Nord qui atteignent actuellement le chiffre
de six cents âmes. Néanmoins, si la province est administrée de manière à
donner satisfaction aux habitants, ce nombre s'accroîtra chaque jour par
l'arrivée de nouveaux colons qui y viendront dans le dessein de se livrer
au commerce ou à l'agriculture, de sorte qu'avec le temps il pourra
devenir égal, même supérieur, à celui de la population française.] |
En 1666, Masères présenta à Londres un mémoire pour régler les difficultés
survenues dans la nouvelle province britannique de Québec (Considérations
sur la nécessité de faire voter un acte par le Parlement pour régler les
difficultés survenues dans la province de Québec).
Cependant, l'immigration anglaise
demeura trop faible, les Britanniques
ne furent pas assez nombreux (environ 500 familles) dans la colonie pour assimiler
rapidement les Canadiens. Les autorités britanniques
avaient espéré que les soldats s'installent en grand nombre dans la province
afin de hâter l'assimilation des Canadiens, mais les militaires étaient presque
tous retournés dans leur pays après le
traité de Paris de 1763, sauf
pour les troupes régulières stationnées au pays. Il y a bien eu quelques
mariages entre des Canadiennes et des soldats anglais, mais en nombre nettement
insuffisant.
- La question de la Chambre d'Assemblée
Pendant ce
temps, des marchands anglais demandèrent l'établissement d'une Chambre
d'assemblée dans laquelle seules des sujets protestants pourraient être élus. Ce
projet parut sans doute paradoxal aux autorités coloniales, car il suggérait
qu'une minorité puisse imposer ses vues à une majorité, dévalorisant du même
coup le sens des «libertés anglaises».
Puis le procureur général de la province de Québec, Francis Masères,
s'opposa en 1766 à ce projet. Il croyait plutôt que les Canadiens seraient
contre cette institution et qu'il s'ensuivrait des luttes qui retarderaient
«pendant longtemps et à rendre impossible peut-être cette fusion des deux races
ou l'absorption de la race française par la race anglaise». Néanmoins, des
membres de la minorité anglaise intervinrent auprès du gouverneur Carleton en
1768 afin de faire connaître leur proposition auprès de Londres. L'année
suivante, la Chambre des Lords considéra prématuré ce projet d'une Chambre
d'Assemblée.
Puis la minorité anglaise allait revenir à la charge en 1770 avec une
pétition au roi. La réponse, deux ans plus tard, sera négative: on craignait
qu'une Chambre d'Assemblée devienne une grave cause de conflits dans la colonie,
sans compter qu'elle pourrait difficilement être représentative à la fois de la
minorité anglaise et de la majorité canadienne. Malgré plusieurs interventions
en faveur de la Chambre d'Assemblée, les anglophones essuyèrent des refus
successifs. En fait, le gouvernement britannique craignait que les Canadiens
finissent par contrôler la colonie.
- La politique conciliante
L'agitation grandissante des Treize Colonies força le gouverneur Murray, et plus tard le
gouverneur Carleton, à
pratiquer une politique conciliante à l'égard de la majorité francophone
et à rechercher son appui malgré l'indignation de la population
anglaise nouvellement arrivée dans la «province» britannique. De plus, les
Britanniques étaient fauchés, la guerre de la Conquête avait coûté très cher.
Ils ne disposaient donc pas des ressources nécessaires pour assimiler la
population locale. Il fallait trouver des compromis.
Devant les difficultés de faire fonctionner la colonie avec leurs lois et leur
langue, les Britanniques finirent par se plier aux circonstances et battre en
retraite. C'est ainsi que l'action de plusieurs
Canadiens, et de quelques Anglais comme
Guy Carleton, força Westminster à adopter une nouvelle constitution en 1774:
ce fut l'Acte de Québec.
Les colonies anglaises d'Amérique s'agitaient depuis bientôt dix ans. L'Acte
de Québec (Quebec Act), promulgué le 22 juin 1774 et devant
entrer en vigueur le 1
er
mai 1775, rendit la domination anglaise
plus tolérable pour les Canadiens. La version française parut le 8 décembre 1874
dans la Quebec Gazette / Gazette de Québec fondée en 1764. C'est en grande partie le gouverneur
Guy Carleton
qui rédigea l'Acte de Québec, même si le gouvernement de Londres n'a pas
retenu toutes les recommandations de son représentant.
Cette première loi constitutionnelle
encadrait environ 80 000 «nouveaux» sujets et 2000 «anciens» sujets. Le
pouvoir demeurait dans les mains du gouverneur qui s'entourait d'un Exécutif
désigné par lui-même. La Grande-Bretagne conservait le contrôle sur la colonie
et
considérait comme hâtif l'établissement d'une Chambre d'assemblée. En maintenant
le système seigneurial, la coutume de Paris et les lois civiles françaises, il
était manifeste que les autorités coloniales entendaient s'appuyer sur les
seigneurs, dont sept faisaient partie du premier Conseil. Bref, les seigneurs,
les autorités locales et métropolitaines partageaient les mêmes valeurs et les
mêmes intérêts : la croyance dans la monarchie, la fidélité au roi, l'appui de
l'aristocratie, l'union de l'État et de l'Église. Bien que l'Église d'Angleterre
pouvait être intolérante en Angleterre, les hommes politiques se montrèrent au
contraire tolérants envers la religion catholique dans la «province de Québec».
En raison du nombre de Canadiens de religion catholique, le solliciteur général
en Grande-Bretagne de 1771 à 1778,
Alexander Wedderburn
(1733 à 1805)
considérait que la tolérance religieuse
était politiquement moins risquée que l'intolérance:
|
The safety of the
state can be the only just motive for imposing any restraint upon men on
account of their religious tenets. The principle is just but has seldom
been justly applied ; for the experience demonstrates that the public
safety has been often endangered by these restraints, and there is no
instance of any state that has been overturned by toleration. True
policy dictates then that inhabitants of Canada should be permitted
freely to profess the worship of their religion [...]. |
La sécurité de l'État
peut être le juste motif pour imposer une retenue sur les hommes en
raison de leurs principes religieux. Le principe est juste mais a
rarement été justement appliqué ; car l'expérience démontre que la
sécurité publique a été souvent mise en danger par ces restrictions, et
il n'y a aucune instance d'un État qui ait été renversé par la
tolérance. Une véritable politique dicte alors que les habitants du
Canada devraient pouvoir librement professer le culte de leur religion
[...]. |
Il faut constater que l'enjeu principal
pour les Britanniques, comme pour l'Église catholique, était pour des raisons
différentes religieux, bien avant d'être politique, linguistique ou culturel. Il
s'agissait là de concessions constitutionnelles dont ne bénéficiaient pas en
Grande-Bretagne ni les catholiques anglais ni les catholiques irlandais.
5.1 L'absence d'immigrants anglophones
À la suite de la Conquête, l'immigration française fut interdite; le
gouvernement britannique voulut encourager la venue de sujets britanniques
parlant l'anglais. Pour que le
gouvernement britannique ait pu assimiler les Canadiens de langue française, il
lui aurait fallu compter sur une forte immigration anglaise. Les habitants de
la Nouvelle-Angleterre n'avaient pas afflué comme prévu. Il est vrai que 7000
loyalistes étaient arrivés en Nouvelle-Écosse pour prendre les terres
involontairement abandonnées par les Acadiens, mais après une décennie le nombre
d'immigrants anglophones au Québec se limitait encore à quelques centaines. Pendant ce
temps, les francophones continuaient de se reproduire allègrement, ce qui
incitait les anglophones à s'assimiler aux francophones, surtout que les
premiers épousaient des filles de famille canadienne-française. Complètement
désabusé, le gouverneur
Guy Carleton
reconnut que, à moins d'une catastrophe, le Canada serait français «jusqu'à la
fin des temps». Malgré ses nouveaux maîtres britanniques, le Canada avait
conservé son visage français.
5.2 La fidélisation des
francophones
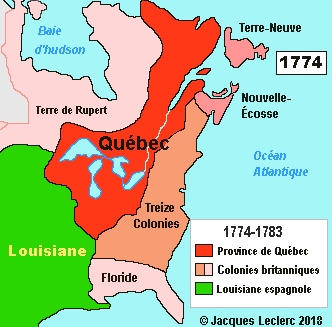 |
Londres approuva l'Acte de Québec dans le but de
se conserver la fidélité
de la population francophone du Québec tout au long du conflit avec les Treize
Colonies américaines.
La population française
du Canada se montra, pour sa part, relativement satisfaite de la nouvelle Constitution
promulguée dans l'Acte de Québec, car elle agrandissait
considérablement le territoire de la «province», qui s'étendit dès lors du
Labrador (incluant l'île d'Anticosti et les îles de la Madeleine) jusqu'à la région des Grands Lacs. La nouvelle loi constitutionnelle abolissait en outre le serment du test, autorisait le clergé catholique
à percevoir la dîme et rétablissait les lois civiles françaises. De plus,
l'Acte de Québec reconnaissait comme légal le régime seigneurial en usage en
Nouvelle-France. Bref, cette loi était comme une reconnaissance du caractère
distinct des Canadiens de langue française au sein de l'Empire britannique. Par le fait
même, la loi refusait aux anglophones des privilèges auxquels ils croyaient
avoir droit en tant que «loyaux sujets britanniques».
|
5.3 Le statut
juridique du français
Bien que l'Acte de Québec, comme c'était la coutume à
l'époque, demeurât silencieux au sujet de la langue, il assurait implicitement
au français un usage presque officiel en rétablissant les
lois civiles françaises. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir le droit
français avait signifié pour plusieurs Canadiens que leur langue allait être
employée en tout temps. Ainsi, c'est principalement à partir d'un texte
juridique aussi ambigu que s'autoriseront, dans les régimes ultérieurs, les défenseurs
de la langue pour justifier les droits acquis du français au Canada (article VIII):
| Il
est aussi Établi, par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens
de Sa Majesté en ladite province de Québec (les Ordres religieux et
Communautés seulement exceptés) pourront aussi tenir leurs propriétés et
possessions, et
en jouir, ensemble de tous les us et coutumes qui les
concernent, et de tous leurs autres droits
de citoyens, d'une manière aussi
ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si lesdites proclamation,
commissions, ordonnances, et autres actes et instruments, n'avoient point été
faits, en gardant à Sa Majesté la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la
soumission due à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne: et que dans
toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits
de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme les maximes sur
lesquelles elles doivent être décidées: et que tous procès qui seront à
l'avenir intentés dans aucune des cours de justice, qui seront constituées dans
ladite province, par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront
juges, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en conséquence desdites
lois et coutumes du Canada, jusqu'à ce qu'elles soient changées ou
altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l'avenir dans ladite
province par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en chef, de
l'avis et consentement du Conseil législatif qui y sera constitué de la
manière ci-après mentionnée.
|
En réalité, ces «us et coutumes» étaient de nature profondément
conservatrice, puisque l'Acte de Québec ne restaurait officiellement, en
plus des lois civiles françaises, que les privilèges quasi féodaux de l'Église
catholique et ceux des seigneurs canadiens. S'il semblait évident pour les
Canadiens que leur langue française faisait partie des «us et coutumes qui les
concernent», il n'en était pas ainsi pour les colons britanniques, particulièrement chez
les marchands. D'ailleurs, lorsque la situation politique et sociale allait se détériorer au cours
de prochaines décennies, les Britanniques seront encore moins enclins à considérer
que le français fait partie des «us et coutumes» et des droits garantis. De
plus, ils
remettront constamment en question l'emploi des lois civiles françaises. Quoi
qu'il en soit, la Constitution de 1774 n'allait pas durer longtemps, car elle
allait être remplacée par l'Acte constitutionnel de 1791.
En 1774, Michel Chartier de Lotbinière (1723-1798), seigneur de
Lotbinière, de Rigaud, de Vaudreuil, de Villechauve, d'Hocquart et d'Alainville,
demanda la reconnaissance officielle du français:
|
La langue françoise étant générale et presque l'unique en Canada,
que tout étranger qui y vient n'ait que ses intérêts en vue, il est
démontré qu'il ne peut les bien servir qu'autant qu'il s'est
fortifié dans cette langue et qu'il est forcé d'en faire un usage
continuel dans toutes les affaires particulières qu'il y traite; il
est indispensable d'ordonner que la langue françoise soit la seule
employée dans tout ce qui se traitera et sera arrêté pour toute
affaire publique, tant dans les cours de justice que dans
l'assemblée du corps législatif, etc., car il paraîtrait cruel que,
sans nécessité, l'on voulut réduire la presque totalité des
intéressés à n'être jamais au fait de ce qui serait agité ou serait
arrêté dans le pays. |
Il recommandait aussi une politique de
francisation de sorte que les nouveaux arrivants, aussi bien que les anciens
habitants, puissent participer sur un pied d'égalité à la vie économique et
politique de la colonie. Cependant, le seigneur de Lotbinière était probablement
en avance sur son époque. Son point de vue demeura sans conséquence juridique.
Le 1
er mai 1775, on inaugura à Montréal un buste
du nouveau roi George III (1738-1820) pour souligner la mise en vigueur de l'Acte de Québec. La foule
des Montréalais constata avec surprise que le buste portait l'inscription
suivante: «Voilà le pape du Canada et le sot Anglois» (sic). Il semble que des marchands anglo-protestants avaient été à l'origine de cet acte de vandalisme.
En 1778, Frederick Haldimand, un
Britannique francophone d'origine suisse, était nommé gouverneur de la
«province de Québec» (1778-1786), laquelle comprenait alors une grande partie
de l'Ontario. Il exerça ses fonctions à Québec au cours de la Révolution américaine. Il
trouva la plupart de ses appuis dans le French Party pour faire face
au parti britannique des marchands et colons anglais. Craignant les
Canadiens sympathiques à la cause américaine, il fit arrêter des Français
d'origine soupçonnés de sédition ou de libelle: Fleury Mesplet (imprimeur),
Valentin Jautard (journaliste et critique littéraire) et Pierre du Calvet
(commerçant).
5.4 La réforme scolaire
avortée
Devant le peu d'intérêt de la part des Canadiens
francophones d'apprendre la langue anglaise dans les écoles, le gouverneur
Guy Carleton, devenu lord
Dorchester, avait institué en mai 1787 une commission d'enquête dont le mandat
était d'étudier le niveau de scolarisation des habitants de la province et de
recommander au besoin des solutions. Cette commission était composée de cinq
membres anglophones et de quatre membres francophones; elle était présidée par
le juge en chef de la province, William Smith (1728-1793).
Le rapport des commissaires fut déposé en novembre 1789. La commission
proposa un enseignement gratuit accessible à tous et non confessionnel. Elle
suggérait aussi que chaque paroisse de la province soit pourvue d'une école
primaire où l'on y enseignerait les matières fondamentales telles la lecture,
l'écriture et les mathématiques. Mais la commission proposait aussi d'instruire
tous les enfants en anglais et de les préparer à se convertir au protestantisme
(anglicanisme). L'objectif fondamental était évidemment d'assimiler les
Canadiens à la langue du conquérant. Le 9 février 1789,
Hugh Finlay (1730-1801), directeur général des
Postes de la colonie, écrivait à sir Van Nepean:
|
What
the masters of school are English-speaking if we want to make English of
these Canadian people [... ]. We could anglicize completely the people by
the introduction of the English language. It will be done by free schools of
charge. |
[Que les maîtres d'école soient anglais si nous voulons
faire des Anglais de ces Canadiens [...]. Nous pourrions angliciser
complètement le peuple par l'introduction de la langue anglaise. Cela se fera
par des écoles gratuites.] |
Ce scénario n'a pu se concrétiser, car le projet
de réforme fut rejeté par le clergé catholique et par le pape. Lord Dorchester
dut reléguer la réforme aux calendes grecques jusqu'à ce qu'une proposition plus
acceptable soit adoptée en 1801. Cette période de transition eut pour effet
d'augmenter l'ignorance généralisée du peuple et de réduire encore le nombre
d'établissements d'enseignement dans la province.
Il n'en demeure pas moins que le taux d'alphabétisation
moyen de la colonie était d'environ 16 %; celui de la ville de Québec, de 41
%; et ce taux était d'autant plus fort qu'on était protestant et anglophone,
urbain et de sexe masculin. Les polémistes du Quebec Mercury
dénonçaient souvent sur l'idée «qu'il n'y a pas dix personnes de lettrées»
parmi les Canadiens. Toutefois, les journalistes de l'époque ne tenaient pas
compte de la concentration de la population anglophone dans les villes et de
leur formation scolaire américaine. Cependant, les témoignages de l'époque
convergent pour déplorer le piètre état de l'instruction dans la colonie
entre 1763 à 1815.
Par exemple, les villes de Montréal, de Québec et de
Trois-Rivières, qui regroupaient une population de 33 200 habitants,
n'avaient que 20 écoles, soit une école pour 1660 habitants, alors qu'en
milieu rural, dont la population atteignait 128 100 habitants, on comptait
30 écoles, soit un rapport d'une école pour 4270 habitants. Par contre, les
10 000 protestants de la colonie possédaient 17 écoles (une par 588
habitants); les 160 000 catholiques, 40 écoles (une par 4000 habitants). À
Québec, le maître d'école était généralement un homme, de religion
protestante et enseignant dans la Haute-Ville. L'instruction, comme
l'alphabétisation, augmentait proportionnellement à l'appartenance
religieuse et sexuelle, et à l'habitat urbain, car la densité démographique
rendait plus facile la création et le maintien d'une école.
Il ne faut pas oublier que l''Église
catholique assumait, depuis la Nouvelle-France, un rôle traditionnel en
matière d'éducation. Elle avait bénéficié de dotations terriennes très
importantes pour l'aider à assumer ce rôle ainsi que celui de l'organisation
hospitalière et charitable. Au moment de la Conquête, le clergé régulier et
séculier, masculin et féminin, disposait un grand nombre de seigneuries
pouvant générer et assurer des revenus importants. Mais la situation avait
changé en 1800. Le clergé catholique ne voyait pas d'un bon œil ces écoles
royales publiques conçues en partie pour «protestantiser» et angliciser les
Canadiens.
Toutefois, il fallait
tenir compte d'autres facteurs qui jouaient aussi un rôle déterminant en
matière d'éducation : la dispersion des villages et des bourgs, les rigueurs
du climat, la rareté des manuels scolaires, la pénurie d'instituteurs, sans
oublier la pauvreté et l'apathie des parents majoritairement analphabètes
qui, comme le laissait entendre l'évêque Jean-François Hubert (1739-1797),
devant le Comité sur l'éducation de 1790, ne voyaient pas l'utilité des arts
libéraux pour l'agriculture et avaient besoin de bras pour défricher et
récolter. De toute façon, pour Mgr Hubert, l'enseignement était une
responsabilité de l'Église, non de l'État. En réalité, l'Église voulait
conserver le contrôle de l'enseignement. C'est pourquoi elle décourageait
les habitants à envoyer leurs enfants dans les écoles primaires publiques.
Mais l'Église
catholique pouvait contrôler l'éducation secondaire classique, celle qui
permettait le recrutement d'un clergé local. Quatre séminaires furent fondés
avant 1815: le Petit Séminaire de Québec en 1765, le Collège sulpicien
de Montréal en 1767, le Séminaire de Nicolet en 1803 et le Séminaire de
Saint-Hyacinthe en 1811, ces deux dernières institutions conçues pour
favoriser les vocations sacerdotales en milieu rural. On y enseignait la
religion, le latin, les belles-lettres et la rhétorique. S'y
ajoutaient deux années terminales de philosophie, lesquelles étaient données
en latin.
Dans l'Amérique du Nord britannique, la
Révolution américaine eut des conséquences importantes tant sur l'Acte de
Québec de 1774 que sur l'Acte constitutionnel de 1791. Par la suite,
l'indépendance des Treize Colonies anglaises entraînera non seulement une
modification des frontières canado-américaines, qui furent considérablement
réduites, mais la population du Canada changea radicalement en raison de
l'arrivée de dizaines de milliers de loyalistes fuyant la Nouvelle-Angleterre. Par ailleurs, ces
bouleversements entraîneront la création d'une autre «province» ou colonie
britannique, le Nouveau-Brunswick, et la séparation de la province de Québec en
deux colonies distinctes: le Haut-Canada (l'Ontario) à l'ouest et le
Bas-Canada à l'est (le Québec).
6.1 L'opposition des Treize
Colonies
De fait,
l'Acte de Québec (voir
le texte original) souleva une vive
opposition des marchands anglais et de tous les habitants des colonies
américaines de la Nouvelle-Angleterre (les Treize Colonies), qui protestèrent
contre la reconnaissance du catholicisme et des lois civiles françaises
dans cette partie de l'Empire britannique; de plus, les colonies américaines
n'acceptaient pas l'élargissement des
frontières de la Province
of Quebec de 1774, qui les privaient de l'accès aux Grands Lacs
dans la traite des fourrures. Ils furent donc profondément révoltés
de constater que le gouvernement britannique concédait des droits à un peuple —
les «papistes canadiens» — qu'ils combattaient depuis cent cinquante ans. En réalité,
enfin débarrassés du rival français «qui ne laissait pas un moment de repos» (d'après Benjamin Franklin), les colons
néo-angleterriens refusaient l'intervention de la Métropole, qui
les empêchait de protéger leurs intérêts commerciaux et de jouir pleinement des
libertés qu'ils croyaient enfin acquises. En définitive, pour les habitants de
la Nouvelle-Angleterre, l'Acte de Québec
avait pour but de reconstituer cette même Nouvelle-France qui avait été
si longtemps redoutable.
De plus, Londres
avait décidé d'imposer certaines taxes à ses colonies de la Nouvelle-Angleterre. Il est vrai
que, pour conquérir le Canada et assurer la sécurité de la Nouvelle-Angleterre,
la Métropole avait déboursé d'énormes sommes d'argent et avait accumulé une
«dette de guerre» de 137 millions de livres
anglaises,
sans compter les lourdes pertes humaines. Pendant les années qui suivirent le
traité de Paris de 1763, le seul versement de intérêts de la dette absorbait
plus de 60 % du budget annuel en temps de paix. Il
apparaissait donc normal que les colonies américaines contribuent à défrayer les
dépenses encourues pour leurs bénéfices. C'est pourquoi les
Treize Colonies perçurent l'Acte de Québec comme une manœuvre dirigée contre
elles. Comment expliquer en effet que les
Britanniques ait fait des concessions aux Canadiens, alors qu'ils les avaient
refusées aux «Yankees»?
À l'automne (du 5 septembre au 26 octobre) de 1774, les députés des
Treize Colonies (à l'exception de la Géorgie) tinrent un
Congrès. Ils
adressèrent alors leurs griefs au roi George III. Au nombre de ces griefs, le
Congrès continental avait placé l'Acte de Québec, qui reconnaissait la
religion catholique, abolissait le système des lois anglaises et établissait une
tyrannie civile et spirituelle au Canada, et ce, au grand danger des colonies
voisines, lesquelles avaient contribué de leur sang et de leur argent à sa
conquête: «Nous ne pouvons, ajoutait le Congrès, nous empêcher d'être étonnés
qu'un parlement britannique ait consenti à donner une existence légale à une
religion qui a inondé l'Angleterre de sang et répandu l'hypocrisie, la
persécution, le meurtre et la révolte dans toutes les parties du monde.»
Puis le Congrès adressa aux
Canadiens une lettre officielle (Lettre adressée aux habitants de la
province de Québec, 26 octobre 1774) dans laquelle il les pressait de s'unir
aux députés des colonies. Ceux-ci désiraient «éclairer leur ignorance et leur apprendre les bienfaits de
la liberté». Ils plaignaient le peuple canadien «non seulement lésé mais
outragé»; ils dénonçaient l'Acte de Québec comme «une leurre et une perfidie».
Deux autres lettres «aux habitants opprimés de la province de Québec» allaient
suivre, sans plus de succès: la
Lettre adressée aux habitants opprimés de la province de Québec du 29
mai 1775, puis par la Lettre aux
habitants de la province du Canada du 24 janvier 1776. La plupart des
Canadiens restèrent indifférents aux belles promesses du Congrès. Devant le peu
de zèle des Canadiens pour la liberté, les autorités du Congrès décidèrent
d'envahir le Canada pour leur en faire goûter tous les bienfaits.
Or, le gouverneur
Guy Carleton n'avait à sa disposition
que deux régiments, soit environ 800 hommes, pour repousser l'ennemi. Il lui
fallait, d'une part, éviter que les Canadiens prennent le parti des insurgés,
d'autre part, que les Canadiens aident les Britanniques à faire la guerre.
Comblée par l'Acte de Québec, l'élite canadienne-française contribua à
repousser les i
nsurgés. Si très peu
de Canadiens sympathisèrent avec ces derniers, il faut reconnaître aussi que peu
de Canadiens manifestèrent un grand enthousiasme à aller combattre les
«Yankees». Pour la plupart, c'était une guerre «entre Anglais». Mais la
campagne de propagande menée par les
insurgés connut néanmoins un certain soutien dans la province de Québec,
particulièrement à Montréal, où il existait un mouvement pro-américain. Quoi
qu'il en soit, ce sont surtout des Français venus de France qui s'enrôlèrent dans
les milices yankees, dont le plus connu est le
marquis de La Fayette.
De plus, l'Acte de Québec garantissait la fidélité à la couronne
britannique chez les principaux représentants du clergé. En témoigne le
mandement de M
gr
Jean-Olivier Briand, l'évêque de Québec, «au sujet de l'invasion
des Américains au Canada», ce qui constituait une réponse directe à la
propagande du Congrès auprès des habitants de la province de Québec :
|
JEAN-OLIVIER
BRIAND, par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège,
évêque de Québec, etc., etc., etc.
À tous les Peuples de
cette Colonie, Salut et Bénédiction.
Une troupe de sujets
révoltés contre leur légitime Souverain, qui est en même temps le
nôtre, vient de faire irruption dans cette Province, moins dans
l'espérance de s'y pouvoir soutenir que dans la vue de vous
entraîner dans leur révolte, ou au moins de vous engager à ne pas
vous opposer à leur pernicieux dessein. La bonté singulière et la
douceur avec laquelle nous avons été gouvernés de la part de Sa Très
Gracieuse Majesté le Roi George III, depuis que, par le sort des
armes, nous avons été soumis à son empire ; les faveurs récentes
dont il vient de nous combler, en nous rendant l'usage de nos lois,
le libre exercice de notre Religion, et en nous faisant participer à
tous les privilèges et avantages des sujets Britanniques,
suffiraient sans doute pour exciter votre reconnaissance et votre
zèle à soutenir les intérêts de la couronne de la Grande-Bretagne.
Mais des motifs encore plus pressants doivent parler à votre
cœur
dans le moment
présent. Vos serments, votre religion, vous imposent une obligation
indispensable de défendre de tout votre pouvoir votre patrie et
votre Roi. Fermez donc, Chers Canadiens, les oreilles, et n'écoutez
pas les séditieux qui cherchent à vous rendre malheureux et à
étouffer dans vos cœurs
les
sentiments de soumission à vos légitimes supérieurs, que l'éducation
et la religion y avaient gravés. Portez-vous avec joie à tout ce qui
vous sera commandé de la part d'un Gouverneur bienfaisant, qui n'a
d'autres vues que vos intérêts et votre bonheur. Il ne s'agit pas de
porter la guerre dans les provinces éloignées : on vous demande
seulement un coup de main pour repousser l'ennemi, et empêcher
l'invasion dont cette Province est menacée. La voix de la religion
et celle de vos intérêts se trouvent ici réunies, et nous assurent
de votre zèle à défendre nos frontières et nos possessions.
Donné à Québec, sous
notre seing, le sceau de nos armes et la signature de notre
Secrétaire, le 22 mai 1775.
J. OL., Évêque de
Québec.
|
Ce mandement de M
gr Briand obtint les résultats escomptés, car il
assura au gouvernement britannique toute l'influence dont pouvait disposer le
clergé. La noblesse canadienne suivit l'exemple en manifestant un dévouement à
toute épreuve, afin de conserver à la Grande-Bretagne un pays que la France ne
méritait plus de posséder et à qui les colonies révoltées n'offraient
apparemment aucune garantie de paix et de liberté véritable. À la suite de la
capitulation de Montréal, le 12 novembre 1775 (voir
les articles de la capitulation), le brigadier général Richard
Montgomery s'installa au château Ramezay, lieu de résidence des autorités
politiques de la province. Puis l'armée du colonel
Benedict Arnold (700 hommes) et celle du général Richard Montgomery (300 hommes)
mirent le siège devant Québec au commencement de décembre 1775. La garnison,
aidée de quelque 550 Canadiens, réussit aisément à repousser les insurgés dans
la nuit du 31 décembre 1775, tandis que Montgomery décédait au combat et qu'Arnold
était
sérieusement blessé. Il ne restait que 350 volontaires pour poursuivre un siège
devenu désormais inutile devant Québec. Celui-ci fut définitivement levé, le 12
mai 1776, lorsque le général John Thomas, ayant appris l'arrivée imminente des
secours de Grande-Bretagne, crut plus prudent de prendre la direction de la
frontière; il décéda de la variole, le 2 juin suivant, pendant la retraite de
l'armée, près de Chambly. Les colonies révoltées continuèrent la guerre contre
la Grande-Bretagne, sans les Canadiens, en restant sur leur propre territoire.
Ce fut la guerre de l'Indépendance. Le 29 avril 1976, le colonel Benedict Arnold
accueillit à Montréal au château Ramezay trois émissaires du Congrès américain :
Benjamin Franklin, Samuel Chase et Charles Carroll de Carrollton. En mai 1776,
Benjamin Franklin quitta Montréal sans avoir obtenu le succès escompté. C'est
alors qu'il déclara qu'il aurait été plus facile d'acheter le Canada que de
rallier les Canadiens à la cause américaine:
| It
would have been easier to buy Canada than conquer it. |
[Il
aurait été plus facile d'acheter le Canada que de l'envahir.] |
À part quelques escarmouches autour de
Montréal, l'invasion américaine n'eut pas de suite au Canada, bien qu'elle se
soit poursuivie aux États-Unis jusqu'en 1783, soit six ans après la Déclaration
d'indépendance de Thomas Jefferson (4 juillet 1776) au Congrès. Entre les mois
de septembre 1774 et janvier 1775, quelque 700 miliciens canadiens avaient
participé à la défense de la ville de Québec. Les Canadiens de langue française
avaient ainsi démontré qu'il leur était possible d'être à la fois catholiques et
francophones tout en demeurant loyal envers la Couronne anglaise, ce qui, à
cette époque, semblait impensable en Grande-Bretagne. Il n'en demeure pas moins
que, si les Américains avaient réussi leur conquête de la «Province of Quebec»,
le Canada ferait vraisemblablement partie des États-Unis aujourd'hui. En juin
1776, la Grande-Bretagne envoya une force additionnelle composée de 10 000
hommes, dont 4800 mercenaires allemands, afin de rétablir et maintenir l'ordre
dans sa colonie. Parmi ces mercenaires allemands, environ 1400 s'établiront dans
la province de Québec à la fin des hostilités et la plupart d'entre eux
s'assimileront en épousant des francophones.
6.2 La guerre de l'Indépendance
américaine (1775-1783)
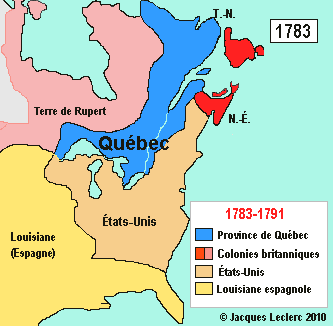 |
Un second Congrès eut lieu en mai 1775: la situation
s'envenima et l'état de guerre fut déclaré, tandis que George Washington se vit
confier le commandement de l'armée des Treize Colonies.
Dans ces conditions, l'Acte de Québec
de 1774 connut
une existence très éphémère en raison de la guerre d'Indépendance qui éclata
l'année suivante. La province de Québec allait perdre définitivement
la partie sud des Grands Lacs. Ce sera l'une des clauses du traité de Versailles
de 1783, alors que la frontière des nouveaux États américains devait suivre
dorénavant le sud des lacs Ontario, Érié, Huron et Supérieur. La province de
Québec perdit ainsi ses meilleurs postes de traite et une partie de sa population
(alors francophone) passa à la république voisine. Les nombreux conflits entre
la Grande-Bretagne et les Treize Colonies (américaines) amenèrent la déclaration d'Indépendance
du 4 juillet 1776. |
 |
Dès 1777, le marquis de La Fayette (1757-1834) avait pris une part active à la
guerre de l'Indépendance américaine aux côtés des insurgés (rebelles); il
contribua même à la victoire décisive de Yorktown (6-19 octobre 1781), où la
reddition britannique fut une étape décisive pour l'indépendance des Treize
Colonies. Lafayette avait auparavant équipé à ses frais un vaisseau de guerre et
était venu à Philadelphie offrir ses «services désintéressés». Très lié avec
Benjamin Franklin, il fut également le compagnon de campagne de George
Washington.
Convaincu qu'il était possible de rallier les Canadiens, La Fayette proposa à
George Washington, sous la pression de certains officiers américains, d'envahir
la «province de Québec» sous les auspices de la France (celle-ci avait massé des
troupes aux États-Unis d'environ 8000 hommes, afin de soutenir les Américains
contre les Britanniques). Le marquis écrivit à sa femme (3
février 1778) à ce sujet:
|
|
Je ne vous ferai pas de longs
détails sur la marque de confiance dont l'Amérique m'honore. Il vous
suffira de savoir que le Canada est opprimé par les Anglais; tout cet
immense pays est en possession des ennemis; il y ont une flotte, des
troupes et des forts. Moi, je vais m'y rendre avec le titre de général de
l'Armée du Nord et à la tête de 3000 hommes, pour voir si l'on peut faire
quelque mal aux Anglais dans ces contrées. L'idée de rendre toute la
Nouvelle-France libre et de la délivrer d'un joug pesant est trop
brillante pour s'y arrêter. J'entreprends un terrible ouvrage, surtout
avec peu de moyens. |
Mais le général de l'Armée du Nord dut renoncer à son projet
de conquérir le Canada, car Washington, qui craignait de redonner à la jeune
république américaine un voisin gênant, n'acquiesça pas au projet; il ne pouvait
tolérer qu'une puissance coloniale comme la France
puisse encore se tenir à la frontière canado-américaine. Il fit
en sorte que La Fayette soit dans l'obligation de renoncer à son projet en le
privant de tout moyen efficace, alors que c'était l'hiver et qu'il devait
traverser le lac Champlain, brûler la flottille anglaise bloquée par les glaces
et gagner Montréal où il agirait comme il l'entendait. Au lieu des 3000 hommes
promis, il n'en disposa même pas d'un millier; il n'eut pas les vêtements
nécessaires, ni les vivres, ni les raquettes et encore moins les traîneaux que
le Bureau de la guerre devait lui fournir pour assurer le succès de l'expédition.
Washington s'empressa d'excuser La Fayette (alors âgé de vint ans) en lui
écrivant ces mots sibyllins :
|
I am persuaded that every one will applaud your prudence in renouncing a
project, in pursuing which you would vainly have attempted physical
impossibilities |
[Je suis persuadé que tout
le monde approuvera la prudence qui vous a fait renoncer à une entreprise dont
la poursuite vous eût engagé dans une lutte vaine contre des impossibilités
physiques.] |
Le roi
Frédéric II de Prusse (1712-1786) avait vu juste
sur les intentions de la France, comme en témoigne cette lettre (extrait)
adressée à son ambassadeur à Paris:
|
On se trompe fort en
admettant qu'il est de la politique de la France de ne point se mêler de
la guerre des colonies. Son premier intérêt demande toujours d'affaiblir
la puissance britannique partout où elle peut, et rien n'y saurait
contribuer plus promptement que de lui faire perdre ses colonies en
Amérique. Peut-être même serait-ce le moment de reconquérir le Canada.
L'occasion est si favorable qu'elle n'a été ne le sera peut-être dans
trois siècles. |
Soulignons que l'effort militaire de la France a été plus grand pour aider les
États-Unis à conquérir leur indépendance que pour permettre au Canada de
demeurer français. La guerre aura coûté au Trésor français
un milliard de livres tournois, soit l'équivalent de huit milliards d'euros
d'aujourd'hui (ou de dix milliards de dollars US). Une somme colossale qui ruina
la France de Louis XVI. Comme si ce n'était pas assez, l'effort de Louis XVI ne
permit pas davantage de récupérer le Canada. Pire, le pays allait se peupler
de royalistes ou loyalistes (parlant anglais) fuyant les États-Unis pour une terre
restée britannique, ce qui allait causer la minorisation des francophones au Canada. Par la suite, Louis XVI dut convoquer les états généraux pour
réformer les impôts, ce qui entraîna la Révolution française (1789) ainsi que la
décapitation du roi (1793). Pour sa part, la dette américaine envers la France,
qui s'élevait à quelque à 35 millions de francs, contribua à assombrir le climat
des relations entre les deux pays. Bref, la France n'en a jamais tiré le profit
escompté. Elle s'est fait rouler par les Américains !
6.3 L'arrivée massive des
Américains
Après une longue
guerre d'usure, les forces britanniques se rendirent en octobre 1781. Le traité
de Paris
du 3 septembre 1783 reconnut officiellement les États-Unis d'Amérique. Un
second traité fut signé à Versailles (appelé Traité de paix de Paris) à la fois
par la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne; il constitue un complément au
traité de Paris de 1783 signé par les Britanniques et les représentants des
Treize colonies américaines, lequel traité mettait un terme à la guerre
d'indépendance des États-Unis. Mais ce ne fut
qu'en
1787 que l'Union fédérale des États-Unis vit le jour, alors
que les colonies américaines acceptaient de renoncer à une partie considérable
de leur autonomie locale pour fondre les Treize Colonies indépendantes en une seule, ce qui
donnait naissance à un État central puissant pouvant tenir tête à la
Grande-Bretagne.
- Les loyalistes
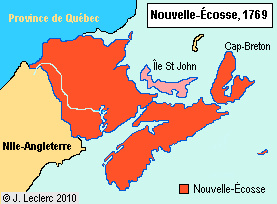 |
Avec l'indépendance
américaine, de très nombreux loyalistes quittèrent les États-Unis,
car il n'y avait plus de place pour eux dans leur pays. Plus de 100
000 loyalistes quittèrent le pays pour la Grande-Bretagne et les
autres colonies britanniques. Dès 1783, plus de 40 000 étaient
partis en exil, soit pour la Nouvelle-Écosse (35 600) soit pour la
province de Québec (plus de 8000). La plupart des loyalistes
s'établirent en Nouvelle-Écosse (qui incluait avant 1784 le
territoire du Nouveau-Brunswick actuel, l'île St John (I.-P.-É.) et
l'île du Cap-Breton), ce qui représentait 80 % du total des
réfugiés. Dans la province de Québec, qui incluait encore à ce moment-là le
«pays d'en haut: la future province de l'Ontario), seuls 18 % y trouvèrent refuge. |
La
Nouvelle-Écosse vit sa population doubler d'un seul coup, alors que la province
de Québec accueillait pour la première fois un bon contingent d'anglophones
ayant fui ou quitté les États-Unis. Dès en 1784, un premier contingent de 350
loyalistes s'installa à Baie-Missisquoi (qui sera plus tard Philipsburg). Le
gouverneur Frederik Haldimand eut tôt fait de diriger les loyalistes vers les
Grands Lacs, dans l'ouest de la province, une région encore peu peuplée qui
deviendra bientôt le Haut-Canada (Ontario). D'autres s'installèrent en Gaspésie,
notamment à Pasbépiac.
Les loyalistes étaient considérés par les Américains
républicains comme étant soumis à la Couronne britannique, comme étant aussi plus
conservateurs, moins démocrates et plus violemment anticatholiques.
De façon un peu simpliste, on peut tenter de décrire les loyalistes comme
appartenant à des catégories particulières de citoyens: les administrateurs, les
pasteurs de l'Église anglicane, les légalistes attachés au Parlement
britannique, les riches planteurs, les négociants, les adulateurs de la famille
royale, etc. Quant aux patriotes ou républicains, ce fut en principe le lot des
gens du peuple, des agriculteurs, ouvriers, etc. En réalité, ce n'était pas
aussi simple, car de riches planteurs prirent la cause des républicains, alors
que des paysans se joignirent aux loyalistes. Lorsque les Britanniques perdirent
la guerre, ils ne furent plus en mesure de protéger les loyalistes. La politique
de discrimination à l'égard des loyalistes se traduisit par une redistribution
des terres et, plus tard, une fuite massive vers la Canada et la
Grande-Bretagne, c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse et la province de Québec.
|
Colonie |
Nombre des loyalistes |
Pourcentage |
| Nouvelle-Écosse |
21
000 |
48,1
% |
| Nouveau-Brunswick |
14
000 |
32,1
% |
| Cap-Breton (Cape
Breton Island) |
100 |
0,2
% |
| Île Saint-Jean (St
John Island) |
500 |
1,1
% |
| Québec (vallée du
Saint-Laurent) |
2
000 |
4,5
% |
| Québec («pays d'en
haut» ou Ontario) |
6
000 |
13,7
% |
|
Total des loyalistes |
43 600 |
100 % |
- L'invasion américaine
Après la première vague de loyalistes, d'autres Américains
quittèrent les États-Unis pour venir occuper les nouvelles terres que le
gouvernement colonial offraient aux nouveaux arrivants. Ceux-ci refusèrent
d'être soumis aux lois civiles françaises et au régime seigneurial de la
province de Québec. C'est pourquoi le gouvernement colonial ouvrit de nouvelles
concessions dans l'Ouest (régions à l'ouest de l'Outaouais, ce qu'on appelait
auparavant «le pays d'en haut») de telle sorte aussi qu'ils puissent vivre à
l'écart des lois civiles françaises. Les anglophones exercèrent de plus en plus
de pressions afin que le gouvernement de Londres consente à réformer
l'administration de la colonie en leur faveur. Il faudra attendre en 1791 pour
voir le Québec divisé entre le Bas-Canada (Québec) à l'est et le Haut-Canada
(Ontario) à l'ouest.
Les Américains déferlèrent dans les nouveaux cantons non encore
colonisés et situés tout près de la frontière américaine (voir
la carte). Le flot d'immigration américaine ne sera stoppé que durant
trois ans, durant la guerre canado-américaine de 1812 à 1815. La population des
Townships de l'Est passa de 5000 habitants (1799) à 18 000 (1812). La plupart
des immigrants étaient des Américains qui avaient étendu vers le nord le
mouvement de colonisation ayant débuté en Nouvelle-Angleterre. Beaucoup
d'immigrants venaient du Vermont, du New Hampshire et de l'État de New York.
Entre 1774 et 1783, quelques centaines de loyalistes de 1783, soit de 500 à 600
personnes, se réfugièrent près du lac Champlain, à partir de la baie de Missisquoi et un peu vers l'est.
Plusieurs familles d'Américains pseudo-loyalistes s'installèrent dans les
anciennes seigneuries françaises de Foucault, de Saint-Armand et de Noyan et
établirent les fondations de plusieurs
cantons jusque dans les années 1790 à 1820. Ils sont à l'origine des villages tels
que Clarenceville, Philipsburg, Pigeon Hill, Frelighsburg, Farnham, Dunham, etc. Il faudra attendre en 1858 pour voir
apparaître l'appellation Cantons-de-l'Est et vers 1940 pour Estrie
(voir la cartes des
régions administratives du Québec d'aujourd'hui).
- L'immigration britannique
Après la guerre de 1812, le gouvernement du Bas-Canada décida
d'offrir des terres à des officiers et soldats licenciés; ils s'installèrent
dans la région de Drummondville, puis dans les cantons d'Orford et d'Ascot. Les
immigrants britanniques commencèrent à arriver après 1815. Si la plupart
prirent la direction du Haut-Canada, d'autres choisirent les Townships de
l'Est. C'est ainsi que des Écossais et des Irlandais vinrent s'installer dans
les cantons d'Iverness, de Leeds et d'Ireland au nord de la région, ainsi que dans
les villages de Richmond et la ville de Sherbrooke (voir
la carte). D'autres iront rejoindre la Gaspésie attirés par la pêche et
son économie. Mais l'immigration britannique diminua beaucoup après 1837.
Entre 1812 et 1850, les Cantons-de-l'Est connurent une vague d'immigration américaine;
les Américains comptèrent pour environ les deux tiers de la
population de cette région, l'autre tiers était britannique. Mais la
proportion des immigrants d'origine américaine pouvait atteindre 90 % dans les
cantons situés le long de la frontière (voir
la carte). Il n'y avait guère de Canadiens français dans ces régions,
surtout avant l'abolition du régime seigneurial (1854);
ils arriveront plus tard et deviendront majoritaires à peu près partout à la fin
du
XIXe
siècle.
6.4 L'émigration amérindienne
L'une des conséquences moins connue à la suite de l'indépendance des États-Unis
fut l'émigration de nombreuses communautés amérindiennes vers les colonies de
l'Amérique du Nord britannique, plus particulièrement vers la
Province of Quebec. Pourchassés par les colons américains, les
Amérindiens du nord des États-Unis, surtout ceux du Maine, du Vermont et de New
York, trouvèrent refuge au
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et au Québec, puis en Ontario à partir de
1791. Ce fut le cas des Micmacs,
des Abénakis, des Malécites et des Algonkiens, qui avaient tous perdu leur valeur
stratégique aux yeux des Américains.
- Les Micmacs
Le territoire d'origine des Micmacs se
situait en Acadie et en Nouvelle-Angleterre, ce qui correspondait au
Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse et au Maine. Jacques Cartier avait
en 1534 probablement rencontré des Micmacs à Gaspé, alors qu'ils séjournaient dans la
péninsule gaspésienne durant l'été. Les Micmacs furent les alliés des Français
durant tout le Régime français, particulièrement en Acadie. Après 1713, ils
continuèrent à soutenir les Français et les Acadiens contre les Britanniques
jusqu'au traité de Paris de 1763, mais beaucoup de Micmacs, y compris ceux de la
Gaspésie, furent forcés de se replier vers le pays malécite, vers la colonie du
Maine. Après la défaite des Français, les Micmacs
connurent une paix provisoire, car les colons britanniques les contraignirent à
reprendre les armes. Lors de la guerre de l'Indépendance américaine, les Micmacs
prirent partie pour les insurgés en espérant que leurs anciens alliés français
pourraient reprendre le Canada. Après la guerre, beaucoup de Micmacs du
Nouveau-Brunswick et du Maine durent fuir leurs terres ancestrales en raison des
loyalistes qui se les approprièrent. Certains trouvèrent refuge dans la région
de Restigouche (baie des Chaleurs) et pour quelque temps dans la région de
Québec (Saint-Jean-Port-Joly et Cap-Saint-Ignace), d'autres restèrent au
Nouveau-Brunswick.
- Les Abénakis
Les Abénakis étaient concentrés à
l'origine dans certaines régions du Maine et du New Hampshire, ainsi que dans le
Vermont jusqu'aux rives orientales du lac Champlain. Durant le Régime français,
une grande partie de ces territoires faisaient partie de l'Acadie. Les Abénakis
furent les plus redoutables guerriers alliés des Français pour combattre les
Britanniques. Vers 1670, les Abénakis avaient déjà commencé à émigrer au Canada
où deux villages leur ont été donnés à partir d'une portion de seigneuries: à
Saint-François-de-Sales (Odanak) et à la rivière Puante près de Bécancourt (Wôlinak).
Après l'indépendance des États-Unis, plusieurs Abénakis demeurés dans le Maine
émigrèrent à Odanak et à Wôlinak. Puis d'autres traversèrent le Saint-Laurent
pour s'établir au nord de Trois-Rivières, aujourd'hui la Mauricie. Au cours de
cette période, les Attikameks d'origine se seraient éteints pour être remplacés
par les Têtes-de-Boule, une nation d'origine algonkienne venant du nord des
États-Unis et des Grands Lacs.
- Les Malécites
Durant le Régime français, les Malécites (Maliseet
en anglais)
étaient appelé «Etchemins», parfois «Passamaquoddy». Ils habitaient
principalement dans la vallée de la rivière Saint-Jean (aujourd'hui au
Nouveau-Brunswick), ainsi que dans la baie de Passamaquoddy (aujourd'hui dans le
Maine), deux régions alors situées en Acadie. Les Malécites soutinrent les
Français jusqu'après le traité d'Utrecht (1713). En 1728, les Malécites abandonnèrent leur
alliance avec la France en ratifiant le traité de paix conclu à Boston avec les
Britanniques; ils reconnurent dès lors la souveraineté britannique sur la
Nouvelle-Écosse. En 1794, les Malécites
furent repoussés par les loyalistes du Nouveau-Brunswick et les rebelles
du Maine et du
Massachusetts. Quelques années plus tard, un certain
nombre de Malécites trouvèrent refuge à Cacouna (Withworth) et à l'île Verte.
Lors du traité de Gand de 1814, qui mettait fin à la guerre de 1812 entre le
Canada et les États-Unis et réglait la frontière entre les deux pays, les
négociateurs de la Grande-Bretagne cédèrent une portion importante du territoire
Malécite aux États-Unis, qui devint ainsi une partie du Maine. Le
dernier survivant des Malécites du Québec est décédé en 1972, mais d'autres,
ceux-là anglophones, sont
venus du Nouveau-Brunswick pour tenter de faire revivre cette communauté. La plupart
des Malécites vivent aujourd'hui dans la province du Nouveau-Brunswick (Madawaska,
Tobique, Woodstock, Kingsclear, St. Mary et Oromocto). Il n'en reste qu'environ
600 dans le Maine (Houlton). La plupart des Malécites
sont
aujourd'hui anglophones, malgré les tentatives de réintroduire la langue
malécite.
- Les Algonkins
Les Algonkins vivaient concentrés près des
Grands Lacs, dans ce qui était appelé sous le Régime français les
Pays-d'en-Haut. Mais l'arrivée dans
la région des colons loyalistes fuyant vers l'est de la province de Québec
(aujourd'hui l'Ontario) après 1776 et recherchant des terres pour s'établir, eut
pour effet de chasser progressivement les Algonkins de leurs terres ancestrales
et de les repousser au nord de l'Ontario et l'est du Québec, soit dans
l'Outaouais, l'Abitibi et le Témiscamingue. La présence des Algonkins nuisait au
développement des nouveaux colons.
7 La période troublée de 1791-1840
L'afflux des loyalistes dans la province de
Québec obligea les autorités britanniques à trouver des solutions de compromis:
les loyaux sujets britanniques devaient être régis par des lois anglaises pendant que les Canadiens
français pourraient conserver les lois françaises. De plus, le Québec était de religion
catholique et les terres étaient réparties selon le système seigneurial, ce qui
déplaisait souverainement aux loyalistes anglophones.
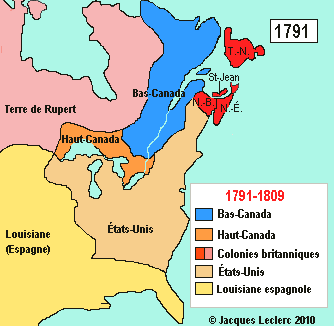 |
Dans l'espoir de
mettre fin aux luttes entre francophones et anglophones, le secrétaire
d'État aux colonies (le Colonial Office),
lord Grenville, présenta au Parlement
britannique un projet de loi qui divisait la province selon un clivage ethnique et créait deux colonies distinctes:
le Bas-Canada (aujourd'hui le Québec) et le
Haut-Canada (aujourd'hui l'Ontario).
Ainsi, en créant une
enclave réservée aux loyalistes, les fidèles sujets de Sa Majesté
britannique n'auraient plus à souffrir des revendications de la majorité
française et catholique. C'était aussi une façon pour le gouvernement
britannique d'amadouer les Canadiens français à sa cause, car la menace d'une
guerre avec les États-Unis demeurait toujours présente; elle éclatera en
1812.
La loi constitutionnelle, adoptée par le Parlement britannique,
c'est-à-dire l'Acte constitutionnel de 1791, avait séparé
la «province de Québec» en deux colonies distinctes: le Bas-Canada
(Lower Canada) et le
Haut-Canada (Upper Canada), ce qui revenait à abroger une partie de l'Acte
de Québec, notamment
l'article XII. |
7.1 Les deux colonies du Haut et du Bas-Canada
Le Bas-Canada comptait alors environ 140 000 francophones et 10 000 anglophones,
tandis que le Haut-Canada ne recensait que quelque 10 000 loyalistes
anglophones, sans compter les francophones et les Amérindiens déjà installés
bien auparavant. Cette loi constitutionnelle accordait aux Canadiens
français et aux Britanniques des concessions aussi bien géographiques que politiques : le
Bas-Canada (français) et le Haut-Canada (anglais). Une fois mis en place, ce
régime dualiste allait se révéler immuable. Le 19 mars 1790,
Alured Clarke (1744-1832) fut nommé
lieutenant-gouverneur de la province de Québec en remplacement de Henry Hope. La
principale responsabilité de Clarke fut de mettre en application les
dispositions de la nouvelle Constitution. Or, la délimitation des frontières
avec le Haut-Canada et surtout avec les États-Unis se révéla délicate, et les
instructions en provenance de Londres ne furent pas toujours claires. Le mode
d'attribution des terres aux colons et la réorganisation des tribunaux étaient
d'autres sujets qui occupèrent Clarke durant l'année 1792.
 |
Considérant
que la nouvelle province était faite pour eux, les loyalistes du Haut-Canada ne
s'embarrassèrent pas des questions linguistiques. John Graves Simcoe
(1752-1806), qui devint le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada (de 1791
à 1796), fit en sorte d'effacer toute trace française, et même amérindienne. Dès
1792, John Graves Simcoe décida d'ignorer ses sujets francophones en limitant
leur influence dans le Haut-Canada; avec l'arrivée des loyalistes, les
francophones furent exclus des postes administratifs. Le gouverneur Simcoe
anglicisa un certain nombre de toponymes: Toronto devint York, le
lac des Claies fut changé en Simcoe Lake, la rivière La Tranche
en Thames River, la rivière Chippewa en Welland River, la
rivière Toronto en Humber River, la rivière Wonscoteonach
en Don River, etc.
|
Cette pratique était destinée à supprimer le plus
possible la toponymie française et amérindienne, tout en rendant hommage aux
amis du régime. Parce que les dénominations amérindiennes rappelaient encore
l'alliance franco-indienne, elles furent supprimées dans la mesure du possible.
Quant à la majorité francophone du Bas-Canada, elle ne tarda pas à s'opposer
à la minorité anglophone pour le contrôle des institutions politiques de la
colonie. La petite bourgeoisie anglophone ne pouvait accepter d'être évincée des
décisions les concernant: elle devait protéger ses intérêts économiques contre
les Canadiens, la plupart des agriculteurs dirigés par des membres des
professions libérales. Par ailleurs, certains leaders anglophones n'avaient pas
oublier leur vieux rêve d'assimilation, ce qui était devenu impossible avec la
division de la colonie en deux entités distinctes. Pour le moment, il était
encore impensable d'unir le Haut-Canada et le Bas-Canada, car les Britanniques
auraient été dans l'obligation d'accorder un nombre de sièges plus élevé aux
Canadiens français. Dans cinquante ans, le rêve d'assimilation allait devenir
réalisable, alors que les anglophones seront devenus majoritaires dans
l'ensemble des deux Canadas.
7.2 Les seigneuries,
les cantons et les comtésAu-delà du changement superficiel qu'était l'appellation
«Bas-Canada», qui remplaçait «province de Québec», il s'ensuivit de grands
changements, dont un nouveau paysage administratif. En effet, le Bas-Canada
comprenait désormais des régions distinctes au point de vue de la tenure des
terres: en plus des seigneuries traditionnelles, il y eut dorénavant des
townships, c'est-à-dire des «cantons». Au Bas-Canada, c'étaient
les Eastern Townships, ce qui fut appelé en français
«Townships de l'Est» par opposition aux Western Townships
(Haut-Canada) ou «Townships de l'Ouest», plus précisément les Cantons de l'Est
(encore en usage) par rapport aux Cantons de l'Ouest (tombés en désuétude).
Ce vaste territoire du sud du Québec fut créé en 1792 par la proclamation du
lieutenant-gouverneur du Bas-Canada, Alured Clarke. Contrairement aux
seigneuries, cette région fut subdivisé en
cantons,
c'est-à-dire à la mode anglaise de division des terres selon un «plan carré»,
non en rectangles étroits orientés en direction nord-ouest sud-est), en vertu du
modèle britannique dit «tenure en
franc et commun socage» ("free and comon soccage"), donc en propriété libre de
toute redevance. Le processus prit plusieurs années pour finalement aboutir à la
création de 95 cantons (voir la carte).
À partir de
ce moment, les autorités
coloniales écarteront la concession de toute nouvelle seigneurie pour favoriser
l'attribution de terres divisés en cantons.
De plus, à cette division entre les seigneuries et les cantons
se superposèrent
29 circonscriptions électorales dites
«comtés». Ces comtés ne relevaient pas d'un comte, car il s'agissait simplement
d'une traduction du mot anglais county rendu par
par «comté ». Par ailleurs, 16 de ces comtés, soit plus de la moitié, reçurent
des dénominations anglaises: Bedford, Drummond, Dorchester, Hampshire,
Northumberland, Buckinghamshire, Effingham, Huntingdon,
Kent, Warwick, Sherbrooke, William Henry, York, etc.
Ainsi, le Bas-Canada prit en partie un visage plus anglais.
7.3 La Révolution
française de 1789
Ce n'est
pas un hasard si la nouvelle Constitution
«canadienne» a été adoptée en 1791, soit deux ans après la Révolution
française. C'était une façon pour Londres d'amadouer les Canadiens français en
leur accordant une Assemblée qu'ils réclamaient depuis longtemps. La
Constitution de
1791 marqua
l'avènement du parlementarisme chez les Canadiens français. Chacun des deux Canadas possédait
son Assemblée législative, son Conseil législatif,
son Conseil exécutif (créé en 1792) et son lieutenant-gouverneur.
Au sommet de la hiérarchie, Londres avait nommé un gouverneur
général qui disposait d'une autorité absolue sur les
deux Canadas: il pouvait opposer son veto aux lois adoptées par chacune
des assemblées législatives. Quant aux conseils, ils pouvaient disposer de budgets et contrôler les dépenses du gouvernement
sans rendre de comptes aux élus; de ce fait, le rôle du Conseil consistait à rendre les lois adoptées par l'Assemblée
compatibles avec les intérêts britanniques et ceux des marchands
anglais du Bas-Canada (Québec). Ce sera là une source de conflits continuels
entre les représentants du peuple et les dirigeants britanniques.
 |
Quant à la Révolution française, beaucoup d'Anglais en Grande-Bretagne et au
Canada s'y montrèrent favorables au début, notamment parce qu'il voyaient que la
France mettait fin à l'absolutisme royal. Mais tout changea après l'exécution de
Louis XVI (21 janvier 1793) et de Marie-Antoinette (16 octobre 1793), la
décapitation de la noblesse ainsi que les innombrables boucheries humaines à la
guillotine.
Les Canadiens ne demeurèrent pas indifférents à ce qui se passait en
France. Les trois journaux publiés dans la colonie, la Gazette de Québec
(bilingue), la Gazette de Montréal (bilingue) et le Quebec Herald
tenaient leurs lecteurs au courant des affaires françaises (avec un
retard de trois mois).
|
Cependant, toute la population canadienne, francophone comme anglophone,
était restée très attachée à la monarchie. Le régicide des Français fut
considéré au Canada comme un crime inacceptable. De plus, l'anticatholicisme de la
Révolution française suscita une réaction de rejet de la part des
Canadiens français, dont le clergé demeurait la seule institution de protection.
L'Église catholique du Canada préféra partager le pouvoir avec l'occupant
anglais plutôt que de conserver des liens avec une France «ennemie de la
religion».
En 1792, l'évêque de Québec, Jean-Olivier Briand (en titre de 1766 à 1784), se
plaignait de certaines influences françaises: «Il s'est introduit dans ce pays
une quantité prodigieuse de mauvais livres, avec un esprit de philosophie et
d'indifférence qui ne peut avoir que de mauvaises suites.» L'un de ses
successeurs, Jean-François Hubert (en titre de 1788 à 1797) mit ainsi en
garde ses curés:
|
Que l'esprit de religion, de subordination et d'attachement au roi,
qui faisait autrefois la Gloire du Royaume de France, a fait place à un
esprit d'irréligion, d'indépendance, d'anarchie, de parricide, qui, non
content de la mort ou de l'exil de la saine partie des Français, a
conduit à l'échafaud leur vertueux Souverain et que le plus grand
malheur qui pût arriver au Canada serait de tomber en la possession de
ces révolutionnaires. |
Les événements français renforcèrent la conviction épiscopale d'une
sainte alliance du Trône et de l'Autel. Après la déclaration de guerre contre la Grande-Bretagne, la
Révolution française fut totalement discréditée au Canada, la France étant
devenue une ennemie de la colonie et de la Grande-Bretagne. Beaucoup de
Canadiens français se considéreront même privilégiés de pouvoir pratiquer leur
religion et de vivre en paix sous la bienveillante protection du roi d'Angleterre.
De plus, l'Église catholique se mit à interpréter la Conquête anglaise comme
«providentielle» dans la mesure où elle évitait au Canada les affres de la
Révolution française.
Par la suite, les tentatives de «libération» du Canada par les
Américains allaient toutes échouer grâce à la collaboration de la population francophone. Dans
les années qui suivirent, les journaux valorisèrent la Constitution
britannique en tentant de généraliser son application dans la colonie
canadienne et en tentant de définir le Canadien en regard des Français et
des Britanniques, sinon des «Américains».
7.4
La démocratie de façade
Seuls les loyalistes du
Haut-Canada
(Upper Canada) demeurèrent satisfaits de la
loi constitutionnelle de 1791 parce qu'ils n'étaient plus soumis aux lois françaises
et contrôlaient leurs institutions politiques. La minorité anglophone
du Bas-Canada (Québec), bien qu'elle disposât de la majorité
au Conseil exécutif et au Conseil législatif, accepta mal
d'être mise en minorité à l'Assemblée législative,
où elle ne comptait que 15 députés sur 50.
Aux premières élections de 1792, la prépondérance numérique des Canadiens s'est
aussitôt manifestée. Seize britanniques furent élus, huit en milieu urbain et
huit en milieu rural ; ils constituaient 31 % de la Chambre d'assemblée alors
qu'ils formaient moins de 10 % de la population de la colonie. Plus de 50 % des
députés étaient propriétaires d'une seigneurie, signe de l'importance de la
richesse foncière auprès de la population rurale.
Les anglophones furent insultés
d'être abandonnés à une majorité de «papistes paysans» et à une petite
bourgeoisie de notaires, d'avocats et de curés. Quant aux
francophones, ils ne tardèrent pas à comprendre les mécanismes
de cette «démocratie de façade»: les députés étaient élus par la population, mais ils
n'avaient pas de pouvoir réel
au sein du gouvernement formé et contrôlé par la minorité
anglophone. N'oublions pas que le Conseil législatif, entièrement
composé d'hommes nommés par le gouverneur (en général des marchands et des
fonctionnaires britanniques, parfois des francophones soumis), conservait un
droit de veto sur tous les projets de lois présentés par l'Assemblée. Le Conseil
finira par bloquer systématiquement toutes les initiatives des élus de
l'Assemblée qui refusera d'adopter les budgets, ce qui paralysera l'État.
Dans ces conditions, il était normal que toute cette période
de 1791-1840 connaisse des conflits permanents entre francophones et anglophones,
conflits qui dégénéreront en lutte armée lors
de la rébellion de 1837. Les gouverneurs anglais durent régulièrement
suspendre l'Assemblée et déclencher de nouvelles élections afin d'assujettir
les élus francophones. Peine perdue, à chaque fois, les Canadiens reprenaient
le pouvoir et continuaient le combat de plus bel. En 1836, l'Assemblée décida
de suspendre indéfiniment ses travaux jusqu'à ce que Londres lui accorde un Conseil législatif élu. Or, Londres refusa le principe du
«gouvernement responsable» réclamé. Il n'était pas possible que le
gouvernement britannique accepte qu'une population d'origine française et
catholique (vaincue par surcroît) prenne le contrôle des institutions d'une
colonie de Sa Majesté britannique.
 |
Depuis plusieurs années, le journal The
Montreal Gazette avertissait ses lecteurs que l'ambition des Canadiens
français était de fonder "a French Canadian domination and a French Canadian
nationality in America [...], a French Republic in the hearth of British
American province'', ce qui signifie «une domination canadienne-française
et une nationalité canadienne-française en Amérique [...], une république
française au cœur d'une province américano-britannique».
|
De plus, on n'hésita
guère à présenter les marchands anglais du Bas-Canada comme
une classe opprimée par une majorité francophone sourde et aveugle à ses propres intérêts.
7.5 Les
premiers conflits linguistiques
La question de la langue fut l'objet des premiers affrontements entre
francophones et anglophones. Comme l'Acte
de Québec (1774), la Constitution
de 1791 ne faisait pas allusion à la langue. Dès la première
séance de la première législature du Bas-Canada (le
17 décembre 1792), le débat s'engagea aussitôt sur la
question linguistique. Députés francophones et anglophones
se chamaillèrent au sujet du choix du président de l'Assemblée (appelé
«l'orateur») ainsi que du statut de la langue d'usage et de
publication des débats de la Chambre.

La majorité francophone proposa la candidature de Jean-Antoine Panet,
qui parlait peu l'anglais, alors que la minorité anglophone lui opposait
celles de William Grant, de James McGill et de Jacob Jordan, en faisant
valoir qu'il était nécessaire que le président parlât parfaitement
la langue du souverain. Ceux qui appuyaient le candidat Panet
firent avaloir que le roi signait des traités dans toutes les langues, que
Jersey et Guernesey étaient de langue française et que Panet, avocat,
connaissait la Constitution britannique.
De stratégie en stratégie, Jean-Antoine Panet finit par être élu au grand
mécontentement des anglophones par 28 voix contre 18. Le 20 décembre 1792,
Panet se présenta devant le lieutenant-gouverneur de la province (Alured
Clarke) en lui
déclarant: «Je supplie Votre Excellence de considérer que je ne puis
m'exprimer que dans la langue primitive de mon pays natal, et d'accepter la
traduction en anglais de ce que j'aurai l'honneur de lui dire.»
Pour le premier ministre britannique,
William Pitt (comte de
Chatham), il paraissait extrêmement désirable que les Canadiens et les Britanniques du Bas-Canada fussent unis et induits universellement à préférer les lois et les institutions anglaises. «Avec le temps,
croyait-il, les Canadiens adopteront peut-être les lois anglaises par conviction. Ce sera l'expérience qui devra enseigner aux Canadiens que les lois anglaises sont les meilleures.» Quant à la langue, les
Britanniques
l'ignorèrent tout simplement. Ils connaissaient
probablement la forme de bilinguisme qui s'était installée au sein de l'Administration
locale, notamment dans les tribunaux et les journaux. Que le président de la Chambre du Bas-Canada soit
un francophone et qu'il connaisse mal la «langue de l'Empire» ne semblait pas un
obstacle considérable, mais la question de la langue était soulevée et le
vrai débat restait à venir.
Le débat sur la langue d'usage à la Chambre fut plus houleux.
Plaidant en faveur de l'unité de la langue dans l'Empire britannique, le
député John Richardson proposa que seul l'anglais soit considéré «légal».
Joseph Papineau
(le père de Louis-Joseph Papineau)
fit la contre-proposition d'une reconnaissance des deux
langues, alors que Pierre-Amable de Bonne
(qui deviendra plus tard un fidèle membre du Conseil législatif au service
des Britanniques)
proposa que les «motions» soient traduites dans l'autre
langue, mais que les projets de lois (appelés «bills») sur le droit criminel
soient présentés en anglais et que ceux concernant le droit civil le soient
en français, le texte devant être, dans chaque cas, traduit avant
discussion. La presse s'empara aussi de la question et le débat devint
passionné.
Après trois jours de débats, la Chambre accepta que les textes de lois
soient «mis dans les deux langues», étant entendu que chacun des députés
pouvait présenter une motion dans la langue de son choix, laquelle serait
traduite pour être «considérée dans la langue de la loi à laquelle ledit
bill [«projet de loi»] aura rapport». Cela signifiait que les lois
civiles seraient rédigées en français, tandis que celles correspondant aux matières
criminelles ou à la religion protestante le seraient en anglais.
Le gouverneur, lord Dorchester, donna son accord pour les deux langues «pourvu
que tout bill soit passé en anglais», c'est-à-dire adopté dans cette langue. Cette disposition n'a pas eu l'heur de plaire aux autorités
britanniques. En septembre de la même
année (1793), le gouvernement de Londres
décréta que l'anglais devait être la seule langue
officielle du Parlement, le français n'étant reconnu
que comme «langue de traduction». La langue française demeura donc,
durant cette période, sans garantie constitutionnelle ni valeur juridique, bien qu'elle continuât à être employée
dans les débats, les procès-verbaux et la rédaction
des lois (comme langue traduite). De 1793 jusqu'en 1840, ce sera la pratique
jusqu'à l'adoption de la Loi d'Union (Union Act) de 1840, qui fera de l'anglais la seule
langue officielle.
Bref, les Canadiens désiraient l'unilinguisme français, alors que les
Anglais refusaient de reconnaître le français comme langue officielle.
Dorénavant, la langue, tout autant que la religion, allait
occuper le devant de la scène politique. De catholique qu'elle était depuis
1763, la colonie devenait également francophone. Si certains songeaient à la
«protestantiser», d'autres allaient penser à l'angliciser.
Au moment de l'adoption de la loi sur la langue à
l'Assemblée, une nouvelle importante arriva à Québec : Louis XVI avait été
décapité le 21 janvier 1793 et la France avait déclaré la guerre à
l'Angleterre le 1er février. La Chambre
d'assemblée vota unanimement l'adresse suivante au lieutenant-gouverneur et
au roi d'Angleterre:
|
Nous, les fidèles et loyaux sujets de Sa Majesté représentants du
peuple du Bas-Canada [...] assurons votre excellence que c'est avec
horreur que nous avons appris que le forfait le plus atroce et le plus
déshonorant pour la Société a été commis en France. Et c'est avec peine
et indignation que nous sommes maintenant informés que les personnes qui
y exercent le pouvoir suprême ont déclaré la guerre contre Sa Majesté. |
Les tensions entre l'ancienne et la nouvelle mère patrie
allaient affecter la colonie jusqu'à leur atténuation en 1815, alors qu'un
courant d'idées s'est amorcé afin de renforcer l'appui de la colonie et des
Canadiens envers la monarchie anglaise.
7.6 La lutte pour le pouvoir
Les premières années d'application de la
Loi constitutionnelle de 1791 correspondaient à une période économique relativement
prospère. Le Bas-Canada exportait facilement ses excédents
agricoles vers la Grande-Bretagne pendant que le commerce des fourrures
et l'exploitation forestière connaissaient un essor considérable.
Cependant, ce ne sont pas les Canadiens français qui profitèrent le
plus des entreprises commerciales. Les marchands anglais contrôlaient
90 % de l'économie du Bas-Canada: ils dirigeaient le commerce du bois,
comme ils monopolisaient le commerce de la fourrure.
Les députés
anglophones tentèrent de faire adopter à l'Assemblée législative des lois favorables
au commerce (qu'ils contrôlaient), mais l'opposition de la majorité
francophone finit par excéder la minorité anglophone, qui aspirait à
l'union des deux Canadas dans l'espoir de récupérer totalement
le pouvoir politique. Les intérêts économiques divergents
entre les deux groupes linguistiques s'accentuèrent davantage au tournant
du XIXe siècle et se transformèrent en conflits idéologiques
qui contribuèrent à détériorer encore le climat sociopolitique.
Déjà, à cette époque, on parlait de «nation distincte»
et de «peuple distinct», une notion qu'on reprendra dans la décennie 1990 dans
l'expression «société distincte».
En 1836, un mouvement s'est même
dessiné en faveur de la partition de l'île de Montréal et du comté de
Vaudreuil (situé à la frontière ouest), afin de les rattacher au
Haut-Canada
anglais. Devant le tollé des anglophones des Townshippers
(Cantons de l'Est) et de la ville de Québec, le mouvement n'eut pas de
suite.
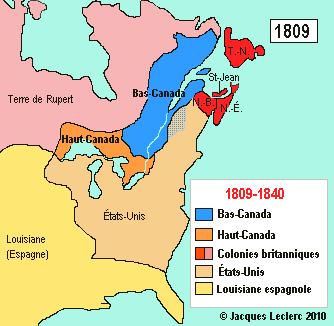 |
Le début du
XIXe siècle
fut marqué par
l'éveil du sentiment nationaliste, qui s'inscrivait dans les mouvements
internationaux de libération nationale, notamment en Europe et en
Amérique du Sud. En effet, entre 1804 et 1830, accédèrent à l'indépendance
la Serbie, la Grèce, la Belgique, le Brésil, la Bolivie et
l'Uruguay. Dans le Bas-Canada, ce mouvement prit la forme de luttes parlementaires.
8.1 La
persistance du fait français
Les années 1805-1810 semblèrent capitales à cet égard.
James Henry Craig, qui
gouvernait le pays à ce moment, raconte que les Canadiens
français ne cessaient de parler de la «nation canadienne» et de ses libertés:
«Il semble que ce soit leur désir d'être considérés comme une nation
séparée; la nation canadienne est chez eux une expression habituelle.»
Il s'agissait là d'une attitude nouvelle. Le
gouverneur Craig n'aimait pas les Canadiens qu'il voulait remettre à
leur place, ni le clergé catholique. Il
écrivait en 1810 à propos des Canadiens français:
|
|
I mean that in language,
religion, attachment, and customs, [this people] is completely French,
it has no other tie or attachment to us than a shared government; and
that it in fact holds us in mistrust [...], feels hatred […]. The
dividing line between us is complete.
|
[Je veux dire que par la langue, la religion, l'attachement
et les coutumes, (ce peuple) est complètement français, qu'il ne nous est pas
attaché par aucun autre lien que par un gouvernement commun; et que, au
contraire, il nourrit à notre égard des sentiments de méfiance [...], des
sentiments de haine [...]. La ligne de démarcation entre nous est totale.] |
Craig croyait que les Canadiens étaient «des Français de cœur» ("French's
heart") et qu'ils se joindraient à une armée américaine commandée par un
officier français et qu'ils retourneraient volontiers sous la domination de la
France.
En 1809,
Ross Cuthbert
(1776-1861), seigneur de Berthier, député anglophone de Warwick
(Bas-Canada) et conseiller exécutif, écrivit à propos des Canadiens ce
témoignage sur leur caractère français:
|
A
stranger travelling across the province without entering the cities
would be persuaded he was visiting a part of France. The language,
manners, every symbol, from vane to clog, join together to lead him
astray. […] Should he enter a house, French politeness, French dress,
French apparel will strike the eye. In the finest of French accents,
he'll hear talk of French soap, French shoes; and so on, for
everything carries the adjective French. Should one of the
daughters of the house decide to sing, he'll likely hear the lovely
ballad Sur les bords de la Seine, or some other song that
transports him to a beautiful valley of Old France. Among the
portraits of saints in the guest room he will also notice that of
Napoleon. In short, he could not imagine he had crossed the borders
of the British Empire.
|
[Un étranger qui voyagerait à
travers la province sans entrer dans les villes serait persuadé
qu'il visite une partie de la France. La langue, les manières,
chaque symbole, de la girouette aux sabots, s'unissent pour mieux le
tromper. [...] S'il entre dans une maison, la politesse française,
la tenue française, l'habillement français frapperont son regard.
Dans un des meilleurs accents français, il entendra parler de savon
français, de soulier français; et ainsi de suite, car tout se
distingue par l'adjectif français. Si une des filles de la
maison décide de chanter, il entendra probablement la jolie
pastorale de Sur les bords de la Seine, ou quelque autre
chanson, qui le transportera dans une de ces belles vallées de la
vieille France. En visitant la chambre de compagnie, il remarquera,
parmi les autres saints, le portrait de Napoléon. En résumé, il ne
pourrait pas s'imaginer qu'il a franchi les frontières de l'Empire
britannique.] |
Tant que Napoléon dominait l'Europe, il était généralement
détesté par les Canadiens français, car il avait emprisonné le pape et
représentait encore la France impie qui avait assassiné le roi et de nombreux
prêtres, mais il devint rapidement une idole de la résistance au monde
anglo-saxon.
Évidemment,
Ross Cuthbert, qui était par ailleurs l'un des
citoyens les plus illustres de la société canadienne-anglaise du Bas-Canada,
considérait cette situation comme un anachronisme qui devait disparaître «dans
l'effervescence d'un dissolvant britannique». En 1803, dans L'Aréopage
publié à Québec, Cuthbert avait déploré l'ignorance de la population canadienne,
son attachement aveugle à des lois françaises considérées comme anciennes et poussiéreuses.
Quant à
James Stuart
(1780-1853),
procureur général du Bas-Canada, député de la circonscription de
William Henry et membre du Conseil exécutif, il remit le 6 juin 1823 un mémoire
sur un projet d'Union dans lequel il résumait ainsi les raisons des difficultés
dans l'assimilation des Canadiens:
|
Lower
Canada is mostly inhabited by what one could call a foreign people,
despite the fact sixty years have passed since the Conquest. This
population has made no progress towards assimilation with its fellow
British citizens, in language, manner, habit, or sentiment. It
continues, with a few, rare exceptions, to be as perfectly French as
when brought under British dominion. The main cause of this
adherence to national particularities and prejudices is certainly
the impolitic concession that was made to it, of a code of foreign
laws in a foreign tongue.
|
[Le Bas-Canada est en majeure partie habité
par une population qu'on peut appeler un peuple étranger, bien que
plus de soixante ans se soient écoulés depuis la Conquête. Cette
population n'a fait aucun progrès vers son assimilation à ses
concitoyens d'origine britannique par la langue, les manières, les
habitudes et les sentiments. Elle continue à quelques exceptions
près, d'être aussi parfaitement française que lorsqu'elle a été
transférée sous la domination britannique. La principale cause de
cette adhérence aux particularismes et aux préjugés nationaux est
certainement la concession insensée qui leur a été faite, d'un
code de lois étrangères dans une langue étrangère.] |
James Stuart est l'auteur
d'observations sur un projet d'union des provinces du
Haut-Canada et du Bas-Canada en une seule législature, respectueusement soumis à
Sa Majesté: Observations on the proposed union of the provinces of
Upper and Lower Canada, under one legislature, respectfully submitted to his
majesty's government, by the agent of the petitioners for that measure
(Londres, 1824): observations sur l'union des provinces du Haut et du Bas-Canada
en une seule législature, le tout respectueusement soumis au gouvernement de Sa
Majesté, par l'agent des pétitionnaires pour cette mesure.
John Henry (vers 1776-1853), un homme
de main du gouverneur Craig, proposa un projet d'Union en 1810 comprenant
une procédure électorale fondée sur des revenus élevés, un pouvoir accru du
gouverneur pour créer de nouveaux comtés anglophones, l'obligation pour les
députés de savoir lire, écrire et traduire de l'anglais, l'établissement
d'écoles anglaises dans les paroisses, l'imposition de l'anglais dans les
tribunaux dans un délai de cinq ans et dans la Chambre d'assemblée dans un
délai de sept ans. Pour John Henry, tant que les Canadiens français
conserveraient leur langue et leurs coutumes, ils représenteraient une
menace latente à la sécurité de la Grande-Bretagne. Dans cette perspective,
c'est l'Acte constitutionnel de 1791, qui était réellement responsable : il
avait donné le droit de vote à presque tous les hommes chefs de famille et
n'établissait pas de cens d'éligibilité pour les députés. Les solutions
proposées par Henry rencontraient les vues du gouverneur et de ses
conseillers, et il évitait les questions controversées.
Quant aux
francophones, ils ne se
considéraient nullement comme des Français, mais comme des Canadiens.
Ainsi, le journal Le Canadien écrivait dans
son édition du 21 mai 1831:
|
Il n'y a pas, que nous sachions, de peuple français en
cette province, mais un peuple canadien, un peuple religieux et moral, un peuple
loyal et amoureux de la liberté en même temps, et capable d'en jouir; ce
peuple n'est ni Français, ni Anglais, ni Écossais, ni Irlandais, ni Yanké, il
est Canadien.
|
 |
Dès 1805, les marchands
anglais avaient proposé l'union des deux Canadas. C'est pour combattre ce
mouvement que le journal Le Canadien fut fondé et aussi pour
s'opposer aux idées du journal anglophone The Quebec Mercury.
Le gouverneur James Henry
Craig suspendit Le Canadien parce qu'il s'opposait au
projet d'union des deux Canadas.
Cette époque fut caractérisée par les conflits entre
le gouverneur appuyé par les marchands anglais, et la majorité
parlementaire francophone: querelles religieuses, velléités
d'assimilation, crises parlementaires, guerre des «subsides», problèmes
d'immigration, projet d'union politique, etc.
En 1810, le gouverneur
Craig fit parvenir une dépêche au gouvernement britannique dans
laquelle il proposait une série de mesures afin de rétablir
l'harmonie au sein du Bas-Canada. |
Il fallait en venir à la
«nécessité d'angliciser la province», de prévoir le «recours à l'immigration
américaine massive pour submerger les Canadiens français», ainsi que
l'obligation de posséder «des propriétés foncières importantes» pour être
éligibles à l'Assemblée législative et surtout prévoir «l'union du Haut et
du Bas-Canada pour une anglicisation plus certaine et plus prompte». Voici
un extrait de la dépêche du gouverneur Craig:
For many years, English representatives have scarcely made up a
quarter of the total Assembly, and today out of fifty members
representing Lower Canada, only ten are English. One could posit
that this branch of government is entirely in the hands of
illiterate peasants under the direction of several of their fellow
countrymen whose personal importance, in contrast to the interests
of the country in general, depends on the continuation of the
current depraved system. [...]
The petitioners of Your Majesty cannot omit to note the excessive
scope of political rights that have been granted to this population
to the detriment of its fellow British subjects; and these political
rights, at a time when the population feels its strength growing,
have already given birth in the imagination of many to the dream of
a distinct nation called the “Canadian nation.” [...]
The French inhabitants of Lower Canada, today distanced from their
fellow subjects by their particularities and national prejudices,
and ardently aiming to become, through the current state of affairs,
a distinct people, would be gradually assimilated into the British
population and with it merge into a people of British character and
sentiment.
|
[Depuis nombre
d'années, la proportion des représentants anglais n'a guère atteint
un quart du nombre total de l'Assemblée et, à l'heure qu'il est sur
cinquante membres qui représentent le Bas-Canada, dix seulement sont
Anglais. On peut dire que cette branche du gouvernement est
exclusivement entre les mains de paysans illettrés sous la direction
de quelques-uns de leurs compatriotes, dont l'importance
personnelle, en opposition aux intérêts du pays en général, dépend
de la continuation du présent système vicieux. [...]
Les pétitionnaires de Votre Majesté ne peuvent omettre de noter
l'étendue excessive des droits politiques qui ont été conférés à
cette population, au détriment de ses co-sujets d'origine
britannique; et ces droits politiques, en même temps que le
sentiment de sa croissance en force, ont déjà eu pour effet de faire
naître dans l'imagination de plusieurs le rêve de l'existence d'une
nation distincte, sous le nom de «nation canadienne». [...]
Les habitants français du Bas-Canada aujourd'hui divisés de leurs co-sujets
par leurs particularités et leurs préjugés nationaux, et évidemment
animés de l'intention de devenir, grâce au présent état de choses,
un peuple distinct, seraient graduellement assimilés à la population
britannique et avec elle fondus en un peuple de caractère et de
sentiment britanniques.]
|
James Henry Craig, qui fut surnommé par les Britanniques "the Little King", est resté
pour les Canadiens l'un des gouverneurs les plus tyranniques de Québec. On a
parlé de son mandat comme du «règne de terreur». Peu
regretté, en raison des crises continuelles qu'il entretenait, il s'embarqua pour l'Angleterre en
juin 1811 pour y décéder en janvier 1812.
Au cours de cette même période, les
anglophones, pour leur part, ne se considéraient pas encore comme des Canadians. Ils
s'affirmaient encore comme des Britons (en français: Bretons) — ce qui
désignait alors les «Anglais» — et n'avaient d'autre appartenance qu'à la
«nation britannique», pas du tout à la «nation canadienne». Le terme anglais de
Canadians ne désignait qu'avec un certaine condescendance les
Canadiens de langue française.
8.2 Le rôle
des écoles
La première question à faire l'objet d'une lutte nationale fut la
Loi de l'Institution royale
de 1801. Le but de cette loi
était de soumettre
le système d'éducation au contrôle des autorités
religieuses anglicanes anglaises par la création d'écoles
gouvernementales («royales»), publiques et gratuites. Ce faisant, les fabriques
paroissiales étaient remplacées par les écoles royales moyennant une taxe
scolaire. Cette loi
représentait la première prise en charge de l'éducation par l'État, bien que la
contribution financière du gouvernement était réduite à la rémunération des
maîtres.
Il faut dire que la situation scolaire à cette époque au Bas-Canada
était tout simplement déplorable. Depuis l'établissement du Régime britannique,
la population était devenue majoritairement analphabète, souffrait d'une grave
pénurie de maîtres qualifiés et de manuels scolaires, sans compter que les
parents refusaient de payer la taxe scolaire. Cette initiative de
renouvellement de l'instruction publique, qui était due à l'évêque anglican de Québec (Jacob Mountain) et
à l'administrateur du Bas-Canada (Robert Shores Milnes), demeura sans grand effet.
Par exemple, entre 1801 et 1818, les écoles «royales» passèrent de 4 à 35, dont
11 seulement furent implantées en milieu francophone. En 1829, on comptait 84
écoles, mais la loi «des écoles de syndics» fit diminuer le nombre des «écoles
royales», qui passa de 69 en 1832 à uniquement trois en 1846.
Soulignons que la hiérarchie catholique craignait comme la peste la création
des écoles d'État gratuites, car elle avait en tête la hantise de
l'assimilation. De plus,
Hugh Finlay, directeur
général des Postes et membre du
Conseil législatif en 1789
craignait aussi de voir
les Canadiens élire des députés canadiens qui constitueraient une assemblée mal
adaptée à gouverner un pays commerçant et qui feraient des lois pour conserver
le droit français et la coutume canadienne.
Toutefois, la population francophone,
soutenue par le clergé catholique, refusa d'envoyer ses enfants dans les écoles
«royales» et, à l'occasion, n'hésita même pas à les brûler. Malgré les difficultés, les écoles se multiplièrent. En 1790, les Canadiens français ne possédaient qu'une
quarantaine d'écoles pour quelque 160 000 habitants, soit une moyenne d'une
école pour 4000 habitants, tandis que les Anglais en avaient 17 pour 10 000
habitants, soit une pour moins de 600 habitants. Quant au taux
d'alphabétisation, il descendit jusqu'à 13 % en 1779, et même à 4 % en 1810, pour se
relever lentement (entre les décennies 1820 et 1850) jusqu'à 27 % vers 1850. Les francophones prirent
ainsi un retard qu'ils ne combleront qu'au XXe
siècle, alors que le taux d'alphabétisation atteindra les 75 %, ce qui était
considéré comme une «alphabétisation générale». Ce retard dramatique au
point de vue scolaire fut, selon plusieurs historiens, surtout dû au refus
opposé par le clergé au système scolaire proposé par le gouvernement
britannique.
À la suite des pressions intenses exercées par le clergé catholique, le
Parlement du Bas-Canada adopta en 1824 la Loi des écoles de fabriques,
destinée aux franco-catholiques. Cette loi modifiait considérablement le régime
centralisé établi en 1801. C'étaient dorénavant les fabriques paroissiales,
c'est-à-dire le curé et les marguillers, qui avaient la responsabilité de
construire et d'administrer les écoles primaires. La paroisse devint l'unité
fondamentale du système social de la province de Québec. En quelques années, la
loi favorisa l'instauration de 48 écoles «de fabriques». Mais ce nombre parut
nettement insuffisant, car en 1828 la plupart des enfants n'y avaient pas accès.
En effet, plus de 90 % des enfants en âge de fréquenter l'école n'avaient pas
d'écoles à leur disposition, faute d'argent dans la paroisse de résidence.
Afin de remédier aux problèmes des
paroisses plus pauvres, l'Assemblée législative adopta en 1829 la Loi des
écoles de syndics, qui prévoyait le versement aux communautés locales de
subventions publiques dans le but de favoriser la construction de bâtiments
scolaires, l'État assumant la moitié des coûts. Cependant, la loi scolaire
exigeait aussi que les syndics élus dans chaque paroisse devaient rendre compte,
deux fois par année, des activités de leurs écoles devant le Parlement du
Bas-Canada. La loi prévoyait aussi la création d'écoles normales afin d'assurer
une meilleure formation des enseignants; en même temps, était institué le poste
d'inspecteur scolaire. Ces mesures tout à fait nouvelles se faisaient
nécessairement au détriment du clergé local qui se voyait dépossédé de son
implication en matière d'éducation. La Loi des écoles de syndics permit
la construction de plus de 1500 écoles en quelques années.
Toutefois, la loi dut être abrogée en
1836 en raison du refus du Parlement de reconduire le budget annuel de
fonctionnement. La plupart des écoles ouvertes depuis 1829 durent fermer leur
porte. Pendant plus de six ans, la province du Bas-Canada fut laissée sans
structure scolaire. La plupart des enseignants
du Bas-Canada étaient des laïcs, car il n'y avait pas eu
de nouvelles communautés religieuses enseignantes depuis la Conquête. La
situation changera du tout au tout après l'Union de 1840 avec l'arrivée de
communautés françaises et la fondation de communautés religieuses canadiennes. Peu à
peu, les membres du clergé, tant chez les hommes que chez les femmes
deviendront majoritaires dans les écoles, sauf au primaire où les laïcs
resteront plus nombreux.
En 1846,
une nouvelle loi apporta un certain apaisement à l'opposition scolaire dans les
campagnes. Les commissaires d'écoles furent élus, tandis que les subventions
gouvernementales demeurèrent proportionnelles à la cotisation (volontaire) des
habitants.
8.3 L'influence des journaux
Fait
significatif, dès le début du Régime britannique, les journaux furent
bilingues. Le premier journal, fondé en juin 1764, s'appelait La Gazette de
Québec / The Quebec Gazette (voir l'exemple du 24
juillet 1788). Sur les 14 titres créés entre 1764 et
1814, neuf le furent à Québec et cinq à Montréal. Cinq journaux étaient publiés
en anglais, quatre en français et cinq étaient bilingues. La présence des
journaux et des imprimeurs n'était possible que dans les seules villes de Québec
et de Montréal en raison de la concentration des habitants et de leur taux
d'alphabétisation.
Bien souvent, le texte
anglais apparaissait en premier, le texte français en traduction en second; ou
bien le texte anglais occupait la colonne de gauche, traditionnellement
privilégiée, le français occupant celle de droite. Quoi qu'il en soit, la
plupart de sujets choisis étaient puisés à même les journaux étrangers, presque
exclusivement d'origine britannique ou américaine. Dans ces conditions, la
version française était obligatoirement une traduction. On devine l'arrivée
massive de la terminologie anglaise dans les journaux de l'époque. Cette
pratique du bilinguisme dans les journaux se perpétuera jusqu'au
XIXe
siècle.
En 1790, on ne comptait qu'une quarantaine
d'agglomérations de plus de 1000 habitants. Sept villes avaient plus de 2000
habitants: Québec, Montréal, Trois-Rivières, L'Assomption, Berthier-en-Haut,
Saint-Eustache et Varennes. Au tournant du
XIXe siècle, la taille
démographique de Montréal dépassera celle de Québec, tout en étant
majoritairement anglophone.
Entre 1815 et 1840, au moins 50 % des
titres publiés dans la presse étaient en anglais, alors que les locuteurs de
cette langue ne constituaient encore qu'environ 15 % de la population. De même,
ce sont les anglophones qui fréquentaient les bibliothèques. Il n'est donc pas
surprenant que les anglophones du Bas-Canada aient un taux d'alphabétisation et
d'instruction plus élevé que celui des francophones. La plupart d'entre eux
habitaient dans les villes et, étant de religion protestante, lisaient
régulièrement la Bible.
8.4 Les
partis politiques
Dans le domaine politique, les députés francophones devirent de plus en plus agressifs
et se regroupèrent dans un parti politique, le Parti canadien, tandis que
les anglophones se rassemblèrent dans le Tory Party (ou Parti loyaliste). Chaque groupe posséda
son propre journal: Le Canadien (Parti canadien) et le Quebec Mercury
(Tory Party) s'invectivaient à qui mieux mieux. Les antagonismes s'accrurent entre francophones
et anglophones, et les débats s'envenimèrent. Le 27 octobre 1806, un certain
Anglicanus attaquait les Canadiens en ces termes dans le Quebec
Mercury:
|
This province is already too much
a French province for an English colony. To unfrenchify it, as much as
possible, if I can use this expression, should be the primary object. To
oppose [French power] is a duty. To assist it...is criminal [...]. After
forty seven years possession of Quebec it is time the Province should be
English.
|
[Cette province est déjà beaucoup trop française pour
une colonie anglaise. La défranciser devrait, autant que possible, si je peux me
servir de cette expression, être notre premier objectif. Résister
[au pouvoir des Français] est un devoir. Le soutenir est... criminel
[...
]. Après quarante sept ans de possession du Québec, il est temps d'en faire
une province anglaise.] |
 |
Les Britanniques réclamaient
l'union des deux Canadas et parlaient ouvertement d'assimilation pendant que
les Canadiens dénonçaient le favoritisme, la corruption et l'arbitraire
du gouverneur et des Conseils. Les francophones exigeaient un Conseil
législatif élu, le contrôle des dépenses gouvernementales,
le maintien du régime seigneurial et menaçaient même de
s'annexer aux États-Unis. Le gouverneur Craig tenta quelques coups de
force et réussit à dissoudre arbitrairement certaines Chambres d'assemblée.
Francophones et anglophones s'installèrent pendant plusieurs années
dans une intransigeance opiniâtre qui eut pour effet de paralyser totalement
l'État. Lorsque les députés Louis-Joseph Papineau et Robert Nelson commencèrent
à galvaniser le peuple excédé par la crise économique,
l'inflation, le chômage, les épidémies de choléra,
les mauvaises récoltes et le pourrissement politique, le conflit était mûr pour
un affrontement armé. |
8.5 La
révolte des Patriotes
La décennie de 1830 fut propice en
événements politiques dans le monde, notamment la montée des nationalités en
Europe. Il était fréquent que les Canadiens français de l'époque puissent
comparer leurs conditions coloniales au Bas-Canada avec la situation de
dépendance ou d'émancipation en Pologne, en Italie, en Belgique, en Grèce,
en Irlande, en Amérique du Sud, etc. La création de la Belgique en 1830
semblait présenter des problèmes politiques similaires à ceux rencontrés par
les Canadiens français : conflits entre une Chambre haute et une Chambre
basse, représentation égale et non proportionnelle, partage de la dette,
droits des catholiques, confrontations entre deux langues, etc. Il convient
de mentionner aussi la poussée du républicanisme américain tant au
Bas-Canada qu'au Haut-Canada. Or, les Britanniques avaient espéré convaincre
leurs anciennes colonies d'abandonner leur système de gouvernement
démocratique en conservant au nord un système colonial monarchique et
loyaliste. Au lieu de cela, la démocratie américaine s'étendit au Canada,
surtout au Haut-Canada, avec l'arrivée de groupes importants d'immigrants
américains qui menèrent les revendications pour une réforme.
- Les assemblées populaires
Les leaders des Patriotes tinrent des assemblées publiques et
dénoncèrent les injustices, surtout le fait que le pouvoir soit
entre les mains de la minorité anglophone. Londres prit position sur
les 92 Résolutions des Patriotes de 1834, qui demandaient, entre autres,
l'élection du Conseil législatif, la responsabilité ministérielle et le
contrôle du budget par l'Assemblée. Le 6 mars 1837, la Chambre des communes
de Londres rejeta en bloc celles des Patriotes; elle alla jusqu'à permettre
au Conseil exécutif d'outrepasser l'autorité de la Chambre d'assemblée en
matière budgétaire. Bref, Le ministre John
Russel retirait à l'Assemblée le seul pouvoir qu'elle possédait: le vote des
subsides. Pour lord Russel, il n'était pas question d'abandonner «the
Province to the French Party».
En même temps, la détermination patriotique des Anglo-Montréalais monta
d'un cran: des associations loyalistes furent créées pour dénoncer les
prétentions déloyales des Canadiens français à la Royauté et à l'Empire.
Le Doric Club, fondé par Adam Thom, fit
beaucoup parler de lui par ce que cette association de loyalistes anglais
étaient également un club social et une société armée qui tentaient de faire
valoir des droits et des privilèges spéciaux pour les Anglais face à la
«menace patriote». En février 1836, Adam Thom avait publié Anti-Gallic
Letters («Lettres anti-gauloises»), un recueil d'écrits originellement
parus dans le Montreal Herald sous le pseudonyme de Camillus entre
septembre 1835 et janvier 1836, qu'il adressait au gouverneur Gosford.
 |
Devant le cul-de-sac
politique, les députés du Parti patriote optèrent pour une stratégie
extra-parlementaire et organisèrent des assemblées populaires afin
de débattre de leurs idées et de leurs revendications. Il y en a eu
non seulement à Montréal et à Québec, mais aussi à la Malbaie, à
Yamachiche, à Portneuf, à Saint-Ours-sur-Richelieu, etc. Considérant
ces assemblées populaires comme dangereuses, le gouverneur Gosford
finit par les déclarer illégales. Le 17 juin 1837, la proclamation
de Gosford fut affichée partout. Celle-ci
affirmait que les assemblées populaires
constituaient une atteinte à la paix et visaient à retirer
l'allégeance de la population à la monarchie. Pour assurer la paix
et le bon ordre, le gouverneur interdit les publications séditieuses
et les assemblées populaires.
|
Or, la proclamation du
gouverneur contribua à dégrader un climat social déjà tendu. Les assemblées
se poursuivirent de plus belle un peu partout dans toute la colonie du
Bas-Canada. Devant la montée de l'agitation sociale jusque dans les dans les
régions rurales, Gosford fit venir des renforts militaires des Maritimes. Au
mois d'août 1837, il dissout l'Assemblée législative lorsque le Parti
patriote refusa de voter son budget.
- La révolte
armée
La révolte armée des Patriotes éclata à l'automne de
1837. Dès le mois d'octobre, toutes les troupes britanniques régulières furent
retirées du
Haut-Canada (Toronto) et transférées au
Bas-Canada. Au mois de
novembre, Gosford fit arrêter plusieurs partisans du chef du Parti patriote,
Louis-Joseph Papineau, tandis que celui-ci fuyait aux États-Unis. La loi
martiale fut décrétée au Bas-Canada, mais malade le gouverneur Gosford dut
donner sa démission et retourner en Angleterre. Les pouvoirs furent alors
assumés par le major général John Colborne, commandant des troupes
britanniques au Canada.
Pendant ce temps, de nombreux
imprimeurs, rédacteurs de journaux et libraires avaient joint les rangs des
Patriotes : Duvernay de La Minerve, François Cinq-Mars qui avait
fondé L'Aurore des Canadas et imprimé L'Abeille canadienne et
Le Diable bleu; François Lemaître qui a imprimé Le Libéral,
La Quotidienne, la Gazette patriotique, la Quebec Commercial
List et Le Journal de médecine de Québec; Louis Perrault,
imprimeur du Vindicator; Hiram-F. Blanchard qui, à Stanstead,
publiait le Canadian Patriot dans son atelier; Silas-H. Dickerson qui
publiait la British Colonist and St. Francis Gazette; Napoléon Aubin
et Adolphe Jacquies du Fantasque; Jean-Baptiste Fréchette,
propriétaire du Canadien; Robert Bouchette, rédacteur du Libéral;
Boucher-Belleville de L'Écho du Pays de Saint- Charles; etc. Cette
presse de la bourgeoisie de professions libérales et du Parti patriote
déplut fortement au clergé qui voyait ainsi le pouvoir de la chaire
contesté.
- La
rébellion du Haut-Canada
Au même moment, le Haut-Canada
vivait aussi ses soubresauts politiques avec les députés réformistes, très
sensibilisés aux idéaux démocratiques des Américains. William Lyon Mackenzie
était l'un des réformistes les plus radicaux au Haut-Canada. Lorsque la
rébellion du Bas-Canada éclata à l'automne 1837, Francis Bond Head, le
lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, accepta d'envoyer les troupes
britanniques établies à Toronto pour aider à réprimer la révolte patriote.
Constatant l'absence des troupes régulières, Mackenzie et ses partisans
saisirent l'armurerie de Toronto et organisèrent en décembre 1737 une marche
armée sur Yonge Street. Les 800 "Patriots" de Mackenzie avaient décidé de
renverser le gouvernement et de proclamer une république.
Quoi qu'il en soit, il faut
rappeler que les rébellions du Bas-Canada et du Haut-Canada sont le résultat
d'une suite d'escalades et de crises coloniales qui avaient commencé en
1810, alors que James Craig était gouverneur Craig, ainsi que d'un premier
projet d'Union en 1811, suivi d'un second projet plus sérieux en 1822, puis
d'un Comité de la Chambre des communes sur les affaires du Canada en 1828.
Ces tergiversations du gouvernement britannique menèrent aux 92 Résolutions
des Canadiens, à la Commission Gosford de 1835, ainsi qu'aux résolutions de
lord Russell de 1837. Dans les faits, les rébellions sont davantage
l'aboutissement d'une crise décennale mal gérée par les autorités
britanniques et coloniales.
- La
position du clergé
Durant toute la rébellion, le
clergé catholique, qui savait où était ses intérêts, prêchait la loyauté, la
soumission et la résignation. De même, tous les seigneurs, sauf Papineau, se
rangèrent du côté du pouvoir. Cette lettre pastorale, datée du 24 octobre
1837, de Mgr
Jean-Jacques Lartigue, alors évêque du
district de Montréal (1821-1836), est révélatrice de cette
attitude:
|
Que tout le monde, dit saint Paul aux Romains, soit
soumis aux puissances qui viennent de Dieu. Et c'est lui qui a établi toutes
celles qui existent. Celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à
l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent acquièrent pour eux-mêmes la
damnation. Le prince est le ministre de Dieu pour procurer le bien. Et comme
ce n'est pas en vain qu'il porte le glaive, il est aussi son ministre pour
punir le mal. Il vous est donc nécessaire de lui être soumis non seulement
par crainte du châtiment, mais aussi par un devoir de conscience. [...] Et
vous devez voir à présent que nous ne pouvions, sans blesser nos devoirs et
sans mettre en danger notre propre salut, omettre d'éclairer votre conscience
d'un pas si glissant.
|
C'est ainsi que, lors d'un
sermon prononcé dans l'église de Sainte-Anne-des-Plaines (ville à environ 40
km au nord de Montréal), le dimanche 11
novembre 1838, le curé Isidore Poirier faisait ainsi connaître la position
de l'Église catholique :
|
Vous ne sauriez ignorer, mes frères, quels sont les
devoirs que vous devez rendre à César, c'est-à-dire au
roi, ou à la puissance souveraine; depuis un an surtout,
on vous les a expliqués amplement... Cependant comme il
y a encore parmi vous des têtes dures, qui font semblant
de ne rien comprendre, pour se livrer sans remords à la
fureur de leurs passions, je profite de ces dernières
paroles de notre évangile, pour vous remettre de nouveau
sous les yeux la vérité sous tout son jour. [...]
Rappelez-vous encore ce que notre évêque nous a écrit
l'année dernière. Je vais vous en répéter quelques
mots... Tous ceux qui meurent les armes à la main contre
leur souverain sont réprouvés de Dieu et condamnés à
l'enfer. L'Église a tant d'horreur d'une insurrection
qu'elle refuse d'enterrer dans les cimetières ceux qui
s'en rendent coupables; qu'on ne peut être absous, ni
recevoir aucun autre sacrement, sans faire un énorme
sacrilège. [...]
C'est
vous, au contraire, patriotes insensés, qui voulez,
malgré le gouvernement, détruire notre sainte religion
sous le prétexte mensonger de la rétablir. Quoi! Vous
dites que vous êtes attachés à votre patrie, que vous
travaillez pour le soutien de la religion et par le plus
fanatique et le plus aveugle de tous les entêtements,
vous détruisez la patrie et la religion. Vous forcez le
gouvernement de brûler les églises, les villages et les
campagnes; vous vous vantez d'être des patriotes
religieux et vous ne parlez que de tuer, fusiller,
massacrer les prêtres, les évêques, et tout ce qu'il y a
dans le pays de citoyens respectables. Quel affreux
patriotisme! Quelle affreuse religion! L'enfer a-t-il
jamais inventé rien de plus horrible, de plus exécrable?
Pauvres brebis égarées... entrez dans la voie de la
soumission et de la subordination aux autorités
légitimes; rendez à César ce qui appartient à César;
soyez obéissants, respectueux, soumis et reconnaissants
envers les puissances que Dieu a établies pour vous
gouverner. |
Ce genre de discours alors que
le pays était encore en pleine effervescence insurrectionnelle ne pouvait
que terroriser le bon peuple.
- L'échec
des rébellions
Les
troupes rebelles du Bas-Canada ne pouvaient faire le poids devant
l'imposante force militaire coloniale, sous les ordres de John Colborne,
complétée par un grand nombre de miliciens orangistes loyaux venant du
Haut-Canada.
 |
Comme il fallait s'y attendre, l'armée britannique écrasa
rapidement la rébellion en répandant la terreur, en pillant et en brûlant
plusieurs villages, dont Saint-Eustache (à
20 km au nord-ouest de Montréal). Des paroisses entières furent pillées et brûlées par les
troupes et les volontaires de Colborne, en toute impunité. De plus, le 21
avril 1838, le Conseil spécial suspendit par une ordonnance l'habeas
corpus dont bénéficiaient les sujets britanniques, c'est-à-dire le droit
de ne pas être emprisonné sans jugement.
Dès lors, les autorités coloniales purent détenir les habitants
sans mandat. Puis du 5 au 24 novembre 1838, le Conseil spécial
adopta onze ordonnances pour retirer les droits élémentaires à
tous ceux qui ne partageaient pas les convictions politiques de
la minorité loyale.
|
Pire, l'ordonnance du 8
novembre permettait aux autorités de faire comparaître n'importe quel civil
devant une cour martiale, même en temps de paix. Parmi les 855 Canadiens français arrêtés,
108 furent accusés de haute trahison». De ces derniers, 58 furent déportés en Australie et
12 furent pendus à la
prison au Pied-du-Courant à Montréal, le 15 février 1839.
Mais la rébellion du
Haut-Canada fut brève et, par comparaison avec celle du Bas-Canada, les
conséquences pour la population furent minimes. William Lyon Mackenzie fut
emprisonné aux États-Unis où il s'était enfui et Bond Head fut rappelé en
Angleterre. Une amnistie permit à Mackenzie de rentrer au Canada en 1849, où
il devint membre de l'Assemblée législative du Canada-Uni de 1851 à 1858. En
somme, bien que le Haut-Canada ait été le théâtre d'affrontements similaires
au Bas-Canada, seul ce dernier subit les mesures d'exception décrétées par
le gouvernement colonial, lesquelles violaient les règles les plus
fondamentales du constitutionnalisme britannique.
Au Bas-Canada, le régime de la
loi martiale a été proclamé, dans le district de Montréal, du 5 décembre
1837 au 24 avril 1838, et du 4 novembre 1838 au 24 août 1839. Or, selon les
lois britanniques de l'époque, toute loi martiale ne devait être en vigueur
tant que la guerre durait ("while war is still raging") et elle devait être
abrogée dès que cessaient les hostilités. Dans le cas du
Bas-Canada, la loi
martiale fut imposée pendant quinze mois, alors que l'insurrection n'avait
duré que quelques jours. Pour certains historiens, dont F. Murray Grenwood, les procédures de la Cour martiale en 1838 et 1839 dans le Bas-Canada,
constitueraient «le pire exemple, dans l'histoire du Canada, de l'abus de
l'appareil judiciaire» (cité par
J.-M. Fecteau, 1987).
Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer l'échec des rébellions.
(1) Les dissensions et le manque évident d'unanimité dans le mouvement des
patriotes (ou des "patriots") constituent la première raison de l'échec; il
y avait des patriotes réformistes, des patriotes radicaux et des patriotes
républicains.
(2) Il y eut aussi de nombreuses oppositions à la position des
patriotes: les seigneurs, le clergé, la population «ordinaire», les
loyalistes, le gouvernement colonial, les députés londoniens, etc.
(3) Une
troisième raison fut le manque de moyens financiers et militaires, dont le
manque d'armes et de munitions, sans oublier l'absence d'encadrement
militaire.
(4) À cela s'ajoute le manque d'appuis extérieurs; ceux qui devaient
ou pouvaient venir ne vinrent pas; en France, on ne pouvait pas comprendre
que Papineau puisse vouloir d'une indépendance aidée par les États-Unis au
risque voir réduire la langue et la culture françaises.
(5) La dernière raison,
et non la moindre, était la formidable puissance militaire des Britanniques
qui possédaient la plus grande armée du monde; les cuillères fondues en
balles, les vieux fusils de chasse et les faux ne pouvaient rivaliser avec une armée bien équipée et bien expérimentée.
Pendant la rébellion bas-canadienne, à Londres, lord Russel
proposait de suspendre la Constitution de 1791 et de mettre en place un
gouverneur en conseil comme forme de pouvoir provisoire et d'envoyer lord
Durham avec mission d'enquêter sur la situation des provinces britanniques
d'Amérique du Nord. John George Lampton
(1792-1840), premier comte de Durham, était un noble anglais immensément
riche. Il parlait un français impeccable et était ouvert aux idées
républicaines et aux minorités.
8.6 Le rapport Durham
et la politique d'assimilation
 |
Dépêché d'urgence par Londres,
lord Durham débarqua
à Québec le 27 mai 1838 en ayant pour mission d'enquêter et de faire
rapport sur la situation au Canada. La société française qu'il connaît est celle
de la France contemporaine, celle de la Révolution, de Napoléon
et de la Restauration. Sa perception à l'égard des Canadiens de
langue française ne pouvait pas être très positive. Alors que la
France avait changé non seulement dans ses valeurs sociales et
religieuses, mais aussi dans sa langue, sa phonétique et son
accent, bref dans sa manière de parler le français, la langue
parlée par les Canadiens n'ont guère impressionné ce riche lord
anglais. La «province of Quebec» lui paraissait rétrograde par
sa langue, par la soumission des représentants d'une Église
catholique provincialiste encore attachée à l'ancien Régime
français d'avant la Révolution. Cette mentalité passéiste des
habitants francophone de la colonie ne pouvait que choquer ce
noble Anglais qui voyait dans les Canadiens des attardés n'ayant
pas renoncé à leur passé «Nouvelle-France».
On ne peut que rappeler ces mots de lord Durham
sur les
francophones du Canada qui étaient restés «une société vieille et
retardataire dans un monde neuf et progressif»:
|
Les Canadiens français sont restés une
société vieille et retardataire dans un monde neuf et progressif.
En tout et partout, ils sont demeurés français, mais des
Français qui ne ressemblent pas du tout à ceux de France.
Ils ressemblent aux Français de l'Ancien Régime.
|
|
Lors Durham parcourut les deux Canadas,
discuta avec le réformiste Robert Baldwin à Toronto, séjourna quelques jours
au manoir du riche commerçant Edward Ellice à Beauharnois, subit patiemment
les doléances des marchands anglais de Montréal, etc. Il décida d'abolir le
régime seigneurial sur l'île de Montréal, créa un corps de police, forma
plusieurs commissions chargées d'enquêter sur les institutions municipales,
l'éducation et les terres de la Couronne. Lord
Durham recourut aux services d'Adam Thom, le rédacteur en chef du
Montreal Herald, qui détestait les Canadiens, à titre de conseiller sur
les questions municipales. Toutefois, lord Durham n'a jamais
cherché à entrer en contact avec les représentants canadiens. D'après
le premier secrétaire de Durham, Charles Buller (1806-1848), son
opinion sur les Canadiens était déjà fixée avant même d'arriver à Québec.
Voici ce qu'il écrivit en 1840 à propos de lord Durham:
|
Dès le départ, Lord Durham prit une position résolue sur la question, il vit l'esprit malicieux et étroit qui logeait au cœur
de toutes les actions des Canadiens français ; et s'il était disposé à rendre
justice et à pardonner aux individus, il prit le parti de n'accorder aucun
crédit à leurs absurdes prétentions raciales. Son unique objectif était de
rendre le Canada véritablement britannique. |
Pour Durham, aucune concession ne pouvait satisfaire les rebelles
canadiens-français. Au contraire de lord Durham, qui selon lui «en voulait
trop aux Canadiens français en raison de leur récente insurrection», Charles
Buller était bien disposé à leur égard; il croyait plutôt que de «longues
années d'injustice» et «la déplorable ineptie de [la] politique coloniale»
britannique les avaient poussés à se rebeller. Assisté d'abord par
Charles Buller et d'un expert en colonisation, Edward Gibbon Wakefield
(1796-1862), ainsi que par un commissaire adjoint, sir Richard Davies
Hanson, Durham rédigea son rapport en un temps record. Dans les faits, c'est
son secrétaire, Charles Buller, qui a rédigé la plus grande partie du
rapport, même si c'est lord Durham qui en assumait la responsabilité.
Au lieu de proposer une analyse juste de la situation au Canada, lord Durham
reprit simplement la vision condescendante de l'oligarchie loyale. Il n'a
jamais reconnu un quelconque bien-fondé des arguments présentés par les
partis réformistes qui désiraient modifier en profondeur les institutions de
la colonie. S'il a pu appréhender les faiblesses de la Constitution
anglaise de 1791, il n'a pas été capable ni même tenté de comprendre les
revendications démocratiques des Patriotes et des Canadiens français. Durham n'a
jamais compris que le Conseil législatif du
Bas-Canada était une structure
essentiellement anglophone, non élue, et la principale cause des
revendications des réformistes. Il a encore moins compris que la dimension
républicaine et anticoloniale des doléances des Patriotes, ni la colère du
peuple contre une élite seigneuriale qui, dans un contexte de rareté des
terres, abusait de ses privilèges.
Pour Durham, le gouvernement impérial serait dans l'erreur s'il prenait au
sérieux les doléances des dirigeants canadiens qui font référence à la
«liberté des peuples» du Nouveau Monde, sinon au modèle américain. À ses
yeux, les Canadiens étaient dirigés par des «fourbes» qui manipulaient une
population «amorphe» et «décidément inférieure aux colons anglais». Les
revendications des «rebelles» ne méritaient même pas, selon lui, qu'on s'y
attarde. Par contre, les réformes demandées par les marchands anglais lui
semblaient appropriées: l'octroi du gouvernement responsable, puis l'union
du Haut et du Bas-Canada.
Son rapport à l'appui, lord Durham allait préconiser une série de mesures
assimilatrices. On aurait intérêt à lire à ce sujet quelques-unes des
recommandations de lord Durham reproduites dans le texte
ci-joint (cliquer ici, s.v.p.).
L'objectif final est clair:
|
Sans opérer le changement ni trop vite ni trop rudement
pour ne pas froisser les esprits et ne pas sacrifier le
bien-être de la génération actuelle, la fin première et
ferme du Gouvernement britannique doit à l'avenir
consister à établir dans la province une population de
lois et de langue anglaises, et de n'en confier le
gouvernement qu'à une Assemblée décidément anglaise.
|
D'après Durham, le fait de mettre les francophones dans un état de subordination
politique et démographique devait permettre de les angliciser et d'assurer une
majorité anglaise, donc loyale à Sa Majesté britannique. D'où la nécessité de
peupler rapidement le Bas-Canada de «loyaux sujets de Sa Majesté»
et d'unir les deux Canadas, voire de former ultérieurement une fédération de
toutes les colonies britanniques de l'Amérique du Nord dans laquelle les Canadiens
de langue française seraient définitivement mis en état de minorisation
(sujétion).
Durham considérait que les différences ethniques et linguistiques étaient à l'origine
des difficultés dans le Bas-Canada et que laisser subsister ces différences
ne ferait qu'aggraver la situation. Il a choqué les Canadiens français
pour avoir affirmer que «c'est un peuple sans histoire et sans littérature»:
|
There can
hardly be conceived a nationality more destitute of all that
can invigorate and elevate a people, than that which is
exhibited by the descendants of the French in Lower Canada,
owing to their retaining their peculiar language and manners.
They are a people with no history, and no literature. The
literature of England is written in a language which is not
theirs; and the only literature which their language renders
familiar to them, is that of a nation from which they have
been separated by eighty years of a foreign rule, and still
more by those changes which the Revolution and its
consequences have wrought in the whole political, moral and
social state of France |
[On ne peut guère concevoir nationalité plus dépourvue de
tout ce qui peut vivifier et élever un peuple que les
descendants des Français dans le Bas-Canada, du fait qu'ils
ont gardé leur langue et leurs coutumes particulières. C'est
un peuple sans histoire et sans littérature. La littérature
anglaise est d'une langue qui n'est pas la leur ; la seule
littérature qui leur est familière est celle d'une nation
dont ils ont été séparés par quatre-vingts ans de domination
étrangère, davantage par les transformations que la
Révolution et ses suites ont opérées dans tout l'état
politique, moral et social de la France.] |
|
Pourtant, lord Durham avait raison sur cet aspect de l'Histoire, car la colonisation avait été en
partie responsable de la situation peu enviable des francophones. En effet, l'histoire
des Canadiens avait été celle de la France, puis celle de la
Grande-Bretagne. C'est la Couronne britannique qui avait contribué à donner à
l'Église catholique une plus grande importance politique et identitaire, ce que
Durham trouvait rétrograde. Les Canadiens n'avaient ni historiens, ni écrivains, ni
dramaturges pour raconter leur passé: c'était bel et bien une triste réalité.
Le «grand réveil» allait se produire après
la publication du rapport de Durham, avec l'arrivée de l'historien François-Xavier Garneau (Histoire du Canada, 1845),
des écrivains Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (Charles Guérin, 1846),
Georges de
Boucherville (Une de perdue, deux de trouvées, 1849), Philippe-Aubert de
Gaspé (Les Anciens Canadiens, 1863), ainsi que des célèbres poètes Octave
Crémazie (1827-1879) et Louis Fréchette (1839-1908). L'historien
Garneau sera celui qui aura une influence déterminante, car c'est lui qui
façonnera ou magnifiera les personnages historiques dans l'imaginaire québécois.
De plus, ses thèses patriotiques seront reprises par l'abbé Henri-Raymond Casgrain (1831-1904), l'abbé Lionel Groulx (1878-1967) et l'historien Guy
Frégault (1918-1977). Toute l'histoire des francophones du Québec sera définie
pour longtemps comme une «Bible», contre laquelle il ne faudra pas déroger,
grâce au premier historien F.-X. Garneau.
Ainsi, l'échec de la rébellion de 1837-1838
allait entraîner
des conséquences déterminantes pour le développement
de la société canadienne-française. Profondément
déçus et humiliés, les habitants se replièrent davantage
sur eux-mêmes et se résignèrent à leur sort. Pendant
plus d'un siècle, ils se retranchèrent dans la soumission, la religion,
l'agriculture et le conservatisme.
En réalité, les Britanniques ne pouvaient pas prévoir la réaction de défense
et d'identité de la part des Canadiens de langue française, ni leur réveil
pour conserver leur culture et leur langue.
8.7 L'Union politique du Haut-Canada et du Bas-Canada
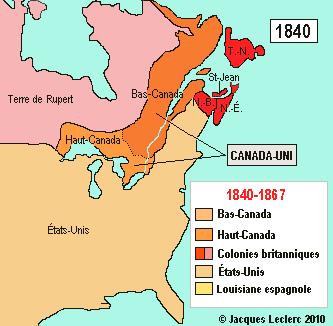 |
En juillet 1840, le
Parlement britannique dota ses colonies du Haut-Canada et du
Bas-Canada d'une nouvelle constitution. Ce fut l'Acte
d'Union. Le titre complet en anglais était le suivant:
The Union Act, 1840, An Act to reunite the Provinces of Upper and
Lower Canada and for the Government of Canada, Statutes of Great
Britain (1840) 4 Vict., chapter 35.
Cette loi abolissait les deux colonies et leur assemblée
législative, qui existaient depuis l'Acte constitutionnel de 1791.
La nouvelle loi constitutionnelle créait une seule colonie sous
l'administration d'un gouverneur-général. Le pouvoir législatif
était détenu par le Parlement de la «Province of Canada», comprenant
l'Assemblée législative (chambre basse, élue) et le Conseil
législatif (chambre haute, nommée). La nouvelle colonie, la
«Province of Canada», fut proclamée le 10 février 1841. Par voie
de conséquence, le Haut-Canada et le Bas-Canada n'existaient plus,
mais l'appellation «Bas-Canada» se perpétuera jusqu'au
XXe
siècle par les Canadiens
français.
|
9
L'état de la langue française sous le Régime britannique
Dans le domaine de la langue elle-même, le français du Canada ne
subit plus de dirigisme de la part des élites françaises puisque celles-ci avaient regagné la France.
En même temps, les Canadiens ne purent connaître les nombreuses transformations
linguistiques qui ont lieu en France, notamment après la révolution de 1789. Or,
la Révolution entraîna la montée de nouvelles classes sociales, qui
introduisirent peu à peu leurs normes. Les francophones du Canada ne se plièrent
pas aux nouveaux usages parce qu'ils ne les connaîtront que plusieurs décennies
plus tard.
Dans les circonstances, le français d'Amérique commença
à évoluer dans un sens différent de celui d'Europe.
Certains particularismes phonétiques et lexicaux, apportés
par les colons des XVIIe et
XVIIIe siècles,
et qui avaient tout de même survécu malgré l'implantation
du français commun, réapparurent, libres désormais
de toute entrave. En même temps, la langue des Canadiens français s'imprégna
de fortes influences normandes et poitevines, en raison de l'important
apport démographique de ces deux provinces de France. Parallèlement,
son caractère populaire s'accentua, alors que les emprunts à
l'anglais commencèrent à s'introduire en grand nombre.
9.1 Un français différencié
Aussi, il n'est pas surprenant de constater que,
dès le début du XIXe
siècle, les différences entre le français de France
et celui du Canada étaient déjà très prononcées. Lorsqu'on
lit les témoignages relatifs à cette époque du régime
britannique, il n'est plus question de «pureté» de la langue chez
les Canadiens français.
En 1803, Constantin-François de Volney (1757-1820), un voyageur français venu au Canada,
écrivait:
|
Le langage des Canadiens de ces endroits n'est pas un patois comme
on me l'avait dit, mais un français passable, mêlé de beaucoup de
locutions de soldats. |
Le français des Canadiens était alors devenu un
français... «passable». Il s'agit là d'une des premières remarques dépréciatives
sur le parler des Canadiens. Et ce ne sera pas la seule!
En 1806, vint au Bas-Canada un voyageur anglais du nom de
John Lambert (v. 1775 - 1820). Il y demeura
en 1806 et en 1807, et visita Québec, Montréal, ainsi que les agglomérations
situées entre ces deux villes. Connaissant le français, Lambert s'est attaché à
décrire les us et coutumes de la population des villes et des campagnes qu'il
visitait. Après un séjour aux États-Unis, il revint à Québec en 1809 pour
repartir presque immédiatement pour Londres. L'année suivante, il fit paraître
en trois volumes ses célèbres Travels, dont le long titre témoigne du
caractère descriptif de l'œuvre: Travels through
Lower Canada, and the United States of
North America, in the years 1806, 1807,
and 1808, to which are added, biographical
notices and anecdotes of some of
the leading characters in the United
States ; and of those who have,
at various periods, borne a conspicuous
part in the politics of that
country. Son œuvre fut publiée en français en 2006 sous le titre de
Voyage au Canada dans les années 1806, 1807 et 1808, à Québec aux Éditions
du Septentrion. Voici quelques commentaires dignes d'être mentionnés (en
traduction française):
|
Les Français sont en
nette majorité à la Chambre d'Assemblée. Par conséquent, les
interventions se font le plus souvent en français. En effet, tous les
membres anglais comprennent et parlent cette langue, alors que très peu
de membres français ont la moindre connaissance de l'anglais. [...] Un curieux
jargon a cours sur le marché, entre les Français qui ne comprennent
pas l'anglais et les Anglais qui ne comprennent pas le français.
Chacun essaie de rencontrer l'autre à mi-chemin, dans sa propre
langue; de cette manière, ils réussissent à se comprendre
mutuellement au moyen de tournures boiteuses. Les échanges entre les
Français et les Anglais ont forcé les premiers à intégrer de
nombreux anglicismes dans leur langue, ce qui, pour un étranger
arrivant d'Angleterre et ne parlant que le français d'école, est au
début assez déconcertant.
Les Canadiens ont eu la
réputation de parler le français le plus pur; mais je mets en doute
qu'ils le méritent à l'heure actuelle. [...]
Avant la conquête du pays par
les Anglais, les habitants étaient réputés pour parler un français
aussi pur et aussi correct que dans l'ancienne France. Depuis lors,
ils ont adapté beaucoup d'anglicismes dans leur langue et ont aussi
plusieurs expressions désuètes, qui doivent probablement provenir de
leurs contacts avec les nouveaux colons. Pour
froid, ils prononcent frète. Pour ici, ils prononcent
icite. Pour prêt, ils prononcent parré — en plus
de plusieurs autres mots désuets dont je ne me souviens pas à présent.
Une autre pratique corrompue très commune parmi eux, c'est de prononcer
les lettres finales de leurs mots, ce qui est contraire à la tradition
du français européen. Cela doit peut être aussi avoir été acquis au
cours des communication durant cinquante ans avec les colonisateurs
britanniques; sinon, ils n'ont jamais mérité l'éloge de parler un
français pur. |
John Lambert était un voyageur et un aquarelliste, pas un spécialiste de la
langue; il ignorait que les traits qu'il remarquait chez les Canadiens (frète,
icitte, paré, lettres finales) n'étaient pas dus à l'influence des
colons britanniques, mais provenaient d'archaïsmes phonétiques et lexicaux en
usage dans la France des deux siècles précédents.
À partir du début du
XIXe
siècle, le ton semble être donné
quant à la perception qu'auront les voyageurs sur la langue des Canadiens. Entre 1810 et 1900, les historiens ont relevé 47 témoignages de
voyageurs ayant fait des commentaires sur la langue parlée par les Canadiens.
Ces appréciations seront toutes négatives! Ainsi, en une quarantaine d'années, les éloges sur la langue des
Canadiens ont fait place aux
critiques dépréciatives. Que s'est-il donc passé? Les Canadiens auraient-ils changé leur langue
aussi rapidement? En fait, leur langue n'a justement que fort peu changé, elle
est restée assez similaire à celle de l'Ancien Régime. Par contre, la langue des
Français, elle, a été modifiée considérablement, notamment avec la Révolution
(1789) et la montée des nouvelles classes sociales. À Paris, sous la
Restauration (entre 1814 et 1830), le style soutenu (ou discours public)
de la bourgeoisie avait définitivement supplanté le style familier (ou
bel usage) de la
cour et des salons, alors qu'au Canada seul le style familier avait survécu.
Au Canada, quelques hommes de lettres
se mirent à rédiger des glossaires sur les mots «vulgaires» ou «bizarres», les
«locutions vicieuses» et les anglicismes employés par les gens du peuple. À
titre d'exemple, le premier maire de Montréal, de 1833 à 1836, Jacques Viger
(1787-1858), un nationaliste engagé auprès du
célèbre homme politique que fut Louis-Joseph Papineau (1786-1871), entreprit en
1810 la rédaction d'une
œuvre qu'il ne publia jamais, mais dont le titre en est très significatif:
Néologie canadienne ou Dictionnaire des mots créés
en Canada et maintenant en vogue, des mots dont la prononciation et l'orthographe
sont différents de la prononciation et orthographe française,
quoique employés dans une acceptation semblable ou contraire, et
des mots étrangers qui se sont glissés dans notre langue.
9.2 Un français déjà anglicisé
Dans le journal L'Aurore du 17 juillet 1817,
un lecteur, qui signait «Un Québécois», s'indignait des corruptions
langagières et des anglicismes utilisés dans la langue parlée des
Canadiens:
|
Les anglicismes et surtout les
barbarismes sont déjà si fréquents qu'en vérité je crains fort que
bientôt nous ne parlions plus la langue française, mais un jargon semblable
à celui des îles Jersey et Guernesey.
|
|
 |
Voyageant en Amérique,
Alexis de Tocqueville (1805-1859),
penseur politique, homme politique, historien et écrivain français, vint passer quelques jours au
Bas-Canada en août 1831.
Ses
écrits comptent de nombreuses pages consacrées à la population, à la
destinée historique et à la situation politique et culturelle du
Bas-Canada dans l'Empire britannique.
Il fut particulièrement frappé par l'influence de la langue anglaise
dans la vie des Canadiens. Après avoir lu le seul journal francophone,
Le Canadien, Tocqueville écrivit: «En général, le style
de ce journal est commun, mêlé d'anglicismes et de tournures
étrangères.» Ayant assisté à une plaidoirie
dans un tribunal de Québec, il fit en 1831 cet étrange commentaire (Voyages
en Sicile et aux États-Unis):
|
|
[...] L'avocat de la défense se levait avec indignation et
plaidait sa cause en français, son adversaire lui répondait en anglais. On
s'échauffait de part et d'autre dans les deux langues sans se comprendre sans
doute parfaitement. L'Anglais s'efforçait de temps en temps d'exprimer ses
idées en français pour suivre de plus près son adversaire; ainsi faisant
parfois celui-ci. Le juge s'efforçait tantôt en anglais, tantôt en français,
de remettre de l'ordre. Et l'huissier criait: Silence! en donnant
alternativement à ce mot la prononciation anglaise et française. [...]
Les avocats que je vis là et qu'on dit les meilleurs
au Québec ne firent preuve de talent ni dans le fond des choses
ni dans la manière de dire. Ils manquent particulièrement
de distinction, parlent français avec l'accent normand des classes
moyennes. Leur style est vulgaire et mêlé d'étrangetés
et de locutions anglaises. Ils disent qu'un homme est chargé de dix
louis. — Entrez dans la boîte, dirent-ils au témoin pour lui indiquer de se
placer dans le banc où il doit déposer. L'ensemble du tableau a quelque chose de
bizarre, d'incohérent, de burlesque même. [...]
Le fond de l'impression qu'il faisait
naître était cependant triste. Je n'ai jamais été plus convaincu qu'en sortant
de là que le plus grand et plus irrémédiable malheur pour un peuple c'est d'être
conquis.
|
Il remarqua également que les Anglais et les Canadiens formaient deux
sociétés distinctes au Canada et il est frappé par l'omniprésence de
l'anglais dans l'affichage à Montréal:
|
Les villes, et en particulier
Montréal (nous n'avons pas encore vu Québec), ont une ressemblance frappante
avec nos villes de province. Le fond de population et l'immense majorité est
partout française. Mais il est facile de voir que les Français sont le
peuple vaincu. Les classes riches appartiennent pour la plupart à la race
anglaise. Bien que le français soit la langue presque universellement parlée,
la plupart des journaux, les affiches, et jusqu'aux enseignes des marchands
français sont en anglais. Les entreprises
commerciales sont presque toutes en leurs mains. C'est véritablement
la classe dirigeante au Canada. |
Pour ce qui est de la ville de Québec, Tocqueville écrivait encore: «Toute la
population ouvrière de Québec est française. On n'entend parler que du français
dans les rues. Cependant, toutes les enseignes sont anglaises.»
Alexis de Tocqueville remarqua aussi que les membres du clergé parlaient ce qui
lui paraissait comme un français très correct:
|
Tous les
ecclésiastiques que nous avons vus sont instruits, polis, bien élevés.
Ils parlent le français avec pureté. En général, ils sont plus
distingués que la plupart de nos curés de France. |
Tocqueville rapporte aussi ce témoignage d'un anglophone:
|
Ce qui maintient
surtout votre langue ici, c'est le clergé. Le clergé forme la seule
classe éclairée et intellectuelle qui
ait besoin de parler français et qui le parle avec pureté |
Malgré la sympathie qu'il affichait à l'endroit des Canadiens,
de Tocqueville croyait qu'ils étaient voués inéluctablement à
devenir minoritaires dans une Amérique du Nord massivement anglaise. «Ce sera une goutte d'eau dans l'océan»,
prédisait-il au sujet des Canadiens
français. Rappelons aussi que l'analphabétisme des Canadiens caractérise cette
période. Les projets de créations d'écoles publiques, généralement teintées de
visées assimilatrices, se heurtèrent à une vive opposition de la part du clergé catholique.
9.3 L'évolution du français de France
Il ne faut pas oublier que, si le français du Canada se
différenciait, c'est surtout parce que le français de France avait évolué
considérablement entre 1760 et 1810. Or, ces changements n'ont pas été connus au
Canada avant le milieu du XIXe
siècle. En voici quelques exemples:
- la prononciation ouè [wè] passa à oua [wa]:
pwère devint pware (poire); ainsi que pour les mots du même type (poisson,
boisson, voir, croire, etc.);
- la prononciation [è] passa à [wa]: dret devint drwat (droit),
ainsi que pour adret (adroit), etret (étroit), endret
(endroit), neyer (noyer), etc.):
- la prononciation en [eu] devint [ü]: hureux devint heureux,
ucharistie devint eucharistie, etc.
- la prononciation [é] passa à [è]: pére >
père, mére > mère, frére > frère, lumiére
> lumière, biére > bière, etc.
- la prononciation [ar] passa à [èr]: parte
> perte, sarviette > serviette, etc.
Ces changements dans la langue française ne furent pas les
seuls et ils ont creusé un écart considérable entre le français canadien et le
français européen. Par le fait même, les voyageurs étrangers percevront ces
différences comme «archaïques», «provinciales», «populaires», voire «paysannes».
Autrement dit, si le parler des Canadiens n'avait pas beaucoup changé depuis la
fin du Régime français, celui des
Français de la région parisienne avait été considérablement modifié, surtout
après la révolution de 1789 et encore plus sous la Restauration (1814-1830). Les
prononciations qui avaient cours sous l'Ancien Régime ne réussirent à se
maintenir que dans certaines provinces de France et certaines classes sociales
populaires de Paris, mais aussi dans la plupart des colonies antillaises
(Martinique et Guadeloupe) et celles de l'océan Indien (La Réunion, Maurice et
Seychelles).
De plus, le vocabulaire français avait subi en France de
grands bouleversements en raison des nouvelles réalités politiques et sociales.
Tout le vocabulaire politique administratif s'est modifié avec la disparition des
mots relatifs à l'Ancien Régime et la création de mots nouveaux ou employés avec
un genre nouveau. Mais le français européen ne fut pas envahi par des mots «populaires».
Après tout, c'est la bourgeoisie qui dirigeait les assemblées délibérantes, qui
orientait les débats, qui alimentait les idées révolutionnaires et qui
contrôlait le pouvoir dont le peuple était écarté. Ces divers changements n'ont été
connus au Canada que tardivement.

À partir de 1763, la Nouvelle-France n'est plus française, mais en 1783 la
Nouvelle-Angleterre ne sera plus anglaise. L'Europe parlait français, mais l'anglais allait devenir la langue dominante de l'Amérique du Nord. Près d'une décennie avant
lord Durham
(1839-1840), le Français Alexis de Tocqueville (1805-1859) et beaucoup d'autres étaient convaincus de la disparition prochaine des
Canadiens français.
Au cours de la période s'étendant de 1763 jusqu'en 1840, l'administration de la
colonie n'a pas été exempte d'erreurs. En effet, les
autorités britanniques de la Métropole, pourtant fières de leur
démocratie parlementaire, ont conçu une Chambre d'assemblée
au Canada où seuls les protestants pouvaient voter. Elles ont accordé au gouverneur et
à l'Exécutif une liste civile qui les mettait à l'abri de la volonté
populaire. En minimisant le principe «pas de taxe sans
représentation» ("no taxation without representation"),
les dirigerants britanniques ont fait en sorte d'accaparer presque tous les postes au Conseil
législatif en étant bien conscients qu'une telle opération allait paralyser la vie politique de la
colonie et faisait d'eux les protagonistes du système machiavélique qui
consistait à «diviser pour régner». Lors de la révolte des Patriotes, les
Britanniques ont institué une cour martiale, plutôt
qu'un cour civile, pour juger les individus accusés de «trahison»; ils leur
ont refusé des avocats francophones sous le prétexte que des rebelles ne
pouvaient défendre des rebelles. Jamais les Britanniques n'auraient bafoué de la
sorte leur propre système démocratique en Grande-Bretagne. Une telle
attitude de la part des autorités britanniques témoignait de la volonté
d'assimiler la population.
Néanmoins, contre toute attente, les
Canadiens du Bas-Canada survécurent. Ce fut l'histoire du siècle et
demi suivant.
Dernière mise à jour:
24 octobre, 2024
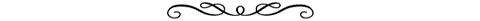
|
|
|
|
(2)
Le
régime britannique (1760-1840)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
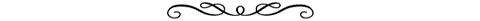
![[Union Flag of 1801]](images/G-B_drap.gif)