Histoire du français au Québec
Section 3
 |
(3)
L'Union de
1840
|
Histoire du français au Québec
Section 3
 |
(3)
L'Union de
1840
|
|
1
Le Québec sous l'Union
(1840-1867) |
4.3 L'arrivée des francophones dans les Cantons-de-l'Est 4.4 Les retrouvailles France/Bas-Canada) 4.5 Bilan de la colonisation britannique
5
Le Québec dans la
Confédération (1867-1960)
6
Le rôle
de l'Église catholique dans le destin linguistique
|
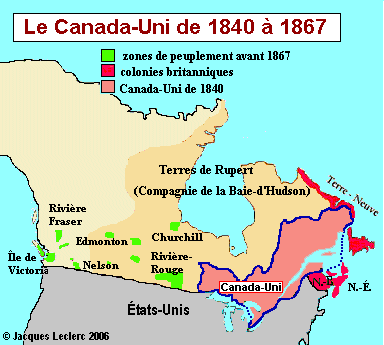 |
Dans son célèbre rapport de 1839, lord
Durham avait recommandé de réunir les deux colonies du
Haut-Canada
(Ontario) et du Bas-Canada (Québec). Évidemment, ce projet de fusion ne
suscita aucune sympathie de la part des Canadiens français, qui craignaient une
colonie centralisée et dirigée majoritairement par les Anglais. Le
gouvernement britannique trancha en faveur de la réunion des deux colonies et
promulgua en 1840 la Loi de l'Union, appelée généralement «Acte d'Union» (traduction
de Union Act), qui regroupa les deux colonies en une seule assemblée
de 84 membres (42 pour chacun des deux Canadas). Ainsi, les deux Canadas
(le Bas-Canada et le Haut-Canada) devinrent le
Canada-Uni ou «province
du Canada» par la Loi de l'Union
(voir la carte du Canada-Uni),
lesquels seront désormais appelés officiellement le Canada-Ouest (Haut-Canada) et le
Canada-Est (Bas-Canada).
Malgré la dénomination officielle de Canada-West (Canada-Ouest) et de Canada-East (Canada-Est), les Canadiens du Canada-Uni continueront d'appeler leur colonie respectivement Upper Canada (Haut-Canada) et Bas-Canada (Lower Canada) jusqu'à la création de la Confédération en 1867. |
Dans ce nouveau Canada-Uni (aujourd'hui le Québec et l'Ontario), les francophones durent apprendre à vivre leur situation de minoritaires, laquelle s'accentuera avec la Confédération de 1867 (Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick) et l'entrée graduelle de six autres provinces. Les Canadiens français resteront parqués dans l'agriculture jusqu'à la révolution industrielle, alors qu'ils se transformeront généralement en prolétaires au service des Britanniques. Exclus du grand commerce, de l'exploitation primaire (bois, mines, etc.), des sources de capitaux et de la direction des affaires, les Canadiens français accepteront la subordination socio-économique tout en défendant leurs lois, leur langue et leur religion. Plus d'un siècle de défense, de survivance et de conservatisme!
Les
gouverneurs de cette époque furent les suivants:
| Gouverneurs de 1841 à 1867 | Début du mandat | Fin du mandat |
| Charles Edward Poulett Thomson | 5 février 1841 | 19 septembre 1841 |
| Richard Downes Jackson (intérimaire) | 19 septembre 1841 | 12 janvier 1842 |
| Charles Bagot | 12 janvier 1942 | 19 mai 1943 |
| Charles Theophilus Metcalfe | 30 mai 1843 | 26 novembre 1845 |
| Charles Murray Cathcart | 26 novembre 1845 | 30 janvier 1847 |
| James Bruce (8e comte d'Elgin) | 30 janvier 1847 | 19 décembre 1854 |
| Edmund Walker Head | 19 décembre 1854 | 25 octobre 1861 |
| Charles Stanley Monck | 25 octobre 1861 | 30 juin 1867 |
Par la Loi de l'Union (Union Act), le gouvernement britannique avait donc mis en œuvre l'une des recommandations de lord Durham, soit l'union législative du Haut-Canada (Ontario) et du Bas-Canada (Québec).
1.1 La structure politique du Canada-Uni
La nouvelle loi constitutionnelle créait une seule colonie sous l'administration d'un gouverneur général représentant de la Couronne britannique et chef du gouvernement du Canada-Uni, qui détenait l'autorité suprême dans la colonie. C'est aussi le gouverneur général qui faisait appliquer les lois, qui approuvait ou rejetait les projets de lois par son droit de véto; le Parlement britannique pouvait même refuser de sanctionner une loi votée dans sa colonie dans les deux ans suivant son adoption.
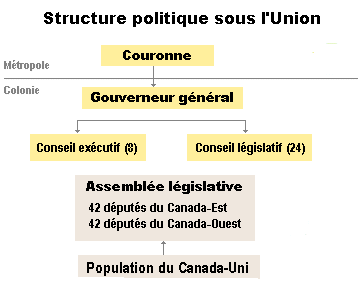 |
Les huit membres du
Conseil exécutif étaient choisis par le
gouverneur et nommés par Londres. Ses membres jouaient le rôle de ministre
et aidaient le gouverneur à faire appliquer les lois et à administrer la
colonie. Les 24 membres du Conseil législatif
étaient choisis parmi les hauts fonctionnaires et les nobles canadiens par
le gouverneur, puis nommés à vie par Londres; ces membres étaient généralement
soumis au gouverneur qui les avait désignés.
La Chambre d'assemblée de l'Union comprenait un nombre égal de représentants du Canada-Ouest (Haut-Canada) et du Canada-Est (Bas-Canada), soit 42 pour un total de 84. Les députés de la Chambre d'assemblée devaient préparer, débattre et voter leurs projets de lois et ceux du Conseil législatif. Ce sont aussi eux qui votaient les taxes nécessaires à l'administration de la colonie et qui en contrôlaient les revenus. En plus de choisir les membres des deux conseils, c'est le gouverneur général qui convoquait la Chambre d'assemblée et qui pouvait la dissoudre à sa guise. |
1.2 La minorisation politique des Canadiens français
Le gouvernement britannique désirait procéder à une fusion la plus complète possible en créant le Canada-Uni. La frontière naturelle, la rivière des Outaouais, ne séparait plus les deux entités réunies dans une seule union politique sous l'administration d'un seul gouverneur général. Les Canadiens français du Bas-Canada y perdaient beaucoup, une façon de leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas intérêt à s'opposer à l'Empire britannique, surtout après la révolte des Patriotes.
- Les pertesLe premier inconvénient était évident: les francophones passaient d'une majorité de 76 % à celle de 58 %, ce qui signifiait qu'elle allait se réduire davantage, car la seule immigration autorisée était décidée par la Grande-Bretagne.
Second inconvénient : avec une population de 650 000 habitants, le Canada-Est (Bas-Canada) comptait 42 députés à l'Assemblée législative, soit le même nombre que pour le Canada-Ouest (Haut-Canada) avec 400 000 habitants; il s'agissait de forcer une égalité parlementaire artificielle en attendant que le jeu de l'immigration vienne combler l'écart démographique. Dans les faits, cette entrave à la démocratie mettait la majorité francophone du Canada-Est (Bas-Canada) à la merci de la minorité du Canada-Ouest (Haut-Canada), qui pouvait faire front commun avec la minorité anglophone du Canada-Est, et perpétuer ainsi les rivalités ethniques de la colonie.
Troisième inconvénient: la ville de Québec perdait son titre de capitale nationale. Dorénavant, la capitale était mobile: Kingston de 1841 à 1844, Montréal de 1844 à 1849, Toronto de 1849 à 1853, Québec de 1853 à 1857. À tous les quatre ans, on y déménageait les hauts fonctionnaires et les députés, leurs familles, les archives et la bibliothèque.
Autre perte: toutes les dettes du Haut-Canada et du Bas-Canada étaient réunies. Or, le Bas-Canada avait une dette de 375 000 $, alors que le Haut-Canada avait dû contracter d'énormes emprunts (soit cinq millions de dollars, avec des intérêts annuels de 224 000 $) pour creuser des canaux et construire des routes.
Dernière perte : l'article 41 de la Loi de l'Union décréta que la langue anglaise était la seule langue officielle de la colonie:
|
Article 41
Et qu'il soit statué, que depuis et après la Réunion desdites deux Provinces, tous Brefs, Proclamations, Instruments pour mander et convoquer le Conseil Législatif et l'Assemblée législative de la Province du Canada, et pour les proroger et les dissoudre, et tous les Brefs pour les élections et tous Brefs et Instruments publics quelconques ayant rapport au Conseil législatif et à l'Assemblée législative ou à aucun de ces corps, et tous Rapports à tels Brefs et Instruments, et tous journaux, entrées et procédés écrits ou imprimés, de toute nature, du Conseil législatif et de l'Assemblée législative, et d'aucun de ces corps respectivement, et tous procédés écrits ou imprimés et Rapports de Comités dudit Conseil législatif et de ladite Assemblée législative, respectivement, ne seront que dans la langue Anglaise : Pourvu toujours, que la présente disposition ne s'entendra pas pour empêcher que des copies traduites d'aucuns tels documents ne soient faites, mais aucune telle copie ne sera gardée parmi les Records [comprendre «archives» ou «registres»] du Conseil législatif ou de l'Assemblée législative, ni ne sera censée avoir en aucun cas l'authenticité d'un Record original. |
C'était la première fois que, depuis la Conquête, l'Angleterre proscrivait l'usage du français dans un texte constitutionnel, ce qui démontrait éloquemment la nouvelle volonté assimilatrice du gouvernement britannique. Le français ne devenait qu'une langue traduite, sans valeur juridique. Cependant, l'usage du français dans les débats parlementaires n'était pas formellement interdit. On peut consulter le texte complet de la Loi de l'Union (ou Acte d'Union) de 1840 en cliquant ICI.
1.3 Les réactions positives à l'Union
La mise en place de la nouvelle Constitution de 1840 réjouissait la classe commerciale anglophone, dont l'avenir semblait reposer sur le développement de l'axe laurentien.
Il en était ainsi pour l'Église catholique qui avait perdu son statut juridique en 1791. Parce que son loyalisme ne s'était jamais démenti et qu'elle avait fait preuve de fidélité à l'occasion des rébellions de 18137 et de 1838, l'Église regagnait un statut légal dans la nouvelle Constitution. Elle retrouvait un droit de personne morale apte à posséder des biens sans risque de confiscation. L'Église pouvait aussi investir en toute assurance dans le foncier et l'immobilier. Dorénavant, l'Église catholique du Canada allait changer d'allégeance: elle abandonnait l'influence française — le gallicanisme — pour l'ultramontanisme et le cérémonial romain. Grâce à la nouvelle Constitution de 1840, l'Église pouvait réaliser son projet de s'emparer de l'instruction publique et de prendre aussi la responsabilité en matière de santé.
À la même époque, l'unification italienne était devenue un événement international qui touchait profondément l'Église catholique dans la colonie britannique du Canada. La question des États pontificaux et du pouvoir temporel (ou politique) du pape avait mis le feu aux poudres. L'évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, devint le chef de file de l'Église catholique dont le but était de favoriser l'inviolabilité et l'intégrité des États pontificaux en Italie. Profitant de la ferveur papiste, l'évêque de Montréal fit recruter plus de 500 zouaves canadiens-français, répartis en sept détachements, afin d'aller se porter au secours du pape à partir de 1868.
1.4 Les aspects négatifs et les compromis
L'Union des deux Canadas suscita, en revanche, la colère de la population canadienne-française, car plusieurs dispositions de la Loi de l'Union leur parurent vexatoires. Comme on pouvait s'y attendre, la Loi de l'Union et ses dispositions sur l'unilinguisme anglais soulevèrent un tollé de protestations au Canada-Est que l'on continuait d'appeler le «Bas-Canada».
Lors de la première séance du Parlement du Canada-Uni en 1841, à la suite d'un compromis entre les réformistes de l'ancien Haut-Canada (menés par Francis Hincks) et ceux de l'ancien Bas-Canada (menés par Louis-Hippolyte La Fontaine), le député Augustin Cuvillier, qui parlait couramment le français et l'anglais, fut élu à l'unanimité comme président (appelé alors «Orateur») de l'Assemblée. À titre de président, Cuvillier noua des relations très cordiales avec les gouverneurs qui se succédèrent dans la province. Si Louis-Hyppolyte La Fontaine (1807-1864) finit par accepter de mauvaise grâce les dispositions de la Loi de l'Union, il ne put souscrire à l'interdiction de la langue française. Dès le début, Louis-Hippolyte La Fontaine, avocat et coprésident du Conseil exécutif, tenta de convaincre le Parlement d'accepter l'usage du français. Après avoir demandé la formation de la Chambre en comité général, il s'adressa en 1842 aux députés du Canada-Uni en ces termes:
Je dois d'abord faire allusion à l'interruption de l'honorable député de Toronto, qu'on nous a si souvent présenté comme un ami de la population canadienne-française. A-t-il déjà oublié que j'appartiens à cette origine si horriblement maltraitée par l'Acte d'Union? Si c'était le cas, je le regretterais beaucoup. Il me demande de prononcer dans une autre langue que ma langue maternelle le premier discours que j'ai à prononcer dans cette Chambre. Je me méfie de mes forces à parler la langue anglaise, mais je dois informer les honorables députés que, quand même la connaissance de la langue anglaise me serait aussi familière que celle de la langue française, je n'en ferais pas moins mon premier discours dans la langue de mes compatriotes canadiens-français, ne serait-ce que pour protester solennellement contre cette cruelle injustice de l'Acte d'Union qui proscrit la langue maternelle d'une moitié de la population du Canada. Je le dois à mes compatriotes, je le dois à moi-même. Le but de l'Union, dans la pensée de son auteur, a été d'écraser la population française : mais l'on s'est trompé, car les moyens employés n'obtiendront pas ce résultat. Sans notre active coopération, sans notre participation au pouvoir, le gouvernement ne peut fonctionner de manière à rétablir la paix et la confiance, essentielles au succès de toute administration. Placés par l'Acte d'Union dans une situation exceptionnelle, en minorité dans la distribution du pouvoir politique, si nous devons succomber, nous succomberons au moins en nous faisant respecter [...].
Augustin Cuvillier perdit son siège de Huntingdon en 1844 et, malgré l'opposition des réformistes canadiens-français à la nomination du controversé député Allan Napier MacNab en novembre 1844, comme président de la Chambre, en raison de sa méconnaissance du français, celui-ci finit par être élu et succéda à Cuvillier. Il conserva son poste jusqu'en 1848, alors qu'il fut remplacé par Augustin-Norbert Morin. MacNab réalisa que les Canadiens français formaient le groupe pivot à l'intérieur de l'Union et qu'ils refusaient d'être assimilés, comme l'espéraient lord Durham.
La réunion du Bas-Canada et du Haut-Canada ne s'est pas faite facilement. Dans la pratique, il devint impossible de réaliser une telle fusion administrative, alors que le Canada-Est (Bas-Canada) fonctionnait avec des lois issues de la Coutume de Paris et le Canada-Ouest (Haut-Canada) avec la Common Law. Il fallut se résoudre à adopter une double structure ministérielle. De 1842 à 1867, les structures administratives et les ministères furent doublés de sorte que les francophones de l'Est reçurent des services en français; les anglophones de l'Ouest, en anglais.
Le Canada-Est (Bas-Canada) et le Canada-Ouest (Haut-Canada) possédaient chacun son surintendant de l'Instruction publique et son ministre des Travaux publics. Chacun avait aussi son premier ministre. De plus, la capitale du Canada-Uni se déplaçait alternativement du Canada-Est au Canada-Ouest. Malgré la Loi de l'Union (Union Act) adoptée par Londres, le Parlement du Canada-Uni chercha à atténuer la portée de l'article 41 sur l'unilinguisme anglais en adoptant diverses mesures facilitant la traduction des lois et autres documents parlementaires. Bon gré mal gré, le français fut toléré comme langue d'usage au Parlement, ce qui équivalait à une reconnaissance officieuse. D'ailleurs, il paraissait inutile d'interdire une langue qui était utilisée entre les nations et qui avait été adoptée par l'élite de Grande-Bretagne, y compris par la famille royale.
1.5 Le fonctionnement d'une fédération
Bref, dans les faits, le
Canada-Uni qui devait s'avérer fatal pour les francophones fonctionna comme
une fédération. Même s'il n'existait qu'un
seul parlement, la fonction de premier ministre de la colonie était partagée entre
les deux anciennes provinces du Bas-Canada et du
Haut-Canada.
Officiellement, une seule personne portait le titre de premier
ministre, alors que qu'un autre était son représentant. Le Bas-Canada continua d'utiliser le français comme si
l'anglais n'était pas la seule langue officielle. Le Haut-Canada n'utilisait
que l'anglais, mais devait composer avec le français employé par les députés
francophones au Parlement du Canada-Uni.
 |
Dès 1841, une coalition politique se forma entre les réformistes canadiens-français, dirigés par Louis-Hippolyte La Fontaine, et les réformistes canadiens-anglais, sous la direction de Robert Baldwin. Chacune des parties dut accepter des compromis. Pendant que les Canadiens français acceptaient le régime de l'Union qui les plaçaient en minorité, les Canadiens anglais renonçaient à assimiler les francophones en leur reconnaissant une autonomie culturelle et des pouvoirs économiques. Ayant comme but commun l'obtention d'un gouvernement responsable, ils exercèrent leur système de double majorité afin d'y parvenir. |
La tentative d'assimilation du gouvernement britannique ne put atteindre son objectif, car dans le désir d'autonomie politique de la part des deux parties du Canada-Uni rassemblèrent pratiquement tous les députés, autant les anglophones que les francophones. C'est ainsi que l'alliance des partis réformistes du Canada-Est (Bas-Canada) et du Canada-Ouest (Haut-Canada) les portera au pouvoir dès 1842. Ce gouvernement de coalition exerça de fortes pressions auprès du gouverneur de sorte que celui-ci puisse accepter l'idée d'un gouvernement canadien responsable qui ferait sortir le Canada de son mode de fonctionnement désuet.
En 1841, le gouvernement impérial avait indemnisé les citoyens du Haut-Canada pour les pertes subies lors des soulèvements de 1837-1838. Louis-Hippolyte La Fontaine avait simplement désiré que les citoyens du Bas-Canada puissent bénéficier des mêmes avantages et avait demandé un budget à cette effet. La réaction des anglophones fut déchaînée, alors que la Monteal Gazette faisait appel à l'émeute.
|
|
Il y eut des manifestations, des discours virulents et
des actes de vandalisme. Finalement, les émeutiers mirent le feu à l'aide de
torches à l'édifice du Parlement
—
présenté comme le French Parliament —,
le soir du 25 avril 1849 à Montréal, capitale de la colonie britannique du
Canada-Uni depuis 1844. L'incendie consuma les deux bibliothèques
parlementaires, et une partie des archives et documents publics du
Haut-Canada et du Canada-Uni. Plus de 23 000 volumes appartenant aux
collections des deux bibliothèques partirent en fumée et à peine 200 livres
purent être sauvés des flammes.
Les émeutiers se promenèrent dans les rues avec des têtes de cochons au bout de leurs baïonnettes et une mitre d'évêque dessus en scandant «cochons de catholiques». |
Le lendemain de l'incendie, la foule se rassembla devant la maison de Louis-Hippolyte La Fontaine et y mit le feu; ce dernier ne sauva sa vie que grâce à l'intervention de l'armée. Deux jours plus tard, des «amis de la paix» agressèrent le gouverneur général, lord Elgin (nommé en 1847), qui jugea plus prudent de quitter temporairement la ville. Après plusieurs débats au sein du Parlement-Uni, la décision fut prise de déménager la capitale de Montréal à Toronto; le siège du gouvernement déménagera à Ottawa en 1866.
Lord Elgin s'est toujours montré favorable à un «gouvernement responsable»; il travailla en ce sens avec l'alliance réformiste de Lafontaine et de Baldwin. En 1846, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau fit une nouvelle tentative en faisant valoir que «l'exclusion de la langue d'un peuple est une grave atteinte à son existence morale; puisque la langue est l'expression des mœurs». Un fois au pouvoir en 1848, les députés réformistes, notamment Baldwin et de La Fontaine, firent pression sur Londres afin que le français obtienne un statut officiel.
À la fin de la décennie 1840, les démarches portèrent fruit et le gouvernement britannique demanda au gouverneur général de respecter les volontés de l'Assemblée et de donner les pleins pouvoirs au chef du parti majoritaire. Finalement, le 14 août 1848, par la Loi sur l'usage de la langue anglaise à la Législature du Canada, le gouvernement britannique abrogeait l'article 41; ce fut le retour au bilinguisme de fait qui avait cours avant la Loi de l'Union. À compter de 1849, le texte officiel de toutes les lois fut adopté à la fois en anglais (version originale) et en français (en traduction); dans les débats parlementaires toutefois, les députés qui s'exprimaient en français étaient «condamnés» à n'être compris que de leurs collègues francophones, la traduction simultanée n'existant pas encore.
Le 18 janvier 1849, le gouverneur, lord Elgin, inaugura la pratique qui consiste à lire le «discours du Trône» dans les deux langues. Puis, en même temps, la responsabilité ministérielle fut officiellement reconnue. En janvier 1849, le député Louis-Joseph Papineau prononçait un discours concernant le retour du français à l'Assemblée législative lors de la deuxième session du troisième Parlement du Canada-Uni :
Le gouverneur a prononcé son discours en anglais et en français. Le rétablissement de la langue française dans le parlement canadien était un acte de stricte justice, que nous devait l'autorité constituée. Son excellence remplissait donc son devoir en agissant comme il l'a fait. Il l'a fait avec toute l'attention et la courtoisie qu'on devait en justice au peuple de cette province, et on doit lui en savoir gré.
Ce compromis historique témoignait que, dans certaines circonstances, les francophones et les anglophones pouvaient travailler ensemble pour résoudre leurs problèmes politiques. Au cours de la session de 1849, le Parlement adopta 190 projets de lois, donc celui portant sur l'indemnité, qui souleva les passions populaires.
Une autre mesure, acceptée par entente tacite, consistait à adopter des lois ne concernant qu'une des provinces seulement avec l'appui de la majorité des membres de cette province. Toutefois, même si les députés canadiens-français furent convaincus que les affaires du Canada-Uni devaient se régler en respectant la double majorité, ce principe ne fut pas régulièrement appliqué. Au cours des années 1850, le gouvernement bicéphale devint vite intolérable pour les anglophones.
1.6 La nécessité d'un changement constitutionnel
À partir de 1852, les Britanniques commencèrent à se sentir frustrés à leur tour de se voir obligés de faire élire un nombre égal de députés anglophones et francophones: le Canada-Ouest (Ontario) dépassait de plus de 60 000 habitants la population du Canada-Est (Québec). Avec l'immigration anglaise, qui accentuait l'écart démographique entre le Canada-Est et le Canada-Ouest, la situation politique ne pouvait dorénavant que se détériorer.
Pris à leur propre piège, les anglophones exigèrent un changement constitutionnel qui leur assurerait la représentation proportionnelle au Parlement. Étant donné l'instabilité continuelle qui s'était installé au Parlement, les Britanniques commencèrent à songer à constituer une fédération. Le recensement de 1851 révéla que la population du Canada-Ouest (Haut-Canada) était devenue plus nombreuses que celle du Canada-Est (Bas-Canada). Dès lors, les représentants réformistes du Canada-Ouest se rallièrent rapidement à la logique de la représentation proportionnelle; leur alliance avec les Canadiens du Canada-Est fondit comme neige au soleil. La volonté des anglophones de réformer le Canada et la résistance des francophones menèrent à l'impasse; le Canada-Uni devenait à nouveau ingouvernable. Le journaliste et politicien réformiste George Brown (1818-1880), ardent opposant à la French Domination, dénonçait ainsi le dualisme du Canada-Uni en 1864:
We have two races, two languages, two systems of religious belief, two sets of laws, two systems of everything, so that it has been almost impossible that, with out sacrificing their principles, the public men of both sections could come together in the same Government. The difficulties have gone on increasing every year. [Nous avons deux races, deux langues, deux systèmes de croyances religieuses, deux systèmes partout ailleurs, si bien qu'il est devenu presque impossible aux parlementaires des deux camps de faire partie d'un même gouvernement sans sacrifier leurs principes. Les difficultés ne font que s'aggraver chaque année.]
George Brown entreprit d'élaborer un plan d'union législative des colonies de l'Amérique du Nord britannique, de sorte qu'un éventuel changement constitutionnel assurerait aux anglophones la représentation proportionnelle au Parlement. Les anglophones songèrent sérieusement à mettre fin à la prétendue French Domination. du Canada-Uni.
Toutefois, les anglophones avaient besoin du Canada-Est (Bas-Canada), car ils tenaient beaucoup aux canaux, aux chemins de fer et au port de Montréal. L'idéal pour eux, c'était deux provinces séparées au plan des institutions culturelles et politiques, mais reliées par un marché commun économique. Puis la menace d'une invasion militaire américaine incita les anglophones à mettre en place un gouvernement le plus fort possible. Tout le monde politique reconnaissait que le régime du Canada-Uni ne pouvait tenir encore bien longtemps.
1.7 La mauvaise qualité du français à la Chambre d'Assemblée
En vertu de l'article 41 de la Loi de l'Union, la langue anglaise était la seule langue officielle de la colonie. Néanmoins, des traductions non officielles étaient autorisées dans les documents parlementaires, voire dans les débats (sans traduction). Un Canadien français qui se risquait à employer le français était assuré de ne pas être compris. En 1848, le français fut enfin reconnu comme langue officielle à côté de l'anglais. Toutefois, le français demeurait encore une langue essentiellement traduite. Dans les règlements et le Journal officiel de la Chambre d'Assemblée du Canada-Uni, les traductions en français laissaient grandement à désirer.
C'est ainsi que l'Assemblée législative était une traduction de l'anglais
("Legislative Assembly"), que le président de l'Assemblée était «l'Orateur» (<
anglais : "speaker"), que le secrétaire portait le titre de «greffier» (<
anglais: "clerk"), que les projets de loi s'appelaient des «bills» (< anglais:
"bill"), qu'une proposition était désignée par le mot «motion» (< anglais:
"motion"), qu'elle devait être «secondée» et non «appuyée», que le Journal
officiel s'appelait plutôt la Gazette Officielle (< anglais: "Official
Gazette"), que les décrets
étaient appelés «ordres» (< anglais: "Order"), etc. À cela s'ajoutaient
les tournures syntaxiques traduites de l'anglais (voir
les documents). Il faudra plus d'une centaines d'années avant que le
Canada finisse par rédiger des textes en français qui n'étaient pas traduits au
préalable.
2 Les conséquences
de l'Union en éducation
Dans son fameux rapport, lord Durham avait constaté que le système scolaire du Bas-Canada (Canada-Est) était fort mal en point. Il avait confié à son premier secrétaire, Charles Buller (1806-1848), l'analyse de la question scolaire et les solutions souhaitables destinées à améliorer l'ensemble de l'éducation. Buller proposa alors un régime scolaire complet, du primaire à l'université, sans distinction de langue ni de religion, où les jeunes, tant francophones qu'anglophones, fréquenteraient les mêmes établissements sous la supervision de «municipalités scolaires» et d'un «surintendant de l'Instruction publique» désigné par le gouvernement. Cependant, les pouvoirs du surintendant de l'Instruction publique ne s'étendaient qu'aux institutions publiques, et non pas aux écoles privées ni à celles relevant des communautés religieuses.
2.1 Une législation impopulaire
Dès l'entrée en vigueur de l'Union (1840), les députés de la nouvelle «province du Canada» ("Province of Canada") durent se préoccuper de l'éducation. En septembre 1841, le Parlement du Canada-Uni adopta la Loi établissant des écoles publiques pour toute la province. La nouvelle loi plaçait les écoles primaires sous le contrôle de conseillers de districts municipaux nommés par le gouvernement et de commissaires élus. Ces écoles devaient être financées par de nouvelles taxes locales ainsi que par des subventions publiques. La loi prévoyait aussi la nomination d'un surintendant de l'Instruction publique, auquel devait se joindre un adjoint pour les deux sections de la colonie du Canada-Uni, soit le Canada-Est et le Canada-Ouest. Ces écoles étaient non confessionnelles. Évidemment, les évêques catholiques intervinrent aussitôt dans le débat. Du fait que la loi sanctionnée le 18 septembre 1841 reconnaissait le principe de la confessionnalité des écoles, les Églises catholique et protestante (anglicane) obtinrent le droit à l'instruction pour les minorités religieuses — mais non pas linguistiques — ainsi qu'une structure distincte pour les inspecteurs tant catholiques que protestants.
Cette loi de 1841 devint vite très impopulaire en raison des nouveaux impôts fonciers qu'elle prévoyait. Des propriétaires fonciers, furieux de la taxation scolaire, organisèrent des assemblées dans le but de combattre cette loi qu'ils jugeaient contraire aux libertés individuelles tout en soutirant des sommes d'argent au peuple. Le clergé, les politiciens et la presse écrite se mirent de la partie contre ce mouvement néfaste pour l'éducation dans la colonie.
2.2 L'organisation paroissiale
Il fallut plusieurs années avant que la population finisse par accepter des modifications à la loi en 1845 et 1846. En effet, en 1845, une nouvelle loi sur l'éducation (Loi pour l'instruction élémentaire dans le Bas-Canada), parrainée par Denis-Benjamin Papineau, abrogea les dispositions insatisfaisantes de la loi de 1841 et créa un régime scolaire basé sur les paroisses. On mit en place un système que les Canadiens français ont conçu eux-mêmes, qui reposait sur leurs principes religieux et leur conception de l'ordre social, et qui était adapté à leurs besoins, l'organisation paroissiale.
Le gouvernement colonial créa alors les «commissions scolaires» (ou conseils scolaires), des organismes indépendants du conseil municipal et relevant du surintendant de l'Instruction publique. Cette loi remplaçait l'impôt scolaire obligatoire par des cotisations bénévoles, afin de ne plus heurter certains citoyens qui s'étaient insurgés contre le prélèvement foncier.
2.3 La guerre des éteignoirs
En 1846, une nouvelle loi répondait aux vœux du clergé, insatisfait de la loi de 1845, d'accroître son contrôle sur le système scolaire: la Loi pour abroger certaines dispositions y mentionnées, et pour pourvoir d'une manière plus efficace à l'instruction élémentaire dans le Bas-Canada. Cette loi prévoyait la création de commissions scolaires distinctes basées sur la confession religieuse et précisait que le curé ou le ministre avait un droit de veto sur le recrutement de maîtres et sur la sélection des manuels. De plus, la loi de 1946 rétablissait le principe des cotisations obligatoires à prélever. Cette dernière disposition eut des conséquences dramatiques, car les nouvelles taxes provoqueront, parmi la population francophone, les soulèvements connus sous le nom de «guerre des éteignoirs».
Le mot «éteignoir» tire son origine du fait que certains milieux ruraux, qui s'opposaient à la législation scolaire, furent considérés comme des «éteignoirs» qui étouffaient la «flamme du savoir». En fait, c'est contre la nouvelle taxe qu'on s'opposait, non contre l'instruction elle-même; de plus, les paysans avaient besoin de leurs enfants pour les aider dans les travaux de la ferme. Ce sont les seigneurs, dont beaucoup d'anglophones, c'est-à-dire les propriétaires terriens, qui protestaient le plus contre la législation scolaire. Puisque ces taxes étaient fondées sur la propriété foncière, les seigneurs devaient payer des sommes plus élevés que la population rurale. Finalement, des émeutes éclatèrent, car les protestations s'élevèrent contre les commissaires et contre leurs représentants.
2.4 La législation de 1849
Une nouvelle loi, présentée par Louis-Hippolyte La Fontaine, fut adoptée en 1849, la Loi pour amender la loi des écoles du Bas-Canada (sic). Elle permettait de nouveau les contributions volontaires et restreignait l'obligation des frais de scolarité, sauf pour les enfants de 7 à 13 ans. Cette loi avait comme but premier de mettre fin à la «guerre des éteignoirs», mais elle eut pour effet d'amplifier l'opposition à la législation. La violence persista quelque temps jusqu'à ce que le gouvernement puisse envoyer des militaires afin que la situation s'apaise progressivement.
De son côté, l'Église catholique obtint un droit de regard dans le choix des manuels scolaires traitant de sujets religieux et moraux; de plus les curés devinrent admissibles au poste de «commissaire scolaire», ce qui revenait à reconnaître dans les faits la primauté spirituelle des Églises en matière d'éducation, notamment dans la transmission des valeurs. Par la suite, Louis-Hippolyte La Fontaine devint en Chambre (Assemblée législative du Canada-Uni) le grand défenseur de l'école catholique, des biens de l'église et de la langue française.
Entre 1850 et 1860, la croissance de la population scolaire devint proportionnellement plus forte que celle de la population du Bas-Canada. Alors que dans la décennie de 1850 le taux d'alphabétisation oscillait entre 20 % et 30 %, il franchit le cap des 50 % après 1860, sauf pour les cultivateurs (47,8 %). Le taux d'alphabétisation était en général plus élevé dans les villes que dans les campagnes, davantage aussi dans la vallée du Saint-Laurent que dans les villages de colonisation. Dans certaines villes, la fréquentation de l'école, la lecture des journaux, la pratique du vote, etc., favorisaient l'alphabétisation.
Le Bas-Canada (Canada-Est) vit apparaître de nombreux collèges à l'initiative des communautés religieuses: collège de Joliette (1846), collège de Rigaud (1850), collège de Saint-Laurent (1847), collège Sainte-Marie (1848), collèges de Lé.vis (1853), collège de Trois-Rivières (1860), etc. À la même époque, le besoin d'un enseignement de niveau universitaire devenait incontournable. Au Bas-Canada (Canada-Est), la population anglophone disposait déjà de cinq établissements d'enseignement supérieur, mais il n'en existait aucun pour les Canadiens français. Pour pallier ce manque, la reine Victoria signait, en 1852, la Charte royale qui donnait au Séminaire de Québec le droit de «conférer des degrés» et «tous les droits, pouvoirs et privilèges d'université». L'Université Laval, entièrement de langue française, fut alors créée.
À la suite de la Loi de l'Union, le Haut-Canada (Canada-Ouest) connut un essor économique important. La production agricole s'améliora de même que l'industrie du bois, ce qui entraîna le développement des moyens de communication tels le prolongement des canaux de construction et les chemins de fer. De riches investisseurs britanniques obtinrent des permis pour développer les terres des cantons de l'Ouest dans le Haut-Canada ("Western Townships") et de l'Est dans le Bas-Canada ("Eastern Townships"). Exclus de l'empire commercial contrôlé par les Anglais, les Canadiens français n'eurent d'autre choix que de se replier sur les rives du Saint-Laurent et de se consacrer à l'agriculture, seul débouché pour la main-d'œuvre francophone. Bref, pendant que les Anglais continuaient de contrôler l'économie et les capitaux, les Canadiens français restaient fidèles à leur terre, à leur curé et à leur langue, et fournissaient parfois la main-d'œuvre nécessaire à l'industrie (bûcherons, draveurs, débardeurs, employés des manufactures, etc.).
3.1 L'accroissement démographique
L'ennui, c'est que les possibilités d'expansion de l'agriculture commencèrent à être limitées à partir de 1830, par suite de l'accroissement démographique et de la révolution industrielle. D'une part, le surpeuplement des terres interdisait dorénavant l'expansion de l'agriculture; d'autre part, les nouvelles industries de la Nouvelle-Angleterre constituaient un débouché commode pour l'accroissement de la population. Au milieu du XIXe siècle, pendant que l'émigration francophone vidait le Québec, l'immigration anglophone comblait le déficit et venait augmenter la population anglaise de la ville de Québec (40 %) et de la ville de Montréal (55 %), occupant tous les postes administratifs, gérant le commerce et l'industrie.
Entre 1901 et 1931, le Québec accueillit 680 000 immigrants, tandis que plus de 822 000 personnes quittèrent le province au cours de la même période. C'est ce qui explique en partie pourquoi seulement 6 % de la population québécoise est aujourd'hui allophone. Jusqu'à la Révolution tranquille, jamais les francophones de cette province n'ont pensé utiliser le pouvoir de l'État pour modifier l'ordre des choses. Après la Loi de l'Union, ils assistèrent, impuissants, au déterminisme qui jouait contre eux. Aidés par une attitude de soumission entretenue par le clergé, les francophones croyaient à leur destinée spirituelle grandiose pendant que les anglophones accaparaient l'économie et les capitaux pour réaliser le processus d'industrialisation et d'urbanisation.
3.2 Les effets sur la langue
On devine l'effet de tous ces événements sur la langue, tant sur le plan du statut que sur celui du code du français. En effet, les différences entre le français de France et celui du Canada s'accentuèrent de plus en plus, notamment dans les villes.
- Le statut inégal des langues
Après l'Union du Canada-Ouest (Haut-Canada) et du Canada-Est (Bas-Canada) de 1840, la vie politique se déroula en anglais. Bien que reconnu presque sur un pied d'égalité avec l'anglais au Parlement du Canada-Uni à Kingston (aujourd'hui installé à Ottawa), le français se trouva très dévalorisé dans les faits. Les lois étaient rédigées en anglais, puis traduites en français. Les députés qui s'exprimaient en français ne pouvaient être compris des anglophones, pas plus qu'ils ne comprenaient les interventions de ces derniers. Au Bas-Canada (Canada-Est), l'anglais resta la seule langue de l'administration, des affaires, de l'économie, du commerce et de l'industrie.
- Le français des villes et des campagnes
L'industrialisation du pays entraîna l'arrivée de patrons et de cadres parlant anglais, ce qui eut des conséquences dans la connaissance de la nomenclature des lexiques anglais. Ce furent surtout des hommes d'affaires canadiens-anglais et des immigrants anglo-écossais qui dominèrent la nouvelle économie. L'économie du Bas-Canada (Québec) restera dominée par la grande entreprise anglophone jusqu'après le Seconde Guerre mondiale.
Pendant que les habitants (paysans), les ouvriers et les bûcherons demeuraient unilingues, l'élite francophone, qui gravitait autour des Anglais, prit conscience de l'omniprésence de la langue anglaise et de la dévalorisation du français, que ce soit dans le monde politique, économique, industriel, etc. De façon générale, le monde rural, sauf pour les enclaves anglophones (Outaouais, Cantons de l'Est et Gaspésie), paraissait mieux protégé au plan linguistique. Toutefois, au fur et à mesure que le capitalisme pénétra dans les campagnes, la langue anglaise faisait son entrée. Par exemple, le chemin de fer, la poste et le télégraphe contribuèrent à faire connaître les produits manufacturés et leur mode d'emploi en anglais.
En 1853, dans «Promenade en Amérique:
I. La Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France» (Revue
des Deux-Mondes), Jean-Jacques Ampère (1800-1867), fils du célèbre
physicien et professeur de littérature française au Collège de France, considérait
que l'accent des Montréalais ressemblait à celui des Normands:
| L'accent qui domine à Montréal est l'accent normand. Quelques locutions trahissent pareillement l'origine de cette population, qui, comme la population franco-canadienne en général, est surtout normande. Le bagage des voyageurs s'appelle butin, ce qui se dit également en Normandie et ailleurs, et convient particulièrement aux descendants des anciens Scandinaves. [...] On a dit à l'auteur: «Montais, m'sieu, il y a un biau chemin» et, en parlant d'un bateau: «Ne prenez pas celui-là, c'est le plus méchant» [...]. Pour retrouver vivantes dans la langue les traditions du Grand Siècle, il faut aller au Canada. L'habitant canadien ne parle pas le patois qu'on parle aujourd'hui dans les villages de Normandie |
 |
Alexis de Tocqueville fit un bref voyage au Bas-Canada, soit du 23 août au 2 septembre 1831. Dans une lettre à sa mère, en date du 19 juin 1831, alors qu'il était encore aux États-Unis, Tocqueville semblait répéter ce qu'il avait entendu dire au sujet de la langue des Canadiens: «Le Canada pique vivement notre curiosité. La nation française s'y est conservée intacte : on y a les mœurs et on y parle la langue du siècle de Louis XIV.» Après son passage au Bas-Canada, dans une lettre datée du 7 septembre 1831 à sa belle-sœur Émilie, Tocqueville semblait satisfait de sa visite : «Il n'y a pas six mois, je croyais, comme tout le monde, que le Canada était devenu complètement anglais.» Il se réjouissait de constater que les Canadiens parlaient encore le français, mais il s'agit d'un français de la Vieille-France auquel il n'était guère habitué. |
Nous nous sentions comme chez nous, et partout on nous recevait comme des compatriotes, enfants de la vieille France, comme ils l'appellent. À mon avis, l'épithète est mal choisie: la vieille France est au Canada; la nouvelle est chez nous.
De Tocqueville demeura inquiet quant à la survie des Canadiens français. Dans une lettre du 26 novembre 1831, il dit avoir trouvé un «peuple conquis»:
Je viens de voir dans le Canada un million de Français braves, intelligents, faits pour former un jour une grande nation française en Amérique, qui vivent en quelque sorte en étrangers dans leur pays. Le peuple conquérant tient le commerce, les emplois, la richesse, le pouvoir. Il forme les hautes classes et domine la société entière. Le peuple conquis, partout où il n'a pas l'immense supériorité numérique, perd peu à peu ses mœurs, sa langue et son caractère national.
Les écrits d'Alexis de Tocqueville ont retenu l'attention d'un grand nombre d'observateurs parce que ses analyses se sont révélé très lucides pour l'époque.
Retranchés dans l'agriculture, les paysans canadiens continuèrent de parler le français, sans être trop importunés par l'anglais qui gagnait les villes. Cependant, en raison de la reprise des contacts avec la France, les intellectuels canadiens-français prirent conscience que le français des habitants de ce pays n'était pas celui employé en France. Il était devenu un français de plus en plus archaïque et différent depuis la rupture avec la France. Un Français de passage au Canada, Théodore Pavie (1811-1896), écrivait en 1850 à propos de la langue des paysans canadiens:
Ils parlent un vieux français peu élégant; leur prononciation épaisse, dénuée d'accentuation ressemble pas mal à celle des Bas-Normands. En causant avec eux on s'aperçoit bien vite qu'ils ont été séparés de nous avant l'époque où tout le monde en France s'est mis à écrire et à discuter.
En fait, Théodore Pavie constatait simplement que le français du Canada n'avait pas beaucoup évolué depuis la Conquête. On retrouve d'ailleurs cette constatation dans les écrits de nombreux voyageurs français tout au long du XIXe siècle.
D'autres témoignages méritent d'être retenus, donc celui de
L'esprit canadien est resté français. Seulement on est frappé de la forme du langage, qui semble arriéré d'une centaine d'années. Ceci n'a certes rien de désagréable, car si les gens du peuple ont l'accent de nos provinces, en revanche, les gens du monde parlent un peu comme nos écrivains du XVIIIe siècle, et cela m'a fait une telle impression, dès le premier jour, qu'en fermant les yeux je m'imaginais être transporté dans le passé et entendre causer ces contemporains du marquis de Montcalm.
Si les voyageurs étrangers de la seconde moitié du XIXe siècle s'imaginaient entendre parler les contemporains de Montcalm, qui a vécu 100 ans plus tôt, cela signifiait simplement que, pour rappeler les mots de lord Durham en 1839 les francophones du Canada étaient restés «une société vieille et retardataire dans un monde neuf et progressif». Le témoignage du Français Henri de Lamothe (Cinq mois chez les Français d'Amérique: Voyage au Canada et à la Rivière-Rouge du Nord) est tout aussi significatif (1875):
Un isolement de cent ans d'avec la métropole a pour ainsi dire cristallisé jusqu'à ce jour le français du Canada, et lui a fait conserver fidèlement les expressions en usage dans la première moitié du XVIIIe siècle.
Évidemment, bien que certaines formes utilisées à l'époque de la colonisation française demeuraient encore présentes chez les Canadiens français, cela ne signifiait pas qu'ils parlaient le «français de Louis XIV» ou celui du marquis de Montcalm. Le français franco-canadien avait évolué, lui aussi, mais différemment de celui de la France.
- L'homogénéité du français canadien
De plus, les différences entre les classes sociales étaient moins grandes au Canada qu'en France. Ainsi, le Français Henri de Lamothe croyait aussi que tous les Canadiens français parlaient de la même façon, peu importe leur degré d'instruction ou leur origine sociale:
Quoi qu'il en soit, ce qui paraît surtout bizarre au Français arrivant d'Europe, c'est l'uniformité même de ce mode de prononciation, aussi bien chez les classes les plus instruites que chez les cultivateurs et les ouvriers.
James Roy, un linguiste canadien-anglais de l'époque, abondait dans le même sens (1877):
Nevertheless, the language, as a whole, over the entire country, amongst educated and uneducated alike, is the same. [Cependant, dans son ensemble, la langue, entre les gens instruits et non instruits, est la même dans tout le pays.]
Le Canadien Benjamin Sulte, journaliste, critique littéraire et historien, apporte également le même genre de commentaire (1878):
De Gaspé à Prescott, il [le français du Canada] ne varie pas et, ce qui est au moins aussi singulier, c'est que, à l'ouest de la province d'Ontario, dans le comté d'Essex, par exemple, où nos gens sont si nombreux, le langage est le même que sur les rives du Saint-Laurent et de l'Ottawa. Il est le même dans les États-Unis, partout où nous sommes répandus [...].
Benjamin Sulte ne fait pas mention de la langue des Acadiens, la seule variante légèrement différente. Mais contrairement aux Français en France, les Canadiens du Canada semblaient tous parler de la même façon. Quant aux Canadiens qui émigrèrent en Nouvelle-Angleterre (plus de 50 000 entre 1851 et 1901), s'ils ont pu conserver pendant quelque temps leur langue française, l'accélération de l'industrialisation et de l'urbanisation finit par entraîner l'assimilation de la plupart d'entre eux. En réalité, ces francophones qui choisirent de faire passer leurs intérêts économiques avant leur langue l'ont payé aux prix de perdre leur langue.
Le Français Henri de Lamothe (1875) apporte des précisions pertinentes au sujet des classes sociales de France qu'il compare à celles du Canada:
Chez nous, la centralisation, les communications faciles, la fréquentation d'officiers et de fonctionnaires originaires de toutes les parties de France, tout contribue à faire disparaître du langage des villes les provincialismes relégués désormais dans les campagnes, et à niveler l'accentuation, qui devient à peu près partout celle de la bourgeoisie et de la haute société parisienne. On comprend qu'un isolement de cent ans ait produit l'effet contraire au Canada, en y conservant dans leur intégrité le langage et les expressions en usage dans la première moitié du dix-huitième siècle.
La même année, le Français Gauldrée-Boileau rédigea une monographie de la famille d'Isidore Gauthier qu'il avait visitée en 1862 dans le village de Saint-Irénée (comté de Charlevoix). Dans «Paysan de Saint-Irénée» (Ouvriers des deux mondes, t. V), trace le portrait suivant de la langue des habitants du village:
Tous les habitants de Saint-Irénée parlent français, et le parlent même plus purement qu'on ne le fait généralement dans les campagnes de France. Quelques particularités cependant: emploi de mots vieillis et de tournures de phrases surannées, prononciation un peu différente de celle de France, introduction dans le langage d'expressions anglaises que l'usage a francisées. Quelques exemples: Je dérive la tête («je détourne la tête»), mon cheval est amarré de façon à ne pas grouiller («mon cheval est attaché de façon à ne pas bouger»), espérez un instant («attendez un instant»), tu me fais nuisance («tu me fais du dommage»), c'est de valeur («pour exprimer le regret que cause un événement fâcheux»), une créature («une femme»); si la roue d'un moulin est dérangée, le meunier se plaindra que son moulin est en démence. Beaucoup de locutions maritimes, qui se retrouvent encore dans les ports de mer de France. La prononciation ressemble à celle des paysans de la Basse-Normandie. Le français des campagnes est peut-être plus pur que celui des villes, de Montréal surtout, où les envahissements de la langue anglaise sont incessants.
Autrement dit, les provincialismes et l'accent de l'Ancien Régime auraient été conservés quasi intégralement (?) partout au Canada, alors qu'ils auraient été relégués dans les campagnes en France. De plus, l'accent parisien s'est formé sur celui de la bourgeoisie et de la haute société. Contrairement au Canada, il y a eu une distinction des classes sociales, et la haute société de Paris a servi de modèle au français, un modèle que les Canadiens n'ont pas connu après la rupture de 1763.
Dans Charles Ghérin, roman de mœurs
canadiennes publié en 1853,
Pierre-Joseph-Olivier
Chauveau (1836-1886), qui allait devenir le premier
premier ministre
du Québec en 1867, parlait ainsi de la langue des Canadiens dans une note:
 |
Pour P.-J.-O. Chauveau, le «bon français» est celui des campagnes, non celui des villes qui compte trop d'anglicismes. |
Jusqu'à cette époque, la langue française avait relativement été chargée au Canada de connotations positives pour l'identité collective des Canadiens français. Toutefois, ces différences, souvent inconnues dans les campagnes, ne suscitèrent pas vraiment des inquiétudes. Les paysans canadiens pensaient qu'ils parlaient «le français de France». Cependant, dans les décennies qui vont suivre, la langue sera perçue comme un facteur négatif. Il s'agira alors des premières manifestations de l'image péjorative que les Canadiens français auront d'eux-mêmes.
3.3 Le début de l'anglomanie
Dans les villes, l'anglais commença à envahir la vie économique et sociale. En 1841, un prêtre catholique, Thomas Maguire (1776-1854) — prononcer [magwèr] — né à Philadelphie mais qui a exercé son ministère au Québec, fut le premier «linguiste» canadien avec la publication du Manuel des difficultés les plus communes de la langue française, adapté au jeune âge, et suivi d'un recueil de locutions vicieuses.
L'abbé Maguire avait appris le français à Philadelphie avec des Français de France, qui y résidaient encore en grand nombre à cette époque, et avait effectué un assez long séjour à Paris. Il ne pouvait que s'être rendu compte de l'écart qui existait entre le français de la capitale française et celui de Québec. Son ouvrage marqua le début du purisme linguistique: il dénonçait avec force les anglicismes, les canadianismes et les vieilles expressions du Régime français. Tous les mots qu'il ne trouvait pas dans les dictionnaires français étaient systématiquement rejetés. Pour Maguire, c'étaient des mots «ignobles», «bas et révoltants», «barbares et dénaturés, usités chez le peuple». Néanmoins, l'ouvrage a une grande valeur historique, ne serait-ce que par les exemples témoignant de la prononciation et du vocabulaire des Canadiens de l'époque. On y apprend par exemple que les Canadiens disent «ça ne vaut pas un sol», alors que la monnaie française n'avait plus cours au Canada depuis longtemps, et qu'il faudrait dire «cela ne vaut pas un sous». L'auteur fit école dans tout le Canada français et plusieurs volumes du même type seront publiés par d'autres auteurs dans les années à venir.
Différents témoignages de l'époque révèlent, d'une part, l'influence de l'anglais
sur le français, d'autre part, la prépondérance de l'anglais dans la vie
commerciale.
Le Français
Alexis
de Tocqueville (1805-1859) avait, en 1831, découvert que la langue de travail des patrons
ainsi que celle de l'affichage étaient l'anglais, et ce, dans toutes les
villes du Canada français.
| Les villes, et en particulier Montréal (nous n'avons pas encore vu Québec) ont une ressemblance frappante avec nos villes de province. Le fond de la population et l'immense majorité est partout française. Mais il est facile de voir que les Français sont le peuple vaincu. Les classes riches appartiennent pour la plupart à la race anglaise. Bien que le français soit la langue presque universellement parlée, la plupart des journaux, les affiches, et jusqu'aux enseignes des marchands français sont en anglais. Les entreprises commerciales sont presque toutes en leurs mains. C'est véritablement la classe dirigeante au Canada. Je doute qu'il en soit longtemps ainsi. |
Toutefois, étant donné que la plupart des Canadiens français ne vivaient pas dans les villes, cette situation ne les émouvait pas trop. Ce sera uniquement à la fin du XIXe siècle que les perceptions vont changer encore davantage à ce sujet. La multiplication des commerces tenus par des anglophones ou des francophones qui les imitaient finira par donner aux villes un visage anglais. De plus, l'essor économique que connut la colonie fit entrer des produits britanniques dans tous les foyers et eut pour résultat de transformer les mentalités pour les adapter aux usages du monde britannique. En fait, l'anglomanie gagna peut à peu les Canadiens.
En 1852,
Jean-Jacques Ampère racontait ainsi
l'omniprésence de l'anglais et son influence sur le français du Canada :
| À peine débarqué, une querelle survenue entre deux charretiers fait parvenir à mon oreille des expressions qui ne se trouvent pas dans le dictionnaire de l'Académie, mais qui sont aussi une sorte de français. Hélas! notre langue est en minorité sur les enseignes, et quand elle s'y montre, elle est souvent altérée et corrompue par le voisinage de l'anglais. Je lis avec douleur manufacteur de tabac, sirop de toute description, le sentiment du genre se perd, parce qu'il n'existe pas en anglais, le signe du pluriel disparaît là où il est absent de la langue rivale. Signe affligeant d'une influence étrangère sur une nationalité qui résiste, conquête de la grammaire après celle des armes! |
En 1864, un député français,
Ernest Duvergier de Hauranne (1843-1877), vint passer quelque temps au Canada; il remarqua que
«les familles françaises de la classe élevée
commencent à copier les mœurs et le langage des conquérants».
Et il ajoutait: «Presque toutes les familles de l'aristocratie de Québec
ont contracté des alliances avec les Anglais et parlent plus souvent
la langue officielle que la langue natale. Le gouvernement en est plein.» Dans
un ouvrage intitulé Huit mois en Amérique (1864), il écrivait:
| À Montréal, je suis en pays français. Autant il est déplaisant de rencontrer des indigènes qui, par politesse ou ostentation de science, veulent me baragouiner ma langue, autant résonne harmonieusement à mon oreille ce jargon normand qui a gardé tout l'accent du terroir. |
En 1865, l'abbé
Thomas-Aimé Chandonnet
(1834-1881)
prononça un sermon
à la cathédrale de Québec, à l'occasion de
la fête de la Saint-Jean-Baptiste (le patron des Québécois); il s'insurgeait contre ceux qui cédaient ainsi
à l'anglais:
| Partout, sur nos places publiques, dans nos rues, dans nos bureaux, dans nos salons, vous entendez résonner l'accent envahisseur d'une langue étrangère. On va même jusqu'à infliger à sa langue maternelle la tournure de l'étrangère, jusqu'à traduire son nom propre, le nom de sa famille, le nom de ses ancêtres, à la traduire par un son étranger, quelquefois à la lettre. |
Pour sa part, le fougueux évêque de Trois-Rivières,
Mgr
Louis-François Laflèche
(1818-1898), déplorait lui aussi, en
1865, que ses compatriotes parlaient trop souvent la langue anglaise:
| Mes frères, je ne vous dissimulerai en rien ma pesée. Je le dis donc de nouveau, la plus lourde taxe que la conquête nous ait imposée, c'est la nécessité de parler l'anglais. Payons-la loyalement, mais n'en payons que le nécessaire. Que notre langue soit toujours la première. |
En 1888, dans Anglicismes et canadianismes, le journaliste et chroniqueur Arthur Buies (1840-1901) traitait ainsi des anglicismes:
|
Nous sommes infestés par
l'anglicisme ; l'anglicisme nous déborde, nous inonde, nous défigure et nous
dénature. Ce qui pis est, c'est que nous ne nous en doutons pas la moitié du
temps, et pis encore, c'est que nous refusons même, dans l'occasion, de
reconnaître ces anglicismes, quand ils nous sont signalés. Nous sommes
tellement habitués au mélange des deux langues, française et anglaise, que
nous ne faisons plus de différence et que nous ne reconnaissons plus le
caractère, le nature propre chacune d'elles. [...] Nous sacrifions une langue admirable, une langue d'une précision presque absolue, la langue analytique et savante par excellence, si riche et si abondante qu'avec son secours on peut exprimer non seulement les idées, mais encore les nuances les plus subtiles des idées, une langue qui a un mot pour chaque aspect des choses, pour la variété innombrable de ces aspects, une langue qui, afin d'exprimer tout ce qui existe, se fractionne indéfiniment comme on peut fractionner chaque tout ou chaque partie d'un tout, jusqu'à sa limite infinitésimale ; cette langue unique, incomparable, complète et parfaite autant que peut l'être un instrument humain tous les jours perfectionné, nous la sacrifions aveuglément, délibérément, à un jargon bâtard qui n'a ni origine, ni famille, ni raison ni principe, ni règle, ni avenir. Les journaux, les traductions, les pratiques légales ont été les trois grands ennemis de notre langue; ils l'ont corrompue, ils l'ont rendue méconnaissable. Il est impossible de comprendre quelque chose à la plupart de nos textes de lois, de nos bills, de nos documents parlementaires quelconques, cela sans compter les choses inutiles, les répétitions sans objet, les membres de phrase jetés sans rime ni raison en travers du chemin, les périssologies de toute espèce, fouillis de monstruosités linguistiques d'autant plus exécrables que nous avons à notre disposition une langue dont le caractère distinctif et tout particulier est la netteté et la concision, même dans la procédure, même dans la législation. Mais nous voulons absolument que l'anglais soit du français, et nous croyons y parvenir en employant des mots qui, pris isolément, sont français, mais qui, réunis, forment très bien des tours de phrase essentiellement anglais. |
Afin de faire face à la piètre qualité du journalisme canadien-français et de sa langue, Buies proposa en 1996 comme remède «la lecture ou la relecture des écrivains du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui ont formé la langue française et qu'il faut continuer à adopter comme modèles».
3.4 Le régime seigneurial
Le régime seigneurial avait été introduit en Nouvelle-France en 1627 par le cardinal de Richelieu. En vertu de ce régime, des seigneuries étaient découpées en longues bandes perpendiculaires aux cours d'eau. Des terres étaient concédées par le roi à des seigneurs, eux-mêmes locataires de terres et responsables de leur mise en valeur, que ce soit par la construction de routes et de moulins pour les habitants. Les quelques 200 seigneuries octroyées durant le Régime français — il y eut 240 seigneuries, trois baronnies, une châtellerie et deux comtés — couvraient toutes les régions habitées de part et d'autre du Saint-Laurent entre Montréal et Québec, la vallée de la Chaudière et la vallée du Richelieu, et atteignaient même la Gaspésie.
- Le maintien des
seigneuries
|
|
Après la Conquête de 1763, ce système s'est perpétué, bien qu'il constituait un obstacle à la colonisation du territoire par les Britanniques. Même l'Acte de Québec de 1774 conserva le système seigneurial, ce qui n'empêcha pas des Britanniques et des Écossais de faire l'acquisition de seigneuries. Ce système a eu des avantages énormes pour les francophones, surtout avec l'arrivée des Américains anglophones. En effet, le système seigneurial a conservé à peu près intact le centre traditionnel de peuplement francophone en orientant le population anglophone vers les territoires non constitués en seigneuries: les Cantons de l'Est, l'Outaouais, la Gaspésie et, dans une moindre mesure, la Basse-Côte-Nord et les îles de la Madeleine. |
Dans ces conditions, il fut plus facile pour les francophones de préserver leur caractère ethnique dans la province de Québec (Bas-Canada), puisque les anglophones du Bas-Canada ont préféré s'installer dans les Cantons de l'Est (townships), dans l'Outaouais ou dans la baie des Chaleurs (Gaspésie), parfois sur la Côte-Nord.
- Un repoussoir pour les anglophones
Les anglophones arrivés des États-Unis avaient en horreur la tenure seigneuriale française. Encore en 1850, le nombre des Britanniques était toujours très faible dans les seigneuries, soit à peine une personne sur dix, bien que plusieurs seigneuries appartenaient à de riches propriétaires anglophones. Le régime seigneurial aurait donc contribué à limiter grandement la colonisation agricole par les Britanniques dans tout le Bas-Canada (Canada-Est) et à diriger ailleurs l'arrivée des étrangers.
Autrement dit, le maintien du régime seigneurial fut certainement l'une des causes majeures de la survivance canadienne-française en Amérique et de l'homogénéité du peuplement francophone. Du fait qu'il a tenu les anglophones à distance, le régime seigneurial a protégé et bien servi les francophones. En ce sens, il est heureux que les Britanniques n'aient pensé à éliminer ce régime que vingt-cinq ans après la Conquête et que les Canadiens aient pris trente ans avant de l'abolir. Ce laps de temps a permis de conserver les seigneuries aux mains des francophones et d'agir comme repoussoir pour les anglophones. De plus, il a empêché tout accaparement des terres par des spéculateurs mafieux. Le système seigneurial est demeuré un régime bien adapté pour une population de paysans sans capitaux.
- Un système rétrograde
Toutefois, avec le temps, le système seigneurial allait finir par devenir un obstacle au développement économique lors de l'avènement de l'ère industrielle. Si le système seigneurial a été bénéfique pour le maintien de la langue française et l'homogénéité du peuplement, il a fini par être nuisible au développement économique des francophones.
L'abolition du régime seigneurial fut d'abord demandé par les hommes d'affaires et les industriels anglophones, ainsi que par un petit noyau de censitaires, de prêtres, de seigneurs, de notaires et d'arpenteurs francophones. En 1852 et 1853, des assemblées «anti-seigneuriales» furent tenues un peu partout dans la province et progressivement l'ensemble de la population finit par souhaiter l'abolition du régime seigneurial.
- L'abolition
Le régime fut finalement aboli par l'Assemblée législative du Canada-Uni, le 22 juin 1854, lors de l'adoption de la Loi sur l'abolition des droits et devoirs féodaux dans le Bas-Canada, le titre officiel à l'époque étant Acte concernant l'abolition générale des droits et devoirs féodaux. En abolissant un système qui maintenait des titres et des privilèges honorifiques à un seigneur, le gouvernement du Canada-Uni obligeait en même temps les habitants des terres (agriculteurs, fermiers, travailleurs agricoles, etc.) ou censitaires (locataires) à «racheter» les rentes annuelles qu'ils avaient payées pendant plusieurs générations, car ils n'avaient jamais été les vrais propriétaires des terres «concédées» par l'ex-seigneur, les droits de celui-ci étant perpétuels et non rachetables.
Dans le système seigneurial, les paysans avaient l'usufruit des terres sans avoir à les payer. Dans les régions divisées en cantons, les paysans devaient acheter les terres pour un montant convenu, dont il fallait payer l'intérêt. C'est pourquoi beaucoup de paysans canadiens préféraient payer une rente annuelle très basse, plutôt que d'acheter une terre. La loi de 1854 libérait les ex-censitaires de leurs rentes annuelles au moyen de paiements pour la «rente constituée», ce qui correspondait en fait à l'indemnité accordée au seigneur pour ses droits abolis. Ainsi, le gouvernement dédommageait en argent les seigneurs pour la perte de leurs privilèges. Mais c'est le censitaire qui payait, non le gouvernement.
Au moment de l'abolition du régime en 1854, les rentes annuelles étaient de 10 $ à 12 $ l'acre. Cependant, bien que ces sommes ne soient pas très élevées, elles n'étaient généralement pas à la portée de tous les paysans canadiens, en raison de leur grande pauvreté. À défaut de payer la somme totale, les paiements pouvaient être différés, c'est-à-dire étalés sur plusieurs années, voire des décennies ou indéfiniment, moyennant un intérêt annuel de 6 %. Ce ne fut qu'en 1945 qu'une loi québécoise mettra fin à cette situation anachronique de descendants d'ex-censitaires obligés de payer des indemnités aux descendants des ex-seigneurs. Dès lors, les «rentes seigneuriales» encore dues pour n'avoir pas été entièrement «rachetées» furent perçues par les municipalités. Les derniers paiements «pour rentes seigneuriales» seront effectuées le 11 novembre 1970, comme quoi cette institution aura profondément marqué la société francophone du pays.
Au moment de l'Union des deux Canadas en 1840, l'agriculture du Bas-Canada traversait déjà une période de crise depuis une décennie. En plus des mauvaises récoltes, la concurrence des agriculteurs du Haut-Canada avaient forcé ceux du Bas-Canada à abandonner la culture du blé. Le Bas-Canada connaissait aussi un début d'industrialisation dans les campagnes, ce qui favorisait la formation de nouveaux villages qui absorbaient une partie du surplus de la population rurale. La population du Bas-Canada allait passer de 350 000 habitants à plus d'un million entre 1815 et 1865. Les francophones représentaient plus de 85 % de cette population.
4.1 La surpopulation
Or, la plupart des Canadiens français résidaient dans les seigneuries surpeuplées de la vallée du Saint-Laurent avec comme résultat une pénurie de terres agricoles, ce qui obligeait jeunes familles à s'établir ailleurs. Ce surpeuplement entraîna un exode rural vers les villes, les nouvelles régions de colonisation (Saguenay, Outaouais, Mauricie, Cantons de l'Est) et les États-Unis. En réalité, attirés par de meilleurs salaires et des emplois, l'émigration des Canadiens français se fit surtout au profit des États-Unis. En 1839, le rapport de lord Durham en 1839 confirmait déjà l'existence d'un fort mouvement d'émigration vers les États-Unis:
Depuis longtemps, chaque année, des jeunes gens de la partie française du Bas-Canada émigrent en grand nombre vers les États du Nord de l'Union américaine, où ils sont hautement estimés comme manœuvres, où ils gagnent de bons salaires et reviennent en général à la maison quelques mois ou quelques années plus fard avec leurs épargnes.
Dans les deux décennies qui suivirent l'Union de 1840, plus de 30 000 Canadiens français émigrèrent vers les États-Unis qui devinrent une destination de choix pour plusieurs familles canadiennes, dont les membres allaient travailler dans les manufactures de textiles et de chaussures. Dès 1830, l'industrialisation était florissante aux États-Unis, tandis qu'elle était encore rudimentaire au Bas-Canada. En général, les deux tiers des émigrants provenaient de la classe agricole, alors que le tiers restant appartenait à la classe ouvrière. Bien que la plupart des émigrants partaient de Montréal, de Québec, des rives du Richelieu et de la rive sud le long du Saint-Laurent (Appalaches, Bas-Saint-Laurent, etc.), toutes les villes et toutes les régions furent touchées, sinon presque toutes les familles.
4.2 La Nouvelle-Angleterre
Tout ce monde est allé s'établir principalement dans les États de la Nouvelle-Angleterre (Vermont, Maine, Massachusetts, Rhode Island, etc.). Le Midwest (Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, etc.) attirait davantage les Canadiens du Haut-Canada, mais les uns et les autres étaient attirés par la proximité géographique. Pour les Canadiens français du Bas-Canada, la Nouvelle-Angleterre offrait des perspectives d'emploi d'autant plus intéressantes qu'il était facile de s'y rendre à un coût abordable. La Nouvelle-Angleterre représentait en quelque sorte une extension des frontières du Québec. Il était plus simple de se rendre en Nouvelle-Angleterre par train que d'aller au Saguenay ou dans l'Outaouais par voie d'eau, sans parler de l'Ouest canadien qui paraissait aussi loin que Londres. Le coût du transport et la distance à parcourir ont constitué des facteurs non négligeables dans l'histoire de l'émigration des Canadiens français vers les États-Unis. Ajoutons aussi un autre facteur important : le fait de savoir que des parents s'y trouvaient déjà et attendaient les nouveaux arrivants.
Les sources américaines laissent entendre que plus de 1,2 million de Canadiens sont allés s'installer aux États-Unis, entre 1850 et 1930:
Les Canadiens de
naissance aux États-Unis, par région,
d'après les recensements de États-Unis: 1850 à 1930
| Région | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 |
| États-Unis | 147 711 | 249 970 | 493 464 | 717 157 | 980 938 | 1 179 922 | 1 204 637 | 1 124 925 | 1 286 389 |
| New England Middle Atlantic East North Central West North Central South Atlantic |
49 008 50 281 40 742 4 226 795 |
70 826 59 901 85 005 22 032 1 209 |
159 445 91 538 165 559 51 918 2 249 |
242 928 100 094 233 589 91 249 3 924 |
380 167 100 062 275 573 126 087 5 412 |
511 190 139 427 297 645 124 678 6 920 |
526 239 148 369 273 140 102 849 8 681 |
476 256 138 300 253 892 80 705 13 041 |
518 865 162 430 296 996 63 430 17 663 |
| East South Central West South Central Mountain Pacific |
479 677 376 1 127 |
1 428 1 442 1 615 6 507 |
2 227 1 653 5 907 12 968 |
2 195 3 985 14 426 24 765 |
3 158 4 995 25 584 49 900 |
3 379 6 883 32 190 57 610 |
3 509 8 670 36 612 96 568 |
3 201 8 768 34 097 116 665 |
3 167 8 433 27 513 167 892 |
Le tableau précédent recense pour chaque
décennie, c'est-à dire entre 1850 et 1930, le nombre de «Canadiens», sans
indication de l'origine des émigrants. Or, ces
Canadiens n'étaient pas tous originaires du seul
Bas-Canada ou
de la seule province de Québec. Les historiens estiment, par exemple, que le
nombre des émigrés canadiens-français se serait établi à
Les tableaux qui suivent cumulent les chiffres concernant la distribution des Canadiens français en 1860 et en 1880, puis en 1900 et en 1930. Dans tous les cas, c'est le Massachusetts qui a attiré le plus les francophones: 20,3 % en 1860, 38,9 % en 1880, 48,1 % en 1900 et 45,3 % en 1930.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source: Ralph D. VICERO, Immigration of French Canadians to New England, 1840-1900, Ph.D thesis, University of Wisconsin, 1968, p. 275; as given in Yves ROBY, Les Franco-Américains de la Nouvelle Angleterre, 1776-1930, Sillery, Septentrion, 1990, p. 47 | Source: Leon TRUESDELL, The Canadian Born in the United States, New Haven, 1943, p. 77; as given in Yves ROBY, Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, Sillery, Septentrion, 1990, p. 282. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
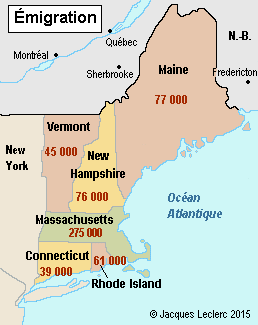 |
Les États de
la Nouvelle-Angleterre ont reçu beaucoup d'émigrants
canadiens-français: le Maine (77 000), le New Hampshire
(76 000), le Vermont (45 000), le Massachusetts (275 000),
le Rhode Island (61 000) et le Connecticut (39 000).
Les Canadiens français qui arrivaient aux États-Unis ont reproduit le type d'organisation sociale qu'il connaissaient au Canada. Ainsi, ils se regroupèrent en «paroisses françaises» desservies par des prêtres catholiques canadiens. La langue anglaise constituait certes un handicap, surtout pour les personnes plus âgées ou moins instruites, mais leur organisation sociale allait garantir pour un temps la survivance des communautés franco-américaines. Dans de nombreuses villes manufacturières, ces paroisses franco-catholiques ont certainement minimisé l'abandon de la culture et de la langue française, ainsi que la religion catholique. Souvent les résidants d'un village au Québec se retrouvaient dans une même ville aux États-Unis. Ce modèle d'émigration a considérablement réduit les difficultés d'adaptation des émigrants qui souvent se voyaient dans l'obligation de perdre complètement leur culture quand ils partaient. |
- La culpabilisation de la part des élites et du clergé canadiens
L'émigration massive des Canadiens français vers les États-Unis fut quand même mal perçue par les élites du Bas-Canada (ou du Québec), mais celles-ci se montrèrent incapables d'empêcher cette vague d'émigration. C'est l'un des plus illustres représentants des Canadiens français, George-Étienne Cartier, qui disait au sujet des émigrants: «Laissez les partir, c'est de la racaille qui s'en va.» Pour la classe politique, les Canadiens français qui quittaient le pays manquaient de patriotisme.
Quant au clergé, il traitait les émigrants de «paresseux» et de «fainéants» qui recherchaient la vie facile des Américains protestants et matérialistes; il leur prédisait qu'ils allaient perdre leur religion et leur langue, et les considérait comme des «égoïstes» insoucieux du sort de leurs compatriotes. En Nouvelle-Angleterre, le protestantisme dominait et le catholicisme restait cantonné dans les communautés irlandaises. Dans ces conditions, l'épiscopat canadien estimait de son devoir de s'opposer à cette émigration qu'il percevait comme une «calamité». Il tenta en vain d'encourager la «colonisation catholique» dans de vastes régions canadiennes encore inexploitées, mais il ne peut arriver à freiner le flux migratoire vers ce qu'on appelait «les États», malgré les efforts pour culpabiliser les émigrants.
- Le messianisme franco-canadien
Vers 1880, le clergé catholique québécois commença à considérait que les «Canadiens français des États-Unis» constituaient un élément important dans le développement du messianisme catholique en Amérique. C'est à ce moment qu'est apparue l'expression «Franco-Américains» pour désigner les Canadiens français habitant les États-Unis. Pour ce faire, il fallait que ces Franco-Américains puissent conserver fidèlement leur langue française au moyen de leur religion. En effet, le clergé canadien croyait que le français permettait aux Canadiens francophones de s'isoler et de se prémunir du monde protestant américain. Grâce à sa langue, le Canadien se trouvait soustrait aux principaux dangers qui assaillaient la foi des catholiques émigrés aux États-Unis. En 1891, le jésuite d'origine française Édouard Hamon (1841-1904) écrivait dans son ouvrage de 484 pages, intitulé Les Canadiens-français de la Nouvelle-Angleterre, les propos suivants:
Que les Canadiens-Français des États continuent donc de garder soigneusement leur langue nationale à l'église et au foyer domestique, afin de garder en même temps leurs croyances catholiques. Qu'ils défendent énergiquement cette langue contre toute attaque extérieure ou intérieure. Que toutes les forces dont ils disposent, église, couvent, Sociétés de St-Jean-Baptiste et journaux canadiens se donnent toujours une main vaillante pour protéger cette forteresse qui abrite les trésors les plus précieux.
Tant que les Canadiens français parleront français aux États, ils resteront catholiques. Du moment qu'ils perdront leur langue, en règle générale, ils perdront aussi leur foi, ou du moins ils ne garderont plus que des croyances religieuses fort affaiblies.
Édouard Hamon, à l'exemple des élites de la province de Québec, combattait avec vigueur le mouvement d'émigration vers les États-Unis. Il dénigrait le rôle des émigrés qui encourageaient par leurs «vantardises» l'exode de leurs compatriotes. Il admettait qu'on avait peint la réalité de l'exil sous les jours les plus sombres :
Il fut un temps, (et ce temps n'est pas très éloigné) où l'on ne pouvait parler des Canadiens émigrés qu'à la condition de les peindre sous les couleurs les plus sombres. C'étaient des malheureux plongés dans la misère la plus noire, des esclaves au service de maîtres impitoyables, des catholiques qui perdaient à la fois et leur langue et leur religion. Ils avaient quitté une patrie où coulait le lait et le miel pour s'en aller manger les oignons d'Égypte dans l'abjection et les larmes. Tous ces hommes, bien entendu, étaient perdus pour la religion et la nationalité.
Comme le père Hamon visitait souvent les communautés franco-américaines, il en vint à les percevoir avec un regard plus positif et présenter à leur sujet un portrait plus juste:
Vous n'avez pas à rougir de vos compatriotes émigrés. Ce sont gens d'énergie et de cœur, honnêtes et industrieux et qui, sur la terre étrangère, restent toujours catholiques et français. Partout, dans l'Est, nous avons retrouvé la paroisse canadienne reconstituée comme en Canada, partout nous avons vu les Canadiens groupés autour de leur église et de leur couvent, avec
des sociétés religieuses et patriotiques bien organisées.
Bon nombre de ces hommes sont dans le commerce et réussissent. Déjà même dans bien des villes de la Nouvelle-Angleterre, ils ont une part légitime aux emplois publics ; en un mot ces émigrés forment un peuple, un peu distinct d'allures et de tempérament, il est vrai, mais où les traits de famille sont parfaitement conservés. Le cœur de ces émigrés bat a l'unisson de notre cœur, leur langue est la même, en toute vérité, c'est bien un peuple catholique et canadien-français qui vit à côté de nous dans la Nouvelle-Angleterre.
De fait, le père Édouard Hamon avait acquis une connaissance approfondie de la situation des immigrants franco-américains. Dans Les Canadiens-français de la Nouvelle-Angleterre, il déplorait que l'exode massif affaiblisse la nation canadienne-française. Il croyait à leur survivance et y voyait le signe que la Providence leur avait confié la mission de gagner à l'Église les États américains de la Nouvelle-Angleterre.
- Les conséquences de l'émigration francophone
Néanmoins, à long terme, le rouleau compresseur américain devait avoir raison de la résistance des immigrants d'origine canadienne-française. Beaucoup d'Américains croyaient que ces francophones étaient idiots parce qu'ils ne parlaient pas anglais. C'étaient des catholiques qui, dans des églises catholiques, étaient regardés et traités comme des étrangers, qui ne saisissaient pas un mot des avis et des sermons du prêtre, qui n'entendaient rien à la musique locale, qui avaient peine à se faire comprendre en confession, qui se voyaient dans l'impossibilité de parler au prêtre de leurs enfants et de leurs ennuis, comme ils le faisaient avec leurs prêtres canadiens.
Lors de la Première Guerre mondiale, le gouvernement américain prit des mesures assimilatrices pour inciter ses citoyens d'origine étrangère à démontrer leur patriotisme. En Nouvelle-Angleterre, une campagne en faveur de l'assimilation de toutes les nationalités fut entreprise, notamment pour le contrôle des écoles afin d'y imposer l'anglais. Dans certains diocèses, le clergé catholique américain incitait les Canadiens à abandonner le français pour l'anglais. Des mesures plus énergiques furent prises à cette fin: interdiction d'école «canadienne», obligation aux enfants d'apprendre le catéchisme et les prières en anglais, communications en anglais avec les prêtres, etc. Les Canadiens français ont commencé par angliciser leur nom de famille (p. ex., Boisvert > Greenwood) avant de passer complètement à l'anglais. Après deux ou trois générations, l'assimilation était chose faite.
|
En 2000, le recensement américain révélait qu'en moyenne les Franco-Américains constituaient 1,9 % de la population, dont 5,2 % pour le Maine, 3,4 % pour le New Hampshire, 2,5 % pour le Vermont, 1,4 % pour le Massachusetts, 1,3 % pour le Connecticut et 1,9 % pour le Rhode Island. Ce tableau illustre très bien les conséquences de l'émigration des francophones aux États-Unis. L'assimilation a fini par absorber la langue et la culture françaises. Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre ne constituent plus aujourd'hui que de petites minorités dispersées. |
Les ravages de l'émigration francophone furent particulièrement considérables dans la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu'en 1930, au moment où le gouvernement américain décida de fermer la frontière canado-américaine. Le Québec, province à faible population, venait d'assister, impuissant, à une véritable saignée: durant près d'un siècle, soit entre 1840 et 1930, il a vu passer outre-frontière environ 1,2 million de ses effectifs, soit de 5 % à 10 % de sa population, chaque année. Ainsi, en 1901, au moment de l'apogée de cette émigration qualifiée alors de «Grande Saignée», près de la moitié de la population née au Québec résidait aux États-Unis.
On n'a pas encore fini d'évaluer les répercussions de cette saignée, qui a privé la province de Québec d'une partie très importante de sa population active. Selon les estimations démographiques, le Québec aurait aujourd'hui une population francophone de 12 à 14 millions d'habitants (contre sept actuellement). On devine qu'un tel poids démographique au sein de la fédération canadienne actuelle modifierait sensiblement les rapports de force entre anglophones et francophones.
4.3 L'arrivée des
francophones dans les Cantons-de-l'Est
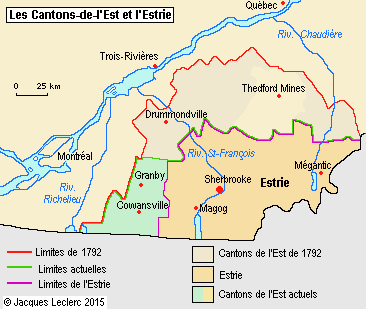 |
Si Beaucoup de Canadiens français émigrèrent aux États-Unis, d'autres décidèrent de demeurer au Canada dans les nouvelles terres de colonisation qui s'ouvraient à l'extérieur des seigneuries, notamment dans les «cantons» (Townships). Les Français n'avaient jamais développé la région des Cantons-de- l'Est. Après la Conquête, les Britanniques avaient conservé ce territoire comme zone tampon entre les seigneuries du long du Saint-Laurent et les Treize Colonies du Sud. En raison de la guerre de l'Indépendance et de l'arrivée massive des loyalistes américains, le lieutenant-gouverneur Alured Clarke ouvrit en 1792 les terres des Cantons-de-l'Est aux nouveaux arrivants. - La tenure des terres Ces terres furent concédées «en tenure de franc et commun socage». Au contraire des seigneuries (tenure française), la tenure de terres était concédée à prix fixe, sans redevance annuelle et en toute propriété. |
Cette tenure
était entrée en vigueur avec la
Loi constitutionnelle de 1791 et s'est appliquée partout dans le
Haut-Canada et sur le territoire situé au-delà des territoires des
seigneuries déjà concédées dans le
Bas-Canada.
Les individus qui
désiraient obtenir ces terres devaient former des compagnies et
faire une pétition pour obtenir des terres. Quelques milliers
d'Américains vinrent s'établir dans les Cantons à partir de 1820,
mais ils furent aussitôt suivis par des familles irlandaises, puis
écossaises vers 1830. Tous ces immigrants parlaient anglais, mais
certains utilisaient encore le gaélique irlandais ou le gaélique
écossais; tous bénéficiaient de l'avantage de pouvoir utiliser leur
langue, leur religion et les lois britanniques.
Jusqu'en 1840, peu de Canadiens
français s'établirent dans les Cantons-de-l'Est, notamment parce qu'il
restait encore des terres disponibles ailleurs que dans les seigneuries,
par exemple au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, dans l'Outaouais ou
dans les Laurentides. Toutefois, quelques familles francophones
vinrent s'établir dans les Cantons-de-l'Est, surtout des journaliers
et des ouvriers agricoles. Vers 1840, au moment de l'Union, l'Église
catholique, qui voyait d'un mauvais œil des milliers de
Bas-Canadiens quitter le pays pour la Nouvelle-Angleterre, incita des
familles à aller s'établir dans la région des Cantons-de-l'Est.
- Le déferlement des francophones
L'arrivée des Canadiens français fut d'abord timide. Les familles étaient isolées et, en raison du contact avec la culture anglophone, elles durent se regrouper dans certains villages. C'est pourquoi l'Église aida les familles à s'installer et à se regrouper afin qu'elles puissent vivre dans la foi catholique et en français, mais elles demeurèrent peu nombreuses au cours des premières décennies. Arrivèrent en même temps des Écossais, surtout dans la région du lac Mégantic, de Stornoway, de Scotstown, de Gould, etc., qui ne parlaient que le gaélique écossais.
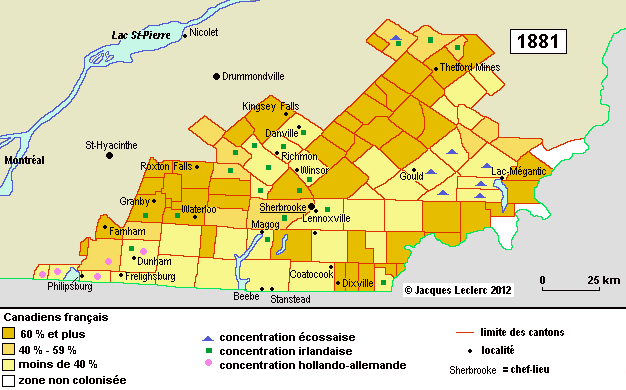 Source: Jean-Pierre KESTEMAN, Diane SAINT-PIERRE et Peter SOUTHAM. Histoire des Cantons-de-l'Est, Québec, Presses de l'Université Laval, 1999. |
De 1840-1849, quelque 3000
catholiques irlandais s'installèrent à Richmond et au nord de
Shefford, puis dans plusieurs autres cantons (Eaton, Tingwick,
Lingwick, Ely, Kingsey, Dunham, Magog, Wolfestown). Comme on le
sait, les Irlandais catholiques qui se sont installés dans la
province de Québec à cette époque partageaient les croyances
religieuses que les Canadiens français. Avec le chemin de fer, les terres devinrent plus faciles d'accès, tandis que l'industrialisation fournissait des emplois en grand nombre. De ce fait, les Cantons-de-l'Est devinrent tout aussi attirants que les États de la Nouvelle Angleterre. De 1844 à 1861, le nombre des Canadiens français a presque quadruplé au pont où ils formaient près de 48 % de la population en 1861, alors qu'ils ne comptait que pour 25 % en 1844. |
-
Une majorité francophone
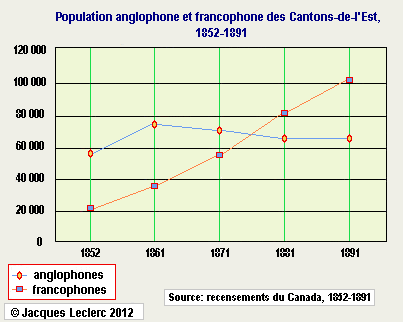 |
À partir de 1871, la majorité anglophone
commença à basculer: le recensement de cette année-là révélait que les
anglophones étaient 70 000; les francophones, 53 000. En 1881, les francophones
étaient passés à plus quelque 82 000, alors que le nombre des anglophones avait baissé à
plus de 67
000. Les francophones ont donc pris une trentaine d'années pour devenir
majoritaires, aidés en cela par un fort taux de natalité.
Dès lors, le nombre des francophones continuera d'augmenter; celui des anglophones, de stagner. Ce furent notamment l'arrivée du chemin de fer à partir de 1851 (St. Lawrence and Atlantic, Grand Trunk Railway, Massawippi Valley Railroad, Quebec Central Railway, International Railway, Waterloo & Magog Railway, Canadian Pacific Railway) et l'installation de nouvelles industries, qui contribuèrent à attirer les francophones dans cette vaste région du Bas-Canada. Les francophones peuplèrent surtout les cantons du Nord et ceux de l'Est, ainsi que le long de la frontière au sud-est. |
C'est à cette époque (en 1858) que les Eastern Townships prirent le nom français de «Cantons-de-l'Est», une traduction littérale (qui deviendra «Estrie» en 1981). Aujourd'hui l'appellation Estrie est employée pour désigner la région administrative, alors que Cantons-de-l'Est désigne la région touristique, ce qui peut être différent au point de vue de la superficie géographique.
Au début de leur pénétration dans la région, la plupart des francophones venaient de la région de Saint-Hyacinthe et, par la rivière Saint-François, de Trois-Rivières et de la région de Québec. À partir de 1888, les trains circulèrent, sous la gestion directe du Canadien Pacifique, entre Montréal et Lac-Mégantic en passant par Sherbrooke, ce qui favorisa la venue des Montréalais francophones dans toute la région des Cantons-de-l'Est, qui bénéficiait alors du réseau ferroviaire le plus dense de toute la province de Québec, et ce, en raison de ses liaisons avec les États-Unis.
Pendant plusieurs décennies, Canadiens français, Anglais, Écossais et Irlandais cohabitèrent dans une certaine harmonie, puis les différences de religion, davantage que la langue (français et anglais), finirent par susciter des conflits entre protestants et catholiques. C'est dans des villes manufacturières telles que Sherbrooke, Granby et Magog que prit naissance un prolétariat principalement constitué d'Irlandais et de Canadiens français, ainsi qu'une bourgeoisie anglophone, avec plusieurs classes d'artisans, de marchands et de professions libérales, d'abord anglophones, puis progressivement francophones. La petite ville de Sherbrooke, chef-lieu de la région, comptait 2964 habitants en 1861 pour atteindre 10 000 en 1896. À la fin du XIXe siècle, les anglophones, devenus très minoritaires, préférèrent quitter leurs villages pour Montréal ou pour l'Ouest canadien, sinon pour le Far-West américain.
Aujourd'hui, les francophones de l'Estrie forment plus de 90 % de la population, les anglophones étant généralement bilingues, sauf pour la génération plus âgée parfois demeurée unilingue anglaise.
4.4 Les retrouvailles
France/Bas-Canada)
 |
En 1855, l'amarrage de
la frégate française La Capricieuse, commandé par le
capitaine Paul-Henry de Belvèze
(1801-1875), au port de Québec et son séjour
du 13 juillet au 25 août 1855 causa tout un moi au Canada
français. C'était la première fois depuis la Conquête anglaise
de 1763 qu'un navire français remontait le Saint-Laurent.
L'événement fut célébré de façon extraordinaire par les
Canadiens au moyen de discours et de cérémonies
officielles de toutes sortes. La venue de La Capricieuse
fut longtemps considérée comme le début des relations
franco-québécoises.
Or, le gouvernement français n'avait aucune intention politique envers le Canada en autorisant cette mission. La priorité de politique étrangère de Napoléon III qui dirigeait alors France était le rapprochement avec la Grande-Bretagne, pas la colonie canadienne francophone. L'objectif devait être avant tout symbolique, car les promesses commerciales ne furent suivies d'aucun effet concret. |
La France de Napoléon III voulait souligner l'Entente cordiale avec la Grande-Bretagne, car l'empereur n'a jamais porté un quelconque intérêt pour la colonie britannique du Canada. L'ennemi juré de la France n'était plus la Grande-Bretagne, mais la Prusse. À Québec et à Montréal, les poètes et les publicistes célébrèrent l'événement avec exaltation. Ainsi, Octave Crémazie (1827-1879) voulut immortaliser le sentiment de nostalgie des Canadiens français pour la France par un poème intitulé «Le Vieux Soldat canadien».
|
Le 18 juillet
1855, le capitaine Paul-Henry de Belvèze alla inaugurer, sur
les plaines d'Abraham, la pose de la pierre angulaire du
«monument des Braves» dédié aux soldats français et
anglais morts lors de la bataille de Sainte-Foy du 28
avril 1760. La cérémonie s'est faite sous la présidence du
gouverneur général du Canada, sir
Edmund Walker Head.
L'érection du monument ne débuta qu'en 1860, pour marquer le
centenaire de la célèbre bataille, mais l'œuvre dessiné par
l'architecte Charles Baillairgé ne fut inaugurée que le 19
octobre 1863.
Deux plaques rappellent les deux généraux dirigeants les armées ennemies, François Gaston de Lévis (1719-1787) et le général James Murray (1721-1794). |
Le surintendant de l'Instruction publique et futur premier ministre du Québec (du 15 juillet 1867 au 27 février 1873), Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1820-1890), trouva une certaine gloire à ce que le Canada soit réunies par deux généraux, l'un français, l'autre britannique, soit l'ex-colonie et la colonie, les deux puissances coloniales de l'époque:
Vingt-huit avril mil sept cent soixante, jour que la Providence, dans leurs revers, réservait à nos ancêtres, pour qu'ils fussent les derniers vainqueurs dans une lutte dont ils devaient eux-mêmes être le prix ; pour que le peuple conquis pût toujours marcher tête levée et l'égal de ses conquérants (préparant ainsi l'union fraternelle qui, ici comme ailleurs, devait un jour régner entre les deux races, en leur distribuant des lauriers cueillis sur le même champ de bataille); jour aussi glorieux pour les vaincus que pour les vainqueurs, puisse ton souvenir, que nous évoquons, m'inspirer des paroles qui ne soient pas trop au-dessous de celles qu'il faudrait pour te raconter dignement ! [...]
Et aujourd'hui, les drapeaux de la France et de l'Angleterre, unis par des banderoles qui portent les noms de victoires gagnées en commun, flottent amis sur le champ de bataille du 13 septembre et du 28 avril, comme sur les mers de l'Europe et sur les rochers de l'antique Chersonèse ! [...]
Le gouvernement français avait décidé de freiner l'enthousiasme des Canadiens français en multipliant les consignes de prudence de la part des officiers de la Marine afin de ne «pas éveiller les susceptibilités britanniques» par une mission qui pouvait être mal comprise. De plus, la France retarda la nomination d'un consul jusqu'en 1858. En somme, la mission française se situait en dehors de toute tentative de rapprochement privilégié avec les Canadiens français.
Néanmoins, après La Capricieuse et l'établissement d'un consulat à Québec et à Montréal, les communications avec la France se firent plus nombreuses. Il devint plus facile pour les Bas-Canadiens de s'approvisionner en livres français. Les voyages attirèrent davantage de Canadiens vers Paris et Lourdes que vers Rome. Pour sa part, l'évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, se mit à recruter plus de communautés religieuses en France.
4.5 Bilan de la colonisation britannique
En résumé, nous pouvons affirmer que la colonisation britannique au cours de l'Union des deux Canada ne fut pas des plus exemplaires au point de vue démocratique. En effet, les autorités britanniques de la Métropole ont décrété un partage inégal et désavantageux de la nouvelle dette commune, alors que le Haut-Canada était très endetté et que le Bas-Canada avait une dette minime. Sans l'accord de la colonie du Bas-Canada, qui formait la majorité de la population, Londres a imposé un régime de représentation égale et non proportionnelle à la population, bafouant le principe de «la représentation selon la population» ("Rep by Pop"). Par la suite, une fois que le Bas-Canada francophone soit devenu une minorité dans le Canada-Uni, Londres est revenu à «la représentation selon la population» qu'il avait refusée auparavant pour l'accorder au Haut-Canada anglophone. Il s'agissait là d'une démocratie à deux vitesses qui avantageait celle du plus fort. À cette époque, la démocratie britannique était pourtant considérée comme un modèle du genre dans le monde.
- Une démocratie pour les riches
Les Britanniques ont aussi considéré les Canadiens français comme des trouble-fête et des traîtres sans tenir compte des arguments de leurs représentants, qui reposaient sur des principes démocratiques et républicains, à l'exemple de ce qui se passait aux États-Unis. Mais le parlementarisme britannique à cette époque concevait la démocratie comme la défense des intérêts privés et des libertés individuelles des riches et des enrichis, nullement comme le pouvoir du peuple. La démocratie au milieu du XIXe siècle était réservée aux gens riches, les grands propriétaires et les marchands.
Par exemple, le fameux «peuple des États-Unis» ("We, the People of the United States"), dont il est fait mention dans la Constitution américaine de 1787, ne concernait ni les femmes, ni les Noirs, ni les Indiens, ni les serviteurs, etc. Cette constitution fut rédigée par une petite élite coloniale, soit 55 hommes parmi les plus riches de la Nouvelle-Angleterre, et servait avant tout à protéger leurs propres intérêts. Pourtant, cette constitution apparut à l'époque comme une «œuvre de génie» pensée par des hommes sages et remplis d'humanisme. Dans les colonies de l'Empire britannique, il ne fallait pas s'attendre à une démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Il fallait posséder des biens et être un homme pour avoir le droit de vote.
- La corruption érigée en système
Dès 1840, lord Durham avait proposé de faire miroiter aux rebelles («patriotes») les avantages de ce qui fut appelé la «petite loterie coloniale» (en anglais: "small colonial lottery"). Celle-ci consistait à «corrompre» les chefs patriotes de l'époque pour en faire des alliés de la Couronne britannique. Il s'ensuivit une «conversion» rapide de plusieurs patriotes, qui comptèrent parmi les plus grands promoteurs du «patronage» érigé en système. En 1842, Louis-Hyppolite La Fontaine résumait ainsi la situation politique du Canada-Uni: «Le patronage, c'est le pouvoir.»
C'est ainsi que des leaders tels Étienne Parent, Louis-Hippolyte La Fontaine et George-Étienne Cartier se laisseront convaincre d'abandonner leur idéal républicain et même de dénoncer la résistance face à l'Acte d'union. En retour, ces chefs graviront tous les échelons jusqu'au sommet du gouvernement. Ce système de distribution des faveurs afin de s'assurer la collaboration des chefs patriotes serait appelé aujourd'hui un «système de corruption» qui avait pour but de centraliser le pouvoir de l'État en muselant toute velléité démocratique au sein d'une population dont la grande majorité n'avait pas le droit de vote. Durant les trois décennies qu'a durées l'Union, le favoritisme a fonctionné de telle sorte qu'il a constitué la clé de voûte du système politique colonial.
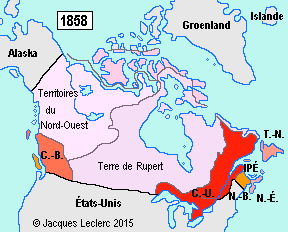 |
Une dizaine d'année avant 1867, l'Amérique du Nord britannique comprenant plusieurs colonies distinctes et autonomes (d'ouest en est): la Colombie-Britannique, l'île-de-Vancouver (qui fusionnera avec la C.-B. en une seule colonie en 1866), le Canada-Uni (ou C.-U., les parties méridionales de l'Ontario et du Québec), le Nouveau-Brunswick (N.-B.), la Nouvelle-Écosse (N.-É.), l'Île-du-Prince-Édouard (IPÉ), Terre-Neuve (T.-N.). Les autres territoires appartenaient à la Hudson's Bay Company (Compagnie de la Baie d'Hudson). Dès la fin des années 1850, la colonie du Canada-Uni était plongée dans une impasse politique. En effet, aucun gouvernement ne pouvait s'assurer d'une majorité à la Chambre d'assemblée. C'est alors qu'un grand nombre de politiciens envisagèrent la création d'un État fédéral qui s'étendrait de l'Atlantique au Pacifique et qui règlerait tous les problèmes de la colonie. |
5.1 Les négociations et la question linguistique
En 1864, le réformiste du Haut-Canada,
George Brown (1818-1890), proposa aux chefs conservateurs des deux Canadas de constituer avec lui et les libéraux un gouvernement de coalition qui serait en faveur d'une union fédérale des deux provinces. Pour ne pas être politiquement isolé, George-Étienne Cartier (1814-1873), le chef des réformistes du Canada-Est (Bas-Canada), se joignit à la coalition et participa activement au projet fédératif. Ce fut la «Grande Coalition», comme on l'appellera plus tard, qui réunissait trois des quatre principaux groupes politiques du Canada-Uni: les conservateurs anglophones de John Alexander Macdonald (Haut-Canada), les conservateurs francophones de George-Étienne Cartier et les réformistes de George Brown.- Le projet d'État fédéral
Le projet d'État fédéral laissait au Bas-Canada ou au Canada-Est (le futur Québec) la possibilité de posséder son propre gouvernement, de gérer ses affaires concernant le droit civil, la langue, la religion et le patrimoine culturel. Les premières négociations pour former une fédération des colonies britanniques en Amérique du Nord s'amorcèrent en 1864. Aucun francophone du Haut-Canada (la future Ontario) ou des provinces maritimes (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Édouard, etc.) n'a participé aux débats sur la Confédération. Évidemment, aucune disposition ne fut prévue à l'intention des minorités francophones des provinces anglaises. À ce moment-là, le français et l'anglais étaient reconnus comme les langues officielles de la Chambre d'assemblée commune du Canada-Uni, ainsi que dans les tribunaux communs de la «Province du Canada», qui comprenait le le Canada-Ouest (Haut-Canada) et le Canada-Est (Bas-Canada). Mais l'anglais demeurait la seule langue utilisée dans les autres colonies: Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve.
Du fait que le projet de «confédération» prévoyait un cadre fédéral dans lequel deux ou plusieurs provinces avaient chacune leur gouvernement, deux groupes linguistiques se trouvaient à voir s'accentuer leur statut de minorité. C'était le cas d'abord pour les Canadiens français déjà devenus minoritaires dans la «Province du Canada»; ils le deviendront encore davantage lorsque d'autres colonies se joindront à la fédération. Mais c'était aussi le cas des anglophones du Bas-Canada (Québec), qui se trouveront en quelque sorte «coupés» de leurs compatriotes du Haut-Canada (Ontario), puisqu'ils seront inclus dans une province à majorité francophone.
- La question linguistique
Parmi les résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864, une seule concernait la langue. C'était la 46e résolution qui se présentait comme suit:
Résolution 46 Les langues anglaise et française pourront être simultanément employées dans les délibérations du Parlement général ainsi que dans la législature du Canada-Est, et aussi dans les cours fédérales et les cours du Canada-Est.
Cette version était quelque peu différente de la proposition originale d'
Alexander Tilloch Galt, l'un des négociateurs et défenseurs de la clause concernant le respect des droits scolaires de la minorité anglo-protestante du Québec. Le texte de Galt ne faisait allusion qu'aux tribunaux fédéraux du Canada-Est (Bas-Canada), ce qui déplut considérablement aux Canadiens français.
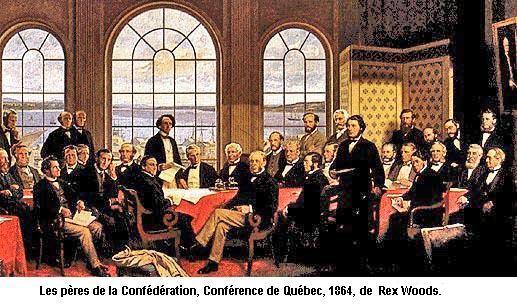 |
Lorsque le débat s'engagea sur les résolutions du Canada-Est, les
négociateurs francophones firent valoir que cette disposition
n'offrait guère de garanties et qu'il faudrait remplacer «pourront»
par «devront» au sujet de la langue du Parlement et de la
législature. Leurs revendications seront heureusement tenues en compte.
Ceux qu'on appelle les «pères de la Confédération» sont des hommes politiques canadiens qui ont participé aux Conférences de Charlottetown (septembre 1864), de Québec (octobre 1864) et de Londres (décembre 1866) dans le but de fonder le nouveau pays qui allait être le Canada de 1867. Les délégués du Québec étaient George-Étienne Cartier, Jean-Charles Chapais, Alexander Tilloch Galt, Hector-Louis Langevin, Thomas D'Arcy McGee et Étienne-Pascal Taché. L'Ontario avait sept représentants dont John Macdonald et George Brown; le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard avaient entre cinq et sept délégués, mais Terre-Neuve n'avait que deux observateurs. |
- L'apport de J.-A. Macdonald
C'est essentiellement John Alexander Macdonald (1815-1891), le futur premier ministre du Canada, qui rédigea la majeure partie de la future Constitution canadienne. Il s'en est confié ainsi au juge James Robert Gowan de Barrie (en Ontario): «Tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans la Constitution est de moi.» Pour lui, il ne pouvait être question de placer une langue en situation inférieure:
| I disagree with the viewpoint expressed in certain quarters that we must somehow attempt to suppress one language or place it in an inferior position with regard to the other; any such attempt is doomed to failure, and even were it possible, would be foolish and petty. | [Je suis en désaccord avec le point de vue exprimé en certains milieux selon lequel il faut tenter de quelque façon que ce soit d'opprimer une langue ou de la placer dans une position inférieure par rapport à une autre; toute tentative en ce sens serait vouée à l'échec, et même si c'était possible, cela serait insensé et mesquin.] |
Cependant, c'est George-Étienne Cartier (1814-1873) — il orthographiait son prénom à l'anglaise, sans -s, en l'honneur du souverain régnant George III — qui fut le grand responsable des dispositions linguistiques de l'article 133 protégeant le français au Parlement et dans les tribunaux fédéraux. Cet article 133 du projet constitutionnel prévoyait le droit des provinces de décider de la langue d'enseignement dans les écoles publiques. Le système scolaire canadien allait être confessionnel et non pas linguistique: les écoles devaient être catholiques ou protestantes, et non francophones ou anglophones.
Cette disposition convenait doublement au Canada. D'une part, les protestants, majoritaires au Canada et en Amérique du Nord ne craignaient pas pour leur langue, mais pour leur religion. D'autre part, l'Église catholique loyaliste, qui avait réussi à obtenir en 1841 et en 1846, la confessionnalisation des écoles du Bas-Canada (Canada-Est), alors que l'ultramontanisme militait en faveur de l'alliance du religieux et du politique ainsi que sa primauté dans les «questions mixtes», défendait ses intérêts à la fois spirituels et temporels en obligeant de faire chez les écoliers d'abord des catholiques, ensuite des francophones. C'est dans cette perspective que l'Église catholique intervint publiquement dans le débat politique. Elle défendait Rome et le pape, soutenait l'alliance du pouvoir religieux et du pouvoir politique et allait obtenir le contrôle des écoles qui devaient être confessionnelles avant d'être linguistiques. Ainsi, le Canada français devait d'abord être catholique, français ensuite.
La Constitution de 1867 devait néanmoins accorder au Québec l'autonomie nécessaire pour protéger sa langue, sa tradition de droit civil et sa religion. Quant à Alexander Tilloch Galt (1817-1893), il rédigea les dispositions concernant les droits linguistiques des anglophones du Québec, notamment l'article 93 sur l'éducation. George-Étienne Cartier avait été reçu par la reine Victoria en 1858 et c'est à cette occasion qu'il déclara qu'un habitant du Bas-Canada était «un Anglais qui parle le français». En 1865, Cartier se rendit à nouveau Londres après la session d'avril du Parlement afin de présenter au gouvernement britannique le projet de fédéralisme conçu à la Conférence de Québec (1864) et approuvé par la législature du Canada-Uni.
- Le rôle de la bourgeoisie anglaise
Certains historiens estiment que le
Canada a d'abord été créé dans le but de répondre aux intérêts de la bourgeoisie
coloniale anglaise, voire écossaise. Beaucoup de nouveaux Canadiens de
descendance anglaise venaient soit directement d’Angleterre soit des colonies
américaines. En 1819, la moitié des sujets britanniques qui voguaient vers
l'Amérique du Nord britannique étaient des Anglais des îles Britanniques. Cette
vague d’immigration prit fin en 1851: quelque 93 000 immigrants nés en
Angleterre demeuraient dans le Haut-Canada (Ontario), soit le dixième de sa
population; les Écossais étaient presque aussi nombreux (90 000), mais les
Irlandais (227 000) les dépassaient largement. Dans tous ces cas, la motivation
était essentiellement d'ordre économique. Quant aux immigrants américains
d'origine britannique, la plupart étant des loyalistes; les motifs qui les
poussaient à quitter les États-Unis étaient avant tout d'ordre politique. De
façon générale, la bourgeoisie anglo-canadienne n'avait aucune ambition d'ordre
national suffisante pour se distancier de la mère-patrie: elle voulait demeurer
britannique et elle se satisfaisait très bien du maintien du Canada dans
l'Empire britannique. Dans cette perspective, l'ex-colonie du Canada n'était pas
différente de l'Australie ou de l'Inde, ou de l'Algérie ou du Congo, sinon de
l'Indonésie qui, à la même époque, étaient aussi des avant-postes lucratifs de
la bourgeoisie d'affaires européennes (britanniques, françaises et
hollandaises). Cet intérêt pour fonder un pays distinct, le Canada, n'était
partagé que par les Canadiens de langue française. Pour les anglophones, le
Canada n'était qu'un rejeton de l'Angleterre.
Ce manque d'intérêt à la création d'une «nation canadienne» distincte du
Royaume-Uni explique que le nouvel État ait été si peu empressé à s'affranchir
des liens de subordination à l'endroit de Londres. Ainsi, il aura fallu attendre
à 1908 pour frapper une monnaie canadienne, à 1964 pour avoir un drapeau
canadien et à 1980 pour obtenir un hymne national canadien. Il fallut attendre
cent quinze ans pour rapatrier la Constitution au Canada (1982). Encore
aujourd'hui, le chef de l'État canadien est toujours le souverain britannique.
5.2 La dénomination officielle du Canada
Depuis 1867, on a souvent appelé le Canada, dans sa dénomination longue, la Confédération canadienne. Or, le Canada de 1867 avait plutôt choisi l'appellation officielle de Dominion du Canada en parlant de l'«Union fédérale», mais le terme de «Dominion» a fini depuis par tomber en désuétude. Néanmoins, le mot confédération s'est perpétué jusqu'à nos jours pour désigner le pays, bien que celui-ci n'ait aucune valeur officielle ni juridique: on ne le retrouve même pas dans la Constitution canadienne de 1867. En simplifiant, on peut dire que le Dominion du Canada fut formé le 1er juillet 1867 par la confédération de quatre colonies (Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick) de l'Amérique du Nord britannique afin de former une Union fédérale, c'est-à-dire une fédération.
Pour les contemporains de 1867, le préfixe «con» dans confédération se voulait une façon de se distinguer de la fédération américaine en croyant que le Canada était un renforcement du principe fédératif. Les
termes de fédération et de confédération étaient généralement employés comme synonymes, car à cette époque personne ne faisait une réelle différence d'ordre sémantique. Les fondateurs du Canada de 1867, quelque 36 notables agissant comme négociateurs, ont été appelés les «Pères de la Confédération», alors qu'on aurait tendance aujourd'hui à les appeler les «fondateurs du Canada». De nos jours, lorsqu'on parle de «confédération» en faisant référence au Canada — l'expression «Confédération canadienne» est restée dans l'imaginaire collectif pour désigner une époque —, il faut savoir que «confédération» a le sens de «fédération». Les provinces et territoires qui se sont ajoutés après 1867 ont joint une fédération, non une confédération.L'ambiguïté provient du fait que, pour deux colonies — l'Ontario ou Haut-Canada ou Canada-Ouest et le Québec ou Bas-Canada ou Canada-Est— , il s'agissait d'une confédération et pour les autres d'une fédération. Le Haut-Canada (Ontario) et le Bas-Canada (Québec) ont en effet participé en 1841 (sous l'Union) à la création d'une véritable confédération. Pour les autres provinces qui, en 1867, ont été constituées par le pouvoir central, il s'agissait d'une fédération.
C'est en 1866, lors de la Conférence de Londres, que les délégués canadiens avaient convenu d'appeler le nouveau pays par "Kingdom of Canada" («Royaume du Canada»). Le gouvernement britannique refusa la proposition sous prétexte que les Américains se montreraient hostiles à un régime ouvertement monarchique à leurs frontières. Le délégué en chef du Nouveau-Brunswick, Samuel Leonard Tilley (1818-1896), a alors proposé "Dominion of Canada". La proposition d'utiliser le mot Dominion fut jugée complètement ridicule par le premier ministre britannique de l'époque (John Russell), mais la reine Victoria le trouva fort acceptable.
Pour simplifier la complexité terminologique, on peut dire que le Dominion du Canada fut formé le 1er juillet 1867 avec la confédération de quatre provinces fondatrices (Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick) de l'Amérique du Nord britannique pour former une Union fédérale. Il faut ajouter qu'au XIXe siècle les termes fédération et confédération étaient généralement employés comme synonymes. En droit, le Canada n'était pas une confédération — il ne l'est pas davantage aujourd'hui —, mais une fédération.
 |
Le problème de l'appellation du Canada revint au Parlement, quelques années plus tard. En effet, le 13 mars 1878, le député de Lévis, l'écrivain Louis Fréchette (1839-1908), se leva à la Chambre pour proposer la formation d'un comité spécial avec pour mandat la révision de la version française de la Constitution de 1867. Parmi les problèmes posés, il y avait la traduction de "Dominion of Canada" qui avait comme équivalent français «Puissance du Canada». Louis Fréchette ne pouvait accepter que le Canada se définisse comme une «Puissance»; il croyait que l'expression devait être réservée aux pays souverains bénéficiant d'un rôle important sur la scène internationale, une colonie ne pouvant être comptée au rang des «puissances». |
Quoi qu'il en soit, après le Statut de Westminster, qui reconnut officiellement, en 1931, l'indépendance de tous les "dominions" de l'Empire britannique, le gouvernement canadien abandonna le mot "dominion", qui disparut des textes juridiques à partir de 1935, ce qui confirmait a posteriori le jugement négatif de lord John Russel. Aujourd'hui, seul le mot «fédération» est utilisé, le mot «confédération» étant tombé en désuétude.
La promulgation de la Loi constitutionnelle de 1867 (appelée à l'origine et jusqu'en 1982: Acte de l'Amérique du Nord britannique) créa la «Confédération canadienne», qui réunissait l'Ontario (Canada-Ouest ou Haut-Canada), le Québec (Canada-Est ou Bas-Canada), le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Le 1er juillet 1867, le Globe de Toronto saluait ainsi la naissance d'un nouveau Canada, blanc, anglais et protestant (un WASP canadien):
| We salute the birth of a new nation. A united English America four million inhabitants strong takes its place today among the great nations of the world. | [Nous saluons la naissance d'une nouvelle nation. Une Amérique anglaise unie, forte de quatre millions d'habitants, prend place aujourd'hui parmi les grandes nations du monde.] |
|
Pour les anglophones, le nouveau pays de 1867 marquait la fin de la "French Domination in the Canada" («domination française au Canada» et le début d'une nouvelle nationalité britannique. Pour les francophones, c'était le début de leur minorisation définitive.
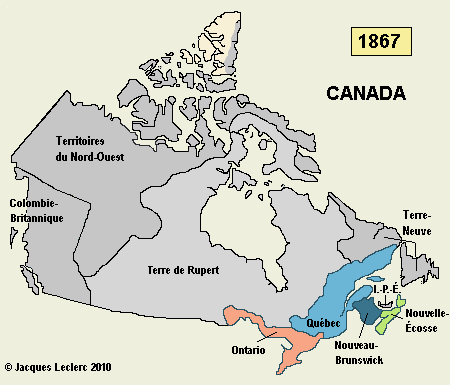 |
Le Canada de 1867 était encore très petit (voir les cartes comparatives de 1867 et 1999), car il ne comprenait qu'une partie de l'Ontario et du Québec actuels, le reste du territoire (Territoires du Nord-Ouest, Colombie-Britannique, Terre-Neuve et l'Île-du-Prince-Édouard) demeurant des colonies britanniques autonomes ne faisant pas encore partie du Canada; quant à la Terre de Rupert, elle appartenait à la Hudson's Bay Company (Compagnie de la Baie d'Hudson) qui gérait aussi les Territoires du Nord-Ouest. Au 1er juillet 1867, le rêve de sir George-Étienne Cartier (1814-1873), le coprésident du Conseil exécutif du Canada-Uni avec John A. Macdonald, devenait réalité. Le Canada avait sa propre constitution, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB), qui deviendra en 1982 la Loi constitutionnelle de 1867. Cependant, seule la version anglaise de cette loi est officielle, la version française n'étant qu'une simple traduction. Juridiquement, le Canada demeurait encore une colonie britannique et il devait le rester jusqu'en 1931 lors de la proclamation du Statut de Westminster (Londres). |
Le journal La Minerve de Montréal (2
juillet 1867), propriété de George-Étienne Cartier, décrivait l'acte de naissance du
Canada en ces termes:
| Canadiens, rallions-nous tous autour du nouveau drapeau. Notre constitution assure la paix et l'harmonie. Tous les droits seront respectés; toutes les races seront traitées sur le même pied; et tous, Canadiens français, Anglais, Écossais, Irlandais, membres unis de la même famille, nous formerons un État puissant, capable de lutter contre les influences indues de voisins forts auxquels nous pourrons dire: «Et ega foederatus recedam a te». La province de Québec n'a pas le droit de mettre obstacle à la marche des événements et d'arrêter le développement d'une grande idée. Si elle fait cela, ce sera son arrêt de mort. |
George-Étienne Cartier se fit toujours le défenseur du Québec au sein de la fédération canadienne, déclarant que la Couronne britannique avait permis aux Canadiens français de conserver leurs institutions, leur langue et leur religion, et que l'avenir résidait dans une forme de gouvernement inspirée du monarchisme britannique. Le 1er juillet 1867, Cartier fit partie du premier gouvernement de John A. Macdonald à titre de ministre de la Milice et de la Défense. Tel qu'il était autorisé à cette époque, il se présenta aussi aux élections provinciales du Québec; il se fit élire et fit partie du gouvernement de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau.
5.4 La minorisation permanente des francophones
La suite de l'Histoire allait démontrer que, loin d'évoquer la paix et l'harmonie, la vie politique et sociale du Canada allait se dérouler dans l'acrimonie et la suspicion contre tout ce qui n'était pas britannique. Dès lors, les Canadiens français se trouvèrent relégués au rang de minorité permanente au sein du Dominion du Canada; même les anglophones du Québec obtinrent un statut privilégié qui les mettait à l'abri de la majorité francophone de la province. Les comtés anglophones du Québec étaient protégés et, pour les abolir, il fallait non seulement le vote de la majorité des députés du Parlement provincial, mais également la majorité des douze députés anglophones. Aucune mesure similaire ne fut adoptée dans les provinces anglaises pour les circonscriptions électorales francophones.
- L'abandon de la dualité linguistique
Au sein du premier gouvernement du Canada, quatre Québécois (dont un anglophone) accédèrent au rang de ministre (sur treize) membres du cabinet de J. A. Macdonald. Exception faite des dispositions de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, la dualité linguistique fut abandonnée dans toutes les institutions fédérales. La capitale cessa de passer alternativement du Canada anglais au Canada français; elle fut établie en permanence à Ottawa, du côté ontarien.
Aucune mesure ne fut prévue pour les minorités francophones des trois provinces anglaises (Ontario, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard). La seule concession significative du dualisme ou au bilinguisme linguistique réside dans une disposition (aujourd'hui l'art. 6) de la Loi sur la Cour suprême et la Cour de l'échiquier (38 Vic., chap. 11, 1875), qui prévoyait que deux (aujourd'hui trois) des six juges (maintenant neuf) de la Cour devaient être choisis parmi les membres des tribunaux du Québec. Quant aux anglophones du Québec, ils purent bénéficier au sein des cabinets de la province d'une présence numérique excédant la part de la population qu'ils représentaient. Durant trois décennies, trois des six membres du cabinet furent des anglophones, surtout dans les ministères à vocation économique; deux anglophones (John Jones Ross, de 1884 à 1887; Edmund James Flynn, de 1896 à 1897) occupèrent même la fonction de premier ministre du Québec. En fait, la dualité linguistique ne subsista qu'au Québec, car elle disparut des institutions fédérales. C'était le prix à payer de la part des francophones du Québec pour obtenir un gouvernement provincial qui leur soit propre.
C'est aussi à partir de la Confédération de 1867 que les habitants anglophones du Canada commencèrent à s'identifier par le mot anglais Canadians, reléguant par le fait même le mot français Canadiens (qui désignait les Canadiens de langue française) en désuétude. De façon systématique, les Canadiens de langue française s'appelèrent Canadiens français (French Canadians) par opposition à Canadiens anglais (English Canadians).
- Les provinces de l'Ouest
Puis la minorisation des francophones s'accentua davantage avec l'entrée
dans la fédération du Manitoba (1870), de la Colombie-Britannique
(1871), de l'Île-du-Prince-Édouard (1873) et, plus tard, de
l'Alberta (1905), de la Saskatchewan (1905) et de Terre-Neuve (1949). Dès lors, les droits et les pouvoirs des Canadiens de langue française
seront toujours soumis à la volonté de la majorité anglaise, qui ne porte pas
toujours dans son cœur la minorité francophone et catholique. Voici ce
qu'écrivit le député conservateur D'Alton McCarthy, grand-maître des Loges
d'Orange du Canada-Ouest (Ontario) en 1888:
| Il s'agit de savoir si c'est la reine ou le pape qui règne sur le Canada. Il s'agit de savoir si ce pays sera anglais ou français. [...] Nous sommes ici en pays britannique et plus nous nous hâterons d'angliciser les Canadiens français, de leur enseigner à parler l'anglais, moins nous aurons d'ennuis à surmonter dans l'avenir. C'est maintenant que le scrutin doit apporter une solution à ce grave problème; s'il n'apporte pas le remède en cette génération, la génération suivante devra avoir recours à la baïonnette. |
Pour les anglophones, contrairement à l'Église catholique, la question linguistique primait sur la religion.
5.5 La paranoïa anti-francophone
Comme on a
pou le constater, certains
anglophones n'y allèrent pas de main morte. Au besoin, il leur paraissait nécessaire d'utiliser la force et les armes contre les Canadiens français.
Cette époque
instable fut marquée au Canada anglais par une sorte de
paranoïa anti-francophone, alors que les Canadiens français, pour leur part, craignaient pour leur
survie dans la nouvelle Union de 1867 où ils étaient devenus définitivement minoritaires.
 |
Honoré Mercier
(1840-1894), premier ministre du Québec de 1887
à 1891, un libéral nationaliste, avait prononcé un discours, le 4 avril 1893, à Montréal,
dans lequel il avait déclaré:
|
Dans le même discours, Honoré Mercier alla même jusqu'à proposer l'indépendance du Québec en ces termes:
| Vous avez la dépendance coloniale, je vous offre la fortune et la prospérité; vous n'êtes qu'une colonie ignorée du monde entier, je vous offre de devenir un grand peuple, respecté et reconnu parmi les nations du monde. |
La déclaration publique de Mercier fut considérée comme «subversive»
de la part d'un ancien premier ministre d'une province du Canada; cette
déclaration n'allait pas rester
sans lendemain. Les anglophones influents comprirent qu'il fallait au plus vite
museler financièrement tous les prochains premiers ministres du Québec et
s'organiser pour que dorénavant les finances publiques demeurent sous le
contrôle des milieux financiers anglo-montréalais. Dès lors et jusqu'en
1960, tous les ministres des Finances du Québec furent des anglophones qui
imposèrent sans difficulté l'anglais comme langue de travail dans leur
ministère.
 |
En 1885,
le Métis francophone Louis Riel (1844-1885) du Manitoba fut
condamné à la pendaison pour trahison à la suite de sa rébellion contre le
pouvoir fédéral. Les Canadiens français du Québec virent dans cette condamnation l'expression de la
haine des Canadiens anglais pour tous les catholiques de langue française. En
autorisant l'exécution de Louis Riel à Regina (Saskatchewan), le gouvernement de
John A. Macdonald confirmait que, dans la Confédération, les Canadiens français
ne pouvaient compter sur les autorités fédérales pour défendre leurs intérêts.
En cas de conflit entre les deux grandes communautés linguistiques, la majorité
anglaise canadienne favoriserait forcément les anglophones.
À partir de ce moment, les Canadiens français furent convaincus que seul le gouvernement du Québec pouvait défendre la cause des francophones. |
Honoré Mercier avait pris fait et cause pour Louis Riel au Manitoba; il avait aussi défendu les Acadiens du Nouveau-Brunswick dans leurs luttes pour des écoles françaises et se rendit en Nouvelle-Angleterre pour encourager les Franco-Américains. Il fut également soupçonné de vouloir créer une «république canadienne indépendante» qui pourrait s'annexer aux États-Unis. Honoré Mercier désirait enfin former une «grande alliance francophone», avec un siège central à Paris, qui aurait pour mandat de défendre les francophones du monde entier. C'était la Francophonie d'aujourd'hui avant la lettre!
Se percevant comme «francophone non anglophobe» tout en avouant que «l'Angleterre [le] laisse assez indifférent, presque froid», Mercier croyait que l'Angleterre avait fait« plus de mal que de bien aux Canadiens français», que nous ne lui «devons rien» et que «nous pourrons, au besoin, nous séparer d'elle». Voici un extrait d'un discours («L'avenir du Canada») prononcé au parc Sohmer le 4 avril 1893:
[...] Je suis français par mon origine, par mon éducation et par mes sentiments, mais je ne suis pas un anglophobe. J'admire les Anglais et j'aime les Anglaises, je dois l'avouer, pas tout à fait autant cependant que les Canadiennes et les Françaises et peut-être moins, aussi, que les Américaines ; mais l'Angleterre me laisse assez indifférent, presque froid. J'admets qu'elle nous a fait du bien; mais je crois qu'elle nous a fait plus de mal que de bien et que si nous avons prospéré, nous surtout, les Canadiens-français, ce n'est pas de sa faute. Nous avons contribué pour beaucoup à la fortune de ses marchands et de ses manufacturiers, comme nous avons toujours payé généreusement les gouverneurs qu'elle nous a envoyés. Si quelques-uns de ceux-ci nous ont insultés et ont dit que nous étions d'une race inférieure, nous ne leur avons jamais jeté des œufs pourris, comme les torys anglais l'ont fait à lord Elgin, quand il eut, en gouverneur constitutionnel et suivant l'avis de ses ministres, sanctionné le bill d'indemnité de 1849. Ce sont ces mêmes Anglais qui ont brûlé le parlement parce que la majorité des députés avait adopté cette loi. Les Canadiens français, plus dignes et moins portés aux mesures de violence, ne songent pas à brûler le parlement fédéral, dont la majorité refuse de rendre justice aux catholiques du Manitoba, comme ils n'ont pas songé, dans les mauvais jours de notre histoire, à jeter des œufs pourris aux gouverneurs anglais qui envoyèrent en exil ou à l'échafaud les nobles patriotes de 1837. Ainsi, tous comptes tirés, nous ne devons rien à l'Angleterre, et nous pourrons, au besoin, nous séparer d'elle, quand la majorité, régulièrement consultée, le voudra, sans remords de conscience, sans déchirements de cœur et même sans verser de larmes.
[...] Sous prétexte de mettre fin à cette agitation, on nous a imposé la confédération, avec promesse que ce régime mettrait à l'abri de toute atteinte préjudiciable notre langue, notre religion et toutes les institutions qui font de nous une nationalité distincte, enfin, qu'il nous assurait comme province une autonomie complète.
Cette promesse n'était qu'une tromperie. Qui niera que, depuis 1867, surtout depuis quelques années, la lutte n'ait été aussi nécessaire, aussi vive qu'avant pour conserver notre autonomie, objet d'empiétements continuels de la part du pouvoir fédéral.
Et il en sera ainsi tant que nous serons colonie anglaise, tant que le gouvernement du pays sera entre les mains d'hommes publics anglais, s'efforçant de donner suite à la politique tracée dans le fameux rapport de lord Durham — politique dont le point capital est de noyer, d'anéantir la race française. [...]
Les Canadiens devaient leur «loyauté au Canada d'abord et non à des pays étrangers» et ce n'était pas une «déloyauté» pour Mercier que de parler de briser le «lien colonial». Mais ce premier ministre nationaliste parut vraiment trop radical et trop en avance sur son époque; il s'attira de nombreux ennemis dans les milieux anglophones.
Honoré Mercier finit par être démis de ses fonctions de premier ministre en 1891 par le lieutenant-gouverneur Auguste-Réal Angers, un conservateur nommé par Ottawa, puis traîné devant les tribunaux sous des accusations de fraudes criminelles. Il fut finalement acquitté, faute de preuves, mais il en sortit complètement ruiné et malade. Il mourut à Montréal le 30 octobre 1894.
Le 25 juin 1912, un somptueux monument fut érigé à la mémoire de l'ancien premier ministre devant le parlement de Québec. Les Québécois honorèrent sa mémoire jusqu'à l'aube des années 1960, puis Mercier tomba dans l'oubli. Peu de Québécois sauraient aujourd'hui qui était Honoré Mercier. Autour de l'édifice du parlement, on trouve aussi les monuments des anciens premiers ministres Adélard Godbout (1936, 1939-1944), Maurice Duplessis (1944-1959), Jean Lesage (1961-1966), René Lévesque (1976-1985) et Robert Bourassa (1970-1976, 1985-1994).
5.6 L'inégalité juridique des langues au Canada
Dès le début de la Confédération, les Canadiens français durent se rendre compte que leur langue n'avait pas le même statut que l'anglais. Dans le but de rallier la députation francophone divisée sur l'adhésion à la fédération, l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 proclamait un «embryon» de bilinguisme officiel à l'égard du Parlement du Canada et des tribunaux fédéraux. En principe, l'article 133 accordait à l'anglais et au français des droits et des privilèges égaux dans ces deux secteurs où l'État se manifestait plus particulièrement: la législature et la justice.
- L'unilinguisme anglais et l'assimilation forcée
Pendant près d'un siècle, l'égalité des langues proclamée dans la Constitution de 1867 n'a jamais existé qu'en théorie et le gouvernement fédéral s'en est toujours tenu au minimum des prescriptions constitutionnelles. En effet, le français demeura la langue de la traduction, tandis que les députés francophones qui voulaient se faire comprendre durent recourir à l'anglais; il était rare en effet que ces députés prennent la parole à français, car en l'absence de la traduction simultanée, il fallait accepter de ne pas être compris. Autrement dit, les députés francophones avaient le droit d'utiliser leur langue, mais pas celui d'être compris.
Les anglophones conservèrent les portefeuilles économiques importants du cabinet fédéral ainsi que la vaste majorité des postes de commande au sein de la fonction publique; l'adoption des timbres-postes bilingues (1927), des billets de banque bilingues (1936) et des chèques fédéraux bilingues (1962) ne s'effectuèrent respectivement que 60 ans, 69 ans et 95 ans après la Confédération. En somme, la proclamation de l'égalité n'a pas empêché l'unilinguisme anglais dans la pratique. Les Canadiens français percevront le gouvernement fédéral comme la manifestation d'un pouvoir politique anglais peu ouvert à leurs aspirations et à leurs attentes.
Cette attitude sera confirmée lorsque les gouvernements des provinces anglaises, telles que le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et l'Ontario, adopteront des lois anti-françaises. En effet, en 1871, le Nouveau-Brunswick interdit le français dans la province; le Manitoba fit de même en 1890 avec la Official Language Act (Loi sur la langue officielle) et l'Ontario avec le Règlement 17 en 1912 (modifié en 1927, puis tombé en désuétude en 1944). Ces mesures législatives consternèrent tous les Canadiens français du pays, y compris ceux du Québec.
- Le messianisme anglophone
La question de la langue devenait de plus en plus importante au Canada, tant dans les provinces anglaises qu'au Québec. Non seulement cette question touchait les minorités francophones de l'Ontario, du Manitoba ou du Nouveau-Brunswick, mais également les minorités religieuses comme les Irlandais, une importante communauté concentrée notamment à Toronto. La volonté d'assimiler les Canadiens français venait aussi du haut clergé anglophone. Ainsi, Mgr John Joseph Lynch (1816-1888), évêque catholique du diocèse de Toronto, lui-même irlandais d'origine, considérait que l'Irlande constituait un cas relevant d'une mission de la Providence, tant linguistique que religieuse. Voici comment il résumait les desseins de la Providence pour la langue anglaise:
L'Irlande fut soumise [...] afin d'incorporer plus efficacement ses habitants à la nation anglaise [...]. Ceux-ci résistèrent, mais on les contraignit par la force à apprendre l'anglais. Ce sont là les desseins de Dieu. Fouettés à l'école par ce qu'ils ne savaient pas leur leçon d'anglais, les enfants irlandais ne soupçonnaient pas que Dieu destinait la langue anglaise à répandre par leur bouche la parole de son divin Fils dans le vaste monde.
L'archevêque de Toronto (1860-1888) défendait les écoles séparées en Ontario pour des raisons religieuses, non pas linguistiques. Il croyait que les Irlandais étaient un peuple choisi destiné à préserver et à répandre la vraie foi partout dans le monde. Contre toute attente, Mgr Lynch préconisait l'autonomie politique de son pays d'origine en soutenant qu'en Amérique du Nord les Irlandais s'étaient montrés des citoyens particulièrement responsables.
Jules-Paul Tardivel (1851-1905), journaliste au Canadien et romancier ultramontain, fut l'un des plus fervents solidaires des Canadiens français hors Québec. Le 2 novembre 1889, il écrivit dans le journal La Vérité :
La confédération ne protégeant pas les droits des minorités, du moment que ces minorités sont françaises et catholiques, où est donc sa raison d'être, au point de vue de nos intérêts, à nous, Canadiens français et catholiques? Elle peut faire l'affaire des sectaires qui veulent l'anglicisation, l'apostasie religieuse et nationale des Canadiens français; mais elle ne saurait faire la nôtre... Nos ennemis ne s'arrêteront que lorsqu'ils auront foulé aux pieds le dernier droit de la race française en Amérique... Déjà on parle d'abolir la langue française comme langue officielle à Ottawa et même à Québec [...]. Que n'osera-t-on entreprendre lorsque nous ne serons plus qu'un cinquième ou un sixième [de la population] ?
- La séparation du Québec ?
Pour Jules-Paul Tardivel, la perte des droits scolaires et linguistiques des Franco-Manitobains en 1890 implique le choix suivant: «Exiger le respect de nos droits dans la confédération ou sortir de la confédération. » Dans La Vérité du 18 mars 1893, Tardivel écrit ces propos sur la destinée des Canadiens français:
Quand et comment le peuple canadien-français prendra-t-il le rang qui lui est ardemment destiné parmi les nations autonomes de la terre? C'est le secret de Dieu. Mais cette heure sonnera sûrement, tôt ou tard, si nous restons fidèles à la mission providentielle qui nous a été confiée [...]. Cette heure providentielle sonnera, soyez-en assurés ; car il est impossible que Dieu n'ait pas voulu faire une véritable nation de ce peuple canadien-français dont il a si visiblement protégé la naissance et la jeunesse [...]. Laissons faire les événements. La dissolution [...] du lien interprovincial viendra à l'heure et de la manière marquées par la divine Providence.
Comme on peut le constater, Jules-Paul Tardivel fondait son nationalisme sur le respect de la religion catholique et de la langue française tout en l'accolant à un «providentialisme», c'est-à-dire à l'idée d'une Providence interventionniste et agissante, à l'exemple de Mgr Lynch avec les Irlandais.
Observant les usages dans l'emploi des langues à Ottawa, Tardivel fut l'un des premiers à dénoncer l'absence de la langue française dans les ministères fédéraux et dans les compagnies de chemin de fer et de télégraphe. Mais le nationalisme de Tardivel allait plus loin, car il n'hésitait pas à exposer la nécessité d'une option politique osée pour l'époque : le choix d'une séparation du Québec du Canada.
Jules-Paul Tardivel fut même le premier Canadien français à recourir aux caractères distinctifs d'un peuple pour proposer de doter celui-ci d'un État. Dans son esprit, il s'agirait d'une république catholique et française, qui garantirait les droits des protestants et des anglophones, et scellerait l'union de l'Église et de l'État. En 1895, Jules-Paul Tardivel développa sa vision ultramontaine de l'État canadien-français dans un roman d'anticipation intitulé Pour la patrie :
Pour nous, Canadiens français, il s'agit de notre avenir national. Tout ce que nous avons de plus cher et de plus sacré est en jeu : notre religion, notre langue, nos institutions, nos lois, notre autonomie.
Existerons-nous comme peuple demain ? Voilà le problème redoutable qui se dresse devant nous.
La question politique étant posée dès 1895, d'autres nationalistes allaient développer leurs convictions dans cette voie.
5.7 Les limites territoriales du français au Canada
Les Canadiens français du Québec durent se rendre compte que leur langue, qu'ils croyaient «pan-canadienne», était limitée aux frontières de leur seule province. C'est ce qu'écrira le jésuite Richard Arès dans Notre question nationale en 1945:
Nous n'en sommes pas encore à croire que le Québec constitue à lui seul le Canada français ou que l'on puisse parler et écrire comme si, de fait, il y avait exacte équivalence entre Franco-Québécois et Canadiens français. [...] Si la province de Québec n'est pas tout le canada français, elle en a été et elle demeure la cellule-mère, le pôle dynamique et le centre vital. [...] Le Québec a charge d'âmes et Québec n'est pas une simple capitale de province, c'est la capitale du Canada français, c'est la capitale de l'Amérique française.
 |
L'abbé Lionel Groulx
(1878-1967),
historien et fondateur de l'Association de la jeunesse canadienne-française et
de la revue L'Action française, puis de L'Action nationale,
constatera
aussi en 1952 (Histoire du Canada français, vol IV) que «depuis
longtemps et surtout depuis la Confédération, le Canada français ne se
confond plus avec le Québec». Il ajoute: «Il a cessé d'être une entité
géographique pour devenir une entité nationale, culturelle, répartie à
travers tout le Canada.»
Par ailleurs, les Canadiens français durent finalement constater que leur gouvernement provincial n'était pas très combatif lorsque venait le temps de défendre leur langue. La thèse du «pacte des deux peuples fondateurs» a été reprise par l'abbé Lionel Groulx et invoquée par plusieurs autres (et même en 1967 dans le Rapport Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le multiculturalisme). |
En réalité, ce fut une période qui marqua le recul constant de la situation du français dans des secteurs importants de la vie politique, sociale et économique. Enfin, l'attitude du gouvernement fédéral lors de le Première Guerre mondiale et son armée unilingue anglaise convainquirent encore les francophones que ce gouvernement souhaitait leur assimilation.
La plus grande partie de cette période (1867-1940) fut marquée par la toute-puissance de l'Église catholique chez les Canadiens français. Dans leur Brève histoire du Québec, les historiens Jean Hamelin et Jean Provencher reconnaissaient que l'Église catholique était «l'instance suprême» au Québec :
L'Église est l'instance suprême qui légitime les idéologies, le lieu où la nation se définit, la police qui freine la transformation des mœurs engendrée par l'industrialisation. Elle a un projet de société centré sur un Canada biculturel, un Québec transformé en une chrétienté hiérarchisée suivant l'ordre naturel des choses, où un peuple composé d'une majorité d'agriculteurs s'épanouirait dans la ligne de son destin catholique et français.
Cette mainmise de l'Église s'explique par le fait qu'il n'existait aucune institution laïque disposant d'un pouvoir comparable auprès de la population. L'Église a simplement repris le relais des Français après la chute de la Nouvelle-France, qui avait dû laisser les pouvoirs politiques et économique aux mains des Britanniques.
6.1 Le révisionnisme de l'Histoire canadienne
François-Xavier Garneau (1809-1866) fut le
premier historien du Canada français. Appartenant à la génération des
réformistes, il s'initia très tôt aux grandes œuvres de la littérature mondiale
et à la discipline de l'Histoire. Non seulement il lut tout ce qu'il trouva à la
Bibliothèque du Parlement, mais il fit aussi un séjour de deux ans en Europe, de
1831 à 1833, et joua un rôle politique de premier plan au cours des années qui
précédèrent les troubles de 1837-1838.
 |
En 1845, François-Xavier Garneau publia le premier volume (qui devait en compter cinq) de son Histoire du Canada (totalisant 1600 pages), ce qui fera de lui le plus grand historien de sa génération. Ce volume décrivait les événements de la Nouvelle-France depuis les origines jusqu'en 1701; son ouvrage immense allait s'étendre jusqu'en 1840. Dès le premier ouvrage, des auteurs souvent anonymes, généralement des ecclésiastiques, reprochèrent à l'historien sa défense de la liberté de conscience, ses regrets du fait que les autorités françaises aient exclu les huguenots du Canada et ses critiques de l'autoritarisme de Mgr de Montmorency-Laval. On accusa Garneau de «philosophe», de «protestant» et d'«impie», des accusations graves à cette époque. Le clergé catholique lui reprocha ne de pas faire ressortir suffisamment le caractère religieux de la colonisation française en Amérique. |
En 1859, l'historien dut subir la censure du clergé et couper des paragraphes entiers, puis récrire certaines pages de son Histoire du Canada. Devant l'inquiétude du clergé catholique, François-Xavier Garneau adopta des vues nationalistes plus conservatrices sur les questions religieuses. Finalement, dans sa conclusion générale du troisième volume, Garneau invitait les Canadiens français à rester fidèles à eux-mêmes, donc à se garder des aventures politiques et sociales.
C'était là pour la toute-puissante Église catholique une façon de s'approprier le nationalisme et de diriger le patriotisme canadien-français. Pendant deux siècles, le destin des Canadiens français allait être incarné dans l'idéologie dominante: la trilogie religion + langue + agriculture.
6.2 La vocation messianique des Canadiens français
Cette idéologie propagée par l'Église catholique faisait appel à la mission divine spirituelle d'un peuple d'agriculteurs voué à propager la foi catholique et la langue française en Amérique du Nord. Le grand promoteur de la vocation providentielle de «la race française» en Amérique demeure l'abbé Henri-Raymond Casgrain (1831-1904). Inspiré par l'historien français François-Edme Rameau de Saint-Père (1820-1899), Casgrain écrivait en 1896:
Quelle action la Providence nous réserve-t-elle en Amérique? Quel rôle nous appelle-t-elle à y exercer? Représentant de la race latine, en face de l'élément anglo-saxon, dont l'expansion excessive, l'influence anormale doivent être balancées, de même qu'en Europe, pour le progrès de la civilisation, notre mission et celle des sociétés de même origine que nous, éparses sur ce continent, est d'y mettre un contrepoids en réunissant nos forces, d'opposer au positivisme anglo-américain, à ses instincts matérialistes, à son égoïsme grossier, les tendances plus élevées, qui sont l'apanage des races latines, une supériorité incontestée dans l'ordre moral et dans le domaine de la pensée.
Convaincu de la «supériorité» civilisatrice de la France, répétée par le commandant Paul-Henry de Belvèze (La Capricieuse), l'historien Rameau de Saint-Père (1820-1899) ainsi que plusieurs autres, l'abbé Casgrain n'hésitait pas à prophétiser la «supériorité morale» du Canada français en Amérique. Le problème, c'est que ces beaux discours sur la supériorité de la «race française» au Canada ne paraissaient guère conforme avec la réalité: entre 1870 et 1880, plus de 120 000 Canadiens français avaient émigré aux États-Unis; entre 1880 et 1890, 150 000; entre 1890 et 1900, 140 000. C'étaient, bien sûr, des motifs économiques et non religieux, qui ont poussé ces francophones vers les contrées anglophones.
Ce projet de société à perspective messianique fut bien tracé par Mgr Louis-Adolphe Paquet (1859-1942), directeur du Grand Séminaire de Québec, dans un sermon prononcé le 23 juin 1902 et intitulé «La vocation de la race française en Amérique» :
Du reste, la vie propre ne va guère sans la langue ; et l'idiome béni que parlaient nos pères, qui nous a transmis leur foi, leurs exemples, leurs vertus, leurs luttes, leurs espérances, touche de si près à notre mission qu'on ne saurait l'en séparer. La langue d'un peuple est toujours un bien sacré ; mais quand cette langue s'appelle la langue française, quand elle a l'honneur de porter comme dans un écrin le trésor de la pensée humaine enrichi de toutes les traditions des grands siècles catholiques, la mutiler serait un crime, la mépriser, la négliger même, une apostasie. C'est par cet idiome en quelque sorte si chrétien, c'est par cet instrument si bien fait pour répandre dans tous les esprits les clartés du vrai et les splendeurs du beau, pour mettre en lumière tout ce qui ennoblit, tout ce qui éclaire, tout ce qui orne et perfectionne l'humanité, que nous pourrons jouer un rôle de plus en plus utile à l'Église, de plus en plus honorable pour nous-mêmes. [...] Notre mission est moins de manier des capitaux que de remuer des idées; elle consiste moins à allumer le feu des usines qu'à entretenir et à faire rayonner au loin le foyer lumineux de la religion et de la pensée. Pendant que vos rivaux revendiquent, sans doute dans des luttes courtoises, l'hégémonie de l'industrie et de la finance, nous ambitionnons avant tout l'honneur de la doctrine et les palmes de l'apostolat.
À défaut de contrôler l'économie et la politique, les Canadiens français devaient avoir le monopole de la vertu. Grâce à la religion catholique, ils pouvaient revendiquer «l'honneur de la doctrine et les palmes de l'apostolat». Évidemment, cette idéologie servait à compenser pour les méfaits causés par la Conquête anglaise et l'émigration vers les États-Unis, car beaucoup de gens croupissaient dans la misère.
On ne pouvait être plus clair : aux Anglais revenaient l'économie et la richesse matérielle; aux Canadiens français, la possession de la vie céleste. Ainsi, dans cette perspective, la langue française était considérée comme une protection contre l'hérésie protestante liée à l'anglais.
6.3 Le Congrès eucharistique de 1910 et le débat linguistique
En 1910 s'est déroulé à Montréal un important congrès eucharistique organisé par l'archevêque de Montréal, Mgr Paul Bruchési, et présidé par le légat du pape, le cardinal Vincenzo Vannutelli. Ce congrès international réunissait 3 cardinaux, 18 archevêques, 86 évêques et des centaines de prêtres et de religieux représentant des prélats catholiques de tous les continents. Étaient également présentes des personnalités politiques du pays, dont Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada (1896-1911), et Lomer Gouin, premier ministre du Québec (1905-1920).
C'était le premier événement du genre à se tenir en Amérique du Nord. Le pape Léon XIII avait créé ces «congrès eucharistiques» dans le but de combattre la laïcisation grandissante qui menaçait l'Église catholique et de permettre aux fidèles de se réunir afin d'exprimer leur foi. Cet événement qui ne devait être que religieux fut assombri par un débat linguistique.
- Le plaidoyer pour l'anglais
|
|
En effet, l'un des plus prestigieux
invités, l'archevêque catholique de Westminster (Londres),
Mgr
Francis Alphonsus Bourne (1861-1935), entreprit lors de la séance
de clôture à l'église Notre-Dame de Montréal, de faire un plaidoyer en faveur de la langue anglaise. À la stupeur générale,
l'archevêque anglais affirma que l'anglais devait être le seul véhicule de
la foi catholique à l'extérieur de la province de Québec. Il invita les
catholiques de langue française qui s'installaient dans l'Ouest
à apprendre l'anglais, comme le faisaient les immigrants. Depuis
plusieurs années, l'évêque Bourne aurait grandement tenté de
rendre l'anglais langue officielle du culte catholique dans les
anciennes colonies de l'Empire britannique.
Voici les passages les plus percutants de son discours prononcé en anglais — ici en traduction —, le 10 septembre 1910, sur cette question controversée, ce qui lui vaudra au Québec une belle réplique de la part de nul autre qu'Henri Bourassa : |
Aujourd'hui, les circonstances sont considérablement changées. Très lentement d'abord, et maintenant avec une rapidité incalculable, une autre langue est en voie de prendre une importance supérieure dans les choses ordinaires de la vie. Il serait, en vérité, extrêmement regrettable que la langue française, qui fut si longtemps l'expression unique de la religion, de la civilisation et du progrès de ce pays, perdît jamais une partie de la considération et de la culture dont elle jouit au Canada. Mais personne ne peut fermer les yeux sur ce fait que, dans les nombreuses villes dont l'importance augmente constamment dans toutes les provinces de l'ouest du Dominion, la plupart des habitants emploient l'anglais comme leur langue maternelle, et que les enfants des colons qui viennent de pays où l'anglais n'est pas parlé, parleront aussi la langue anglaise, à leur tour. Et cette réflexion nous amène à la racine même du problème et en démontre toute la complexité. Car, hélas ! tandis que la langue française était autrefois synonyme d'unité dans la croyance religieuse, la langue anglaise a été, pendant plus de trois cents ans, l'organe de la discorde, de la désunion et de la dissension, chaque fois qu'il s'agissait des vérités chrétiennes. Et cependant si la puissante nation que le Canada deviendra doit être gagnée et gardée à l'Église catholique, cela ne s'accomplira qu'en faisant connaître à une grande partie du peuple canadien, dans les générations qui vont suivre, les mystères de notre foi par l'intermédiaire de notre langue anglaise. En d'autres termes, l'avenir de l'Église en ce pays, et la répercussion qui en résultera dans les vieux pays de l'Europe, dépendront, à un degré considérable, de l'étendue qu'auront définitivement la puissance, l'influence et le prestige de la langue et de la littérature anglaises en faveur de l'Église catholique. [...]
Et, s'il m'est permis, j'aimerais à proposer que tous s'unissent dans la prière pour que l'influence de la langue anglaise puisse enfin, malgré tout le mal qu'elle a fait dans le passé touchant les questions religieuses, être amenée par Dieu à devenir une force puissante pour le soutien et l'extension de l'unité et de la vérité religieuses. [...]
Qu'on me permette de résumer ma pensée. Dieu a permis que langue anglaise se répandît dans tout le monde civilisé et elle acquis une influence qui grandit toujours. Tant que la langue anglaise, les façons de penser anglaises, la littérature anglaise, en un mot la mentalité anglaise tout entière, n'aura pas été amenée à servir l'Église catholique, l'œuvre rédemptrice de l'Église sera empêchée et retardée. Toutes les nations de langue anglaise peuvent aider à cette grande tâche : l'Angleterre, l'Irlande; l'Écosse, les puissants États-Unis d'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et les Indes britanniques. Mais le Dominion du Canada, à cause de ses traditions catholiques si anciennes et si profondément enracinées, à cause des perspectives magnifiques de progrès qui s'ouvrent devant lui, peut aujourd'hui, plus que tous les autres, rendre un grand service en ce sens. Et en accomplissant sa part de travail, l'Église catholique du Canada non seulement contribuera à faire avancer sa cause sacrée, mais, en même temps, elle donnera un courage plus grand aux catholiques de langue anglaise dans le monde entier, et deviendra une source de force toujours croissante et inlassable pour l'Église universelle. Il y a là une occasion qui ne se présentera peut-être jamais plus. Au point de vue humain, si on laisse échapper cette occasion, la perte sera incommensurable et irréparable. [...]
En somme, l'archevêque britannique souhaitait angliciser le clergé et le peuple canadien-français. La province de Québec comptait alors deux millions d'habitants, la plupart vivant d'agriculture, mais ces Canadiens français faisaient ainsi l'expérience de l'humiliation nationale de la part d'un archevêque catholique venu de l'Angleterre.
Ayant constaté son impaire diplomatique, Mgr Bourne tenta bien ensuite d'expliquer le sens de ses propos. Connaissant la langue française pour avoir étudié à Paris et à Bruxelles, il n'avait rien contre le français, mais il croyait que l'anglais allait dominer le monde et que l'Église catholique devait en tenir compte. En somme, Mgr Bourne affirmait à voix haute ce que plusieurs savaient déjà: l'Église catholique de Rome, en tant qu'institution, ne voulait pas défendre la langue française, mais plutôt assurer en Amérique du Nord la diffusion de la religion catholique dans la langue de la majorité anglophone. L'anglais devait donc devenir la langue de l'Évangile. D'ailleurs, loin de le désavouer, le pape Pie X fera de Mgr Bourne un cardinal, l'année suivante.
- La réplique de
Henri Bourassa
 |
Il n'en fallait pas
davantage pour que, à la suite du discours de Mgr
Bourne, le journaliste Henri Bourassa
(1868-1952), fondateur du Devoir en 1910, improvise son
propre discours pour faire la démonstration, sous des tonnerres
d'applaudissements, que la religion catholique avait progressé en
français au Canada et que, pour le peuple canadien-français, la foi
et la langue étaient indissociables. C'était le principe «la foi
gardienne de la langue, la langue gardienne de la foi.» Henri
Bourassa avait été élu député fédéral en 1896 (Parti libéral); il
avait démissionné en 1907 pour ensuite être élu député à l'Assemblée
législative du Québec, sous la bannière de la Ligue nationaliste
canadienne.
La réponse de Henri Bourassa, le plus grand orateur de son temps, allait marquer le Québec pour des décennies. Voici quelques extraits pertinents faits à partir d'une transcription du Le Devoir : |
Sa Grandeur [Mgr Bourne] a parlé de la question de langue. Elle nous a peint l'Amérique tout entière comme vouée dans l'avenir à l'usage de la langue anglaise; et au nom des intérêts catholiques elle nous a demandé de faire de cette langue l'idiome habituel dans lequel l'Évangile serait annoncé et prêché au peuple.
Ce problème épineux rend quelque peu difficiles, sur certains points du territoire canadien, les relations entre catholiques de langue anglaise et catholiques de langue française. [...]
À ceux d'entre vous qui disent: «l'Irlandais a abandonné sa langue, c'est un renégat national: et il veut s'en venger en nous enlevant la nôtre», je réponds: «Non. Si nous avions passé par les épreuves que l'Irlandais a subies, il y a longtemps peut-être que nous aurions perdu notre langue.»
Quoi qu'il en soit, la langue anglaise est devenue l'idiome de l'Irlandais comme celui de l'Écossais. Laissons à l'un et à l'autre, comme à l'Allemand et au Ruthène, comme aux catholiques de toutes les nations qui abordent sur cette terre hospitalière du Canada, le droit de prier Dieu dans la langue qui est en même temps celle de leur race, de leur pays, la langue bénie du père et de la mère. [...]
Soyez sans crainte, vénérable évêque de Westminster: sur cette terre canadienne, et particulièrement sur cette terre française de Québec, nos pasteurs, comme ils l'ont toujours fait, prodigueront aux fils exilés de votre noble patrie comme à ceux de l'héroïque Irlande, tous les secours de la religion dans la langue de leurs pères, soyez-en certain (applaudissements).
Je ne veux pas, par un nationalisme étroit, dire ce qui serait le contraire de ma pensée — et ne dites pas, mes compatriotes — que l'Église catholique doit être française au Canada. Non, mais dites avec moi que, chez trois millions de catholiques, descendants des premiers apôtres de la chrétienté en Amérique, la meilleure sauvegarde de la foi, c'est la conservation de l'idiome dans lequel, pendant trois cents ans, ils ont adoré le Christ (acclamations).
Oui, quand le Christ était attaqué par les Iroquois, quand le Christ était renié par les Anglais quand le Christ était combattu par tout le monde, nous l'avons confessé et nous l'avons confessé dans notre langue (longues acclamations). Le sort de trois millions de catholiques, j'en suis certain, ne peut être indifférent au cœur de Pie X, pas plus qu'à celui de l'éminent cardinal qui le représente ici.
Mais il y a plus encore. Non pas parce que nous sommes supérieurs à personne, mais parce que, dans ses décrets insondables qu'il n'appartient à personne de juger, la Providence a voulu que le groupe principal de cette colonisation française et catholique constituât en Amérique un coin de terre à part où l'état social, religieux et politique se rapproche le plus de ce que l'Église catholique, apostolique et romaine nous apprend être l'état le plus désirable des sociétés (applaudissements). [...]Mais, dira-t-on, vous n'êtes qu'une poignée; vous êtes fatalement destinés à disparaître; pourquoi vous obstiner dans la lutte? Nous ne sommes qu'une poignée, c'est vrai; mais ce n'est pas à l'école du Christ que j'ai appris à compter le droit et les forces morales d'après le nombre et par les richesses. Nous ne sommes qu'une poignée, c'est vrai; mais nous comptons pour ce que nous sommes, et nous avons le droit de vivre. [...]
Le discours prononcé par Henri Bourassa à la clôture du Congrès eucharistique, le 10 septembre 1910, fit sensation le soir même ainsi que dans les jours qui suivirent. Ce discours sera publié dans Le Devoir du 15 septembre. Pendant des décennies, l'idéologie dominante au Québec a fait de la langue «la gardienne de la foi». Par la suite seront fondés la Société du parler français, l'Ordre de Jacques-Cartier, les Jeunesses catholiques, l'Action nationale, etc.
Il faut dire aussi qu'en 1910 la situation des Canadiens français paraissait catastrophique, car la province venait de vivre une pénible saignée démographique: deux millions d'ex-Québécois s'étaient établis en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, au Michigan, au Massachusetts et au Rhode Island. Et partout l'assimilation battait son plein. Henri Bourassa le savait très bien, lui qui dénonçait les politiques antifrançaises des provinces canadiennes. Henri Bourassa savait que les Canadiens français, dispersés entre cinq provinces et deux pays, n'étaient protégés par aucun gouvernement, ni celui du Canada inféodé à l'Empire britannique, ni celui du Québec alors entièrement contrôlé par les multinationales américaines; il savait aussi qu'il n'existait pas de loi, pas de ministère et encore moins de financement public pour assurer la survie et la vitalité du français au Canada. Pour Bourassa, seule l'Église catholique pouvait encore remédier à la situation, mais un archevêque anglais venait affirmer haut et fort, à la face du monde, que l'anglais devait remplacer le français en Amérique du Nord.
L'Église catholique de l'époque n'avait sûrement pas prévu que, un siècle plus tard, les Canadiens français seraient devenus des Québécois, qu'ils auraient conservé leur langue, mais perdu leur foi et que ce sont les Latinos hispano-américains, et non pas les Irlandais anglophones, qui auraient assuré la prépondérance de la religion catholique aux États-Unis.
Henri Bourassa rêvait aussi d'un pays bilingue fondé sur ses deux peuples fondateurs, l'anglais et le français, un pays dans lequel ces deux groupes posséderaient des droits et des statuts égaux, un pays débarrassé de l'impérialisme britannique.
La base de la Confédération, c'est la dualité des races, la dualité des langues, garantie par l'égalité des droits. Ce pacte devrait mettre fin au conflit des races et des Églises et assurer à tous, catholiques et protestants, Français et Anglais, une parfaite égalité des droits dans toute l'étendue de la Confédération canadienne.
Henri Bourassa n'était pas le seul à croire que le Canada était un «pacte entre deux nations» ou deux «peuples fondateurs», mais la réalité rappellera que seuls les francophones maintiendront cette idéologie.
6.4 La langue gardienne de la foi
Pour sa part, l'abbé Lionel Groulx, directeur de la revue L'Action nationale en 1920, développa largement cette pensée: le «bouclier de la langue» permet de résister à la puissance envahissante du protestantisme anglo-américain. Dans un article daté de 1936, intitulé «La langue gardienne de la foi», et reprenant ce même thème développé par Henri Bourassa, Mgr Paul-Émile Gosselin, du Conseil de la survivance française, associait ainsi la survivance linguistique à la survivance religieuse:
La langue française est chez nous gardienne de la foi en cet autre sens — plutôt négatif celui-là — qu'elle nous maintient dans une atmosphère entièrement, sinon intensément catholique: le climat religieux de la race à laquelle nous appartenons, alors que l'anglais présente ce danger de nous mettre en relation avec les cent millions de protestants et de libre penseurs qui vous entourent sur ce continent.
 |
En 1950, l'abbé Lionel Groulx
défendra encore sa thèse: «La langue anglaise est la propagandiste naturelle
des idées protestantes, au Canada comme aux États-Unis et en Grande-Bretagne,
pays où le protestantisme contrôle les sources d'information, le cinéma, la
radio, la presse et la télévision.»
Il n'est pas surprenant que, dans les écoles, les religieux aient pu inculquer les valeurs morales chrétiennes jusque dans l'enseignement de la grammaire, là où la religion et le participe passé se confondaient. La publication en 1907 de L'analyse grammaticale et l'analyse logique de Charles-Joseph Magnan fut saluée en ces termes par le journaliste Omer Héroux: «Il n'est pour ainsi dire pas une page [...] qui ne tende à élever le petit écolier, à l'orienter vers des aspirations plus hautes, à lui faire comprendre l'indignité de certains vices.» Entre 1850 et 1950, la plupart des manuels de grammaire et de lecture puisèrent abondamment leurs exemples dans la religion. Contrairement à ce que craignaient les Britanniques partisans du One Nation, One Language, la défense du français ne déboucha pas sur une remise en cause des structures politiques. Bien au contraire, le clergé et les élites francophones soutinrent en général l'ordre établi et acceptèrent la domination anglophone comme allant de soi. La question de la survivance linguistique et culturelle ne semblait pas liée au pouvoir économique et politique. |
La défense de la langue française passait par le traditionalisme et le conservatisme des valeurs rurales, l'exaltation des archaïsmes, l'apologie de la langue louis-quatorzienne, le recours au thème de la «langue des ancêtres» ainsi que la phobie de la langue et de la littérature de la France révolutionnaire, républicaine, laïque et contemporaine. Sauf quelques rares exceptions, toute la société canadienne-française de l'époque avaient adopté cette idéologie et la faisait sienne.
6.5 Un combat d'arrière-garde
Le combat pour la survivance de la langue devait nécessairement prendre fin, car il était voué à l'échec. Les Canadiens français ne semblaient pas avoir compris que, s'ils avaient subi au Canada anglais depuis 1871 toute une série de restrictions de leurs droits scolaires, ce n'était pas en tant que «catholiques», mais en tant que «francophones». Ce sont bel et bien les francophones qui y perdaient toujours, pas les Irlandais catholiques anglophones. C'est seulement à la suite du fameux Règlement 17 adopté par l'Ontario en 1912 et qui supprimait les écoles françaises publiques, que les francophones commenceront à mieux comprendre les véritables enjeux politiques. Au Québec, les grandes campagnes de francisation menées par l'Action française, par la Société du bon parler français ou par la Société Saint-Jean-Baptiste connurent beaucoup moins de succès que, par exemple, les campagnes publicitaires pour diffuser les albums de Tintin au Québec.
L'idéologie officielle de l'Église catholique, qui avait défini les Canadiens français comme un peuple catholique, français et rural ne correspondait plus à la réalité à la fin des années 1930. En effet, en 1941, seulement 35 % de la population de la province (3,3 millions) habitait dans des régions rurales et moins de 30 % vivait de l'agriculture. Le peuple demeurait attaché à sa religion, mais il devenait manifeste que la religion n'avait pu enrayer l'état de déchéance où végétait la langue française, signe de la servitude individuelle et collective des Canadiens français. La langue ne pouvait plus être la gardienne de la foi. D'ailleurs, au yeux des autorités vaticanes, le Canada était devenu une colonie britannique et sa langue d'usage était forcément l'anglais.
Après la Seconde Guerre mondiale, le discours officiel de la vieille idéologie de conservation du peuple canadien-français était dépassé. En même temps, l'Église catholique trouvait en Maurice Duplessis, premier ministre du 26 août 1936 au 8 novembre 1939, et du 30 août 1944 au 7 septembre 1959, un allié puissant qui confirmait le rôle séculaire des institutions religieuses dans le domaine scolaire et social. En effet, si l'Église conservait pour un temps sa suprématie dans les domaines de l'éducation de langue française et de la santé, elle ne pouvait plus prétendre rester le seul rempart de la nation canadienne-française. En ce qui concerne la langue, la politique de Duplessis fut ambiguë. En 1938, il avait abrogé la Loi relative à l'interprétation des lois de la province (20 mai 1937), qui accordait la priorité au texte français dans l'interprétation des lois et règlements du Québec, parce qu'elle avait mécontenté la minorité anglaise. Dans une lettre au lendemain du rappel de la loi, Duplessis déclarait: «Notre langue française est un trésor qu'il nous est impérieux et vital de défendre et de protéger, sans esprit de race.» Le parti politique qu'il dirigeait, l'Union nationale, profita du prestige de son chef: son parti fut reporté au pouvoir en 1948, en 1952 et en 1956, chaque fois avec de solides majorités. Chef incontesté, Duplessis resta la figure dominante de son parti et de son époque.
Cependant, la philosophie du laisser-faire ou de la soumission fut de plus en plus contestée, à la fois par le mouvement syndical qui se radicalisait et critiquait les politiques du régime Duplessis, et par une certaine élite intellectuelle qui n'acceptait plus l'autoritarisme de l'Église et le conservatisme de la société. Même certains prêtres catholiques célèbres, tels Gérard Dion, Louis O'Neill et le père Lévesque de l'Université Laval, proposaient de nouvelles valeurs. Au Québec, les travailleurs étaient francophones; les dirigeants, anglophones. Maurice Duplessis projeta longtemps dans la population l'image du «gardien des traditions catholiques du Québec». Il décéda en fonction, le 7 septembre 1959 au cours d'un voyage à Schefferville. Le règne du premier ministre Duplessis a tout de même valu au Québec son drapeau actuel (le fleurdelisé), mais aussi un moyen pour la province de narguer le gouvernement fédéral et d'afficher son autonomie. La mort de Duplessis allait donner le signal de départ du processus de modernisation ou d'évolution accélérée du Québec, ce qui allait aussi entraîner la dissolution rapide du pouvoir de l'Église.
L'industrialisation apparut vers la fin du XIXe siècle et, par voie de conséquence, la formation de véritables villes. Les habitants des campagnes affluèrent vers les villes. Ils étaient employés dans des usines appartenant à des anglophones, ils travaillaient selon des techniques apprises des anglophones, ils se servaient de machines et d'outils fabriqués et nommés par des anglophones. Que ce soit les techniques, les précédés, les méthodes, etc., tout portait des noms anglais. Les termes anglais s'introduisirent massivement dans la langue de la population ouvrière urbanisée, qui ne connaissait pas les équivalents français. Personne ne songeait à les désigner en français. La langue de travail de beaucoup d'ouvriers était l'anglais qu'ils baragouinaient plus ou moins bien. À force de vivre dans un univers qui ne leur appartenait pas et qu'ils ne contrôlaient pas, les Canadiens français en arrivèrent à ne plus pouvoir nommer cet univers. C'est aussi naturellement vers l'anglais que se dirigèrent les milliers d'immigrants qui arrivaient chaque année au Québec (un demi-million entre 1900 et 1950).
7.1 Un
gouvernement provincial timoré
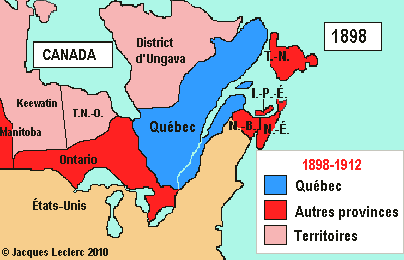 |
Lors de la création de la fédération canadienne, la province de Québec se révélait bien peu de chose (voir la carte). Non seulement la Loi constitutionnelle de 1867 imposait le bilinguisme au Parlement et dans les tribunaux à cette seule province, mais cette dernière était tenue solidement en laisse par le gouvernement fédéral. En vertu de la Constitution canadienne, le Parlement central avait le pouvoir de désavouer toute loi votée par le parlement de Québec; les députés pouvaient siéger aux deux parlements, ce qui permettait l'influence fédérale jusqu'au sein du gouvernement provincial. Le Québec était maintenu en état de sujétion financière puisque 60 % de ses revenus provenait du gouvernement central. Il n'est pas exagéré de dire que le Québec de 1867 était une «sorte de colonie» du gouvernement canadien. D'ailleurs, sir John Alexander Macdonald (1815-1891), premier ministre du Canada de 1867 à 1873 et de 1878 à 1891, aimait comparer les provinces à de «grandes municipalités» complètement soumises au «gouvernement national». |
Habitué à se défendre davantage par la parole que par les actes politiques, le gouvernement du Québec, sauf à l'époque de Honoré Mercier (1887-1891), n'a jamais cru au pouvoir de l'État pour promouvoir la langue nationale de sa majorité. D'ailleurs, la population semblait prendre pour acquis que leur gouvernement provincial était tout simplement inapte à défendre le fait français.
Le gouvernement du Québec pratiqua la politique du laisser-faire dans le domaine de l'économie. Durant toute cette période, l'économie québécoise demeura entièrement tributaire de l'économie anglo-américaine. Jusqu'en 1930, le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau laissa les capitalistes anglo-saxons mettre en valeur les richesses naturelles de l'Ontario et développer le secteur manufacturier de la Nouvelle-Angleterre en se contentant de fournir une main-d'œuvre à bon marché ou de rendre accessibles de nouvelles terres à la colonisation (Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue). Alors que l'agriculture avait cessé de constituer la base de l'économie québécoise, l'État, appuyé par l'Église, continuait de promouvoir l'agriculturisme; à 85 % rurale en 1867, la même population était déjà passée à 66 % en 1891, puis à 44 % en 1921, à 33 % en 1951 et à 25 % en 1961.
Une série d'événements extérieurs provoqua une transformation accélérée de l'économie québécoise: la crise des années 1930, la Seconde Guerre mondiale (1936-1945) et la reconstitution de l'Europe (1946-1949), qui s'approvisionnera en Amérique. C'est à ce moment que les grandes compagnies américaines commencèrent à faire main basse sur les richesses naturelles du Québec, encouragées par la politique de laisser-faire de Maurice Duplessis (premier ministre), qui leur accorda un appui inconditionnel. L'industrialisation et l'urbanisation transformaient la société traditionnelle de façon irréversible sans que l'État n'intervînt; celui-ci continuait de rester un simple instrument de défense et de préservation de l'ordre économique existant. Pendant que l'État québécois sacralisait l'agriculture, l'industrialisation et l'urbanisation se poursuivaient irrémédiablement en fonction des intérêts des capitalistes anglophones.
7.2 Un
interventionnisme limité
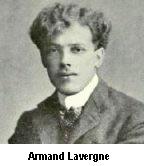 |
Les deux seuls cas où un gouvernement québécois
s'est permis de légiférer en matière de langue sont
révélateurs de l'attitude timorée des dirigeants de
l'époque sur cette question. Ainsi, n'eût été de la ténacité ou plutôt
de l'entêtement du député Armand Lavergne
(1880-1935), jamais
le gouvernement québécois n'aurait adopté, en 1910, ce qu'on finira par
appeler la «loi Lavergne». Le député Lavergne avait soulevé une vive polémique durant deux ans dans toute la province et avait fini par déposer une pétition forte de 1,7 million de signatures. Devant l'ampleur du mouvement d'opinion en faveur de la loi, c'est-à-dire presque toute la population du Québec y compris les anglophones, le gouvernement céda et fit adopter la loi. |
Cette loi modifiant le Code civil du Québec (chapitre 40) obligeait les entreprises de services publics établies au Québec à s'adresser en anglais et en français à leurs clients. Elle portait comme titre Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies de services d'utilité publique (voir le texte de la «loi Lavergne»). Bien que de portée limitée, la loi Lavergne constituait le première affirmation de l'État québécois en matière linguistique.
Toutefois, la loi a été appliquée très progressivement et nombreux furent ceux qui dénoncèrent dans les journaux, encore en 1921, les entorses à la loi québécoise. Fait troublant, la «loi Lavergne» n'a pas empêché le gouvernement du Québec d'émettre ses propres chèques uniquement en langue anglaise jusqu'en 1925. L'une des conséquence positives de cette première loi linguistique fut de favoriser le militantisme linguistique chez les Canadiens français du Québec. Quant au gouvernement fédéral, il attendra jusqu'en 1936 pour rendre la monnaie bilingue. On se battra jusqu'en 1962 pour avoir le droit de rédiger des chèques en français.
Pendant ce temps, l'abbé Joseph-Gérin Gélinas, professeur d'histoire au séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, de 1903 à 1927, rédigeait des chroniques d'histoire dans les journaux et s'employait à la défense de «la gloire de la France» dans son interprétation des faits historiques:
Nous étions pauvres au lendemain de la Conquête, en petit nombre, épuisés par la guerre et la famine ; mais la France avait jeté sur nos bords sa semence immortelle fécondée par les orages, cette semence devait germer, pousser, mûrir, comme le blé de chez nous jeté dans les sillons.
Pendant que de nouveaux maîtres légiféraient et gouvernaient, en tenant compte le moins possible de nos aspirations et de nos droits de sujets britanniques, de Canadien-français et de catholiques, le long du grand fleuve, sous la garde de Dieu et de sa mère la Vierge Marie, les berceaux canadiens-français surgissaient par centaines ; sur les genoux des mères canadiennes-françaises, les enfants balbutiaient le doux verbe de France ; dans des livres, les petits de chez nous buvaient, à longs traits, la vérité et la vie venues de France, la douce et la chrétienne. Et bientôt, du sein de la forêt, des champs de bataille, de nos églises, du parlement, des plaines de l'ouest, du pays d'Évangéline, de la Grande République, de partout on entendit une mélodie française qui chantait notre survivance et montait en un immense crescendo [...]
C'est cette mélodie que vous avez écoutée d'une oreille attentive, que vous avez étudiée avec amour, que vous avez trouvée si française, malgré ses défauts, vous la vaillante garde du Parler français.
Une telle vision de la réalité ferait
aujourd'hui sourire la plupart des nationalistes, mais à l'époque ce mouvement
d'une France idéalisée était largement répandu au Québec et en Acadie.
 |
Quelque 25 ans plus tard, cette attitude timorée avait continué
à habiter le gouvernement du Québec. En 1937, le premier
ministre Maurice Duplessis (1890-1959), qui
se croyait un grand défenseur de l'autonomie provinciale, décida de faire voter une loi
(Loi relative à l'interprétation des lois de la province)
donnant priorité
au texte français dans l'interprétation des lois et règlements
du Québec. Il lui paraissait normal d'accorder la préséance
au français, langue de la majorité au Québec.
Cependant, la Loi relative à l'interprétation des lois de la province (20 mai 1937) souleva la colère de la minorité anglaise, à commencer par les journaux anglophones de Montréal, puis des avocats, des juges et des députés anglophones. Moins d'un an plus tard (le 31 mars 1938), Maurice Duplessis reconnut publiquement «son erreur» et déposa un projet de rappel pour faire abroger sa loi (voir le texte de la loi d'abrogation). Le texte de loi fut voté à l'unanimité par le Parlement, avec l'appui de l'opposition officielle. Cette capitulation linguistique est passée à l'époque pour un acte de «courage politique» et a valu au premier ministre Duplessis les félicitations de toute la communauté anglophone. |
Ces deux «interventions» linguistiques révèlent non seulement jusqu'à quel point les gouvernements québécois étaient tributaires de la minorité anglophone pour traiter de leurs propres affaires, mais aussi qu'ils n'avaient pas encore acquis l'habitude d'agir, du moins en ce domaine, comme les représentants de la majorité francophone du Québec.
Plus encore: le législateur québécois était totalement dépendant de la langue anglaise elle-même dans la rédaction de ses propres lois. En effet, toutes les lois québécoises étaient d'abord rédigées en anglais ou calquées sur des textes votés antérieurement par des législatures canadiennes-anglaises ou anglo-américaines. La version anglaise des lois pouvait être rédigée dans un français tellement incorrect ou confus qu'il valait mieux, pour comprendre le sens des textes de loi, recourir à la version anglaise, écrite dans une langue grammaticalement plus correcte. Il ne faut pas oublier que, jusqu'à la fin des années 1950, beaucoup de fonctionnaires du gouvernement du Québec étaient unilingues anglais, particulièrement les juristes, les hauts fonctionnaires et les économistes du «département de la Trésorerie». Cette dépendance linguistique ne faisait que refléter un état de dépendance généralisée, dont la subordination économique.
7.3 L'absence de contrôle des Canadiens français sur eux-mêmes
Cette subordination économique provenait du fait que les francophones n'avaient jamais contrôlé ni dominé eux-mêmes le monde de l'économie. Durant toute cette période, les gouvernements ne sont jamais intervenus et n'ont jamais compris que l'industrialisation anglicisait la population. Ils ont simplement abandonné la classe ouvrière urbaine à son sort. D'ailleurs, l'affichage unilingue anglais ne faisait que refléter cette situation. Partout, même dans des villes où les francophones étaient majoritaires, l'anglais était omniprésent, le français boiteux, le bilinguisme rare. En effet, des photos datant de 1900 à 1950 montrant des affiches des villes telles que Québec, Montréal, Trois-Rivières, Drummondville, etc., révélèrent l'omniprésence de l'unilinguisme anglais dans l'affichage. Même la plupart des marchands canadiens-français affichaient en anglais, tellement le commerce était associé à la langue anglaise. De plus, l'étiquetage était à 95 % en anglais, sans compter les modes d'emploi, les catalogues, etc.
Il ne faudrait pas croire que la langue française était incapable d'exprimer les nouvelles réalités. Pendant la même période, le français de France s'était donné les moyens de nommer les produits industriels de la technologie et de la science. En fait, pendant tout le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, l'essentiel de l'évolution collective des francophones du Québec a échappé complètement à l'influence de la France et de la francophonie. D'ailleurs, lorsque le français était utilisé, c'était toujours par le moyen de la traduction, omniprésente dans les textes de loi, les jugements des tribunaux, les documents administratifs, les dépêches des journaux, les étiquettes, etc. De plus, la traduction, faite par n'importe qui, était bourrée de calques, d'emprunts sémantiques, de lourdeurs syntaxiques, etc. Bref, le français administratif et judiciaire étaient une langue traduite.
7.4 La dévalorisation sociale et linguistique
L'image du français parlé au Canada français s'est ternie avec les décennies. Cette question concernant la langue française parlée hanta les Canadiens français pendant pratiquement un demi-siècle. Elle leur fit comprendre que la mauvaise perception que les Anglo-Canadiens avaient d'eux contribuait ou servait de prétexte à remettre en question leurs droits linguistiques. C'est une tactique courante dans l'Histoire que de remettre en cause les droits linguistiques d'une communauté en qualifiant sa langue de patois ou de dialecte, ce qui justifie le non-reconnaissance des droits linguistiques. Les anglophones du pays commencèrent à qualifier ce français de «patois», par comparaison au «français de Paris» considéré beaucoup plus pur. Ce fut le début du mythe du "French Canadian Patois" et d'une longue période de dévalorisation de la langue française au Canada.
- Le "French Canadian Patois"
C'est entre 1860 et 1910 que la question du French Canadian Patois fit fureur dans les journaux. Les Canadiens français constatèrent avec stupéfaction que les Anglo-Canadiens et les Américains étaient persuadés qu'ils parlaient non pas le français – le French Parisian – mais un patois incompréhensible, aussi bien pour les Français que pour les étrangers en visite au Canada. Le journaliste et romancier Louis Tesson dans La Patrie du 18 juillet 1893:
Pendant notre long séjour à l'étranger, nous avons été à même de constater l'opinion défavorable qu'on se fait généralement du français parlé au Canada. Dans un esprit de justice et de solidarité patriotique, nous nous sommes toujours fait un devoir de ramener nos interlocuteurs à une saine appréciation des faits.
Lors d'une conférence donnée à Montréal, le 10 mars 1901, le journaliste Jules-Paul Tardivel déclarait :
Nous l'avons vu, c'est grâce aux propres efforts des Canadiens-français, aidés sans doute de la Providence, que la langue française est devenue la langue officielle du Canada. Mais cette langue, que nos ancêtres ont conservée avec un soin si jaloux, est-elle bien la vraie langue française ?
Dans certains milieux, particulièrement aux États-Unis, on est sous l'impression que le français parlé au Canada n'est pas le français véritable, mais un misérable patois. Certains de nos voisins affichent parfois leur dédain pour le Canadian French, très différent à leurs yeux du Real French as spoken in France. Plusieurs de nos écrivains ont fait des efforts louables pour dissiper ce préjugé, mais sans grand succès, probablement.Et même en France, en dehors d'un certain nombre de lettrés, on semble ignorer que la langue française s'est conservée intacte au Canada.
Édouard Fabre-Surveyer, dans La Revue canadienne (janvier 1903):
Car, ne l'oublions pas, une des raison — et non la moindre — de l'indifférence des Anglais à l'égard de notre langue, c'est l'opinion bien répandue que nous parlons un patois, comme ils disent, improprement, du reste.
Ernest Gagnon écrivait en 1802 dans Notre langue:
| Deux choses caractérisent la langue que nous parlons: les archaïsmes que nous devons conserver comme de vieux joyaux de famille, et les anglicismes dont nous devons nous débarrasser avec le plus d'application possible. |
En 1937, un chroniqueur linguistique, Jacques Clément, commentait ainsi dans le journal La Presse (Montréal):
L'élite des États-Unis et la classe instruite des Franco-Américains ont une très mauvaise opinion de notre parler, et nos compatriotes d'outre-quarante-cinquième en souffrent. [...] N'est-ce pas, chers compatriotes, qu'il est temps plus que jamais de nous occuper de notre langage? C'est une pitié que d'entendre notre classe soi-disant instruite. Son langage en public est mauvais, en famille et dans l'intimité, il est atroce.
En fait, personne durant cette longue période n'avait trouvé la racine du problème: la domination de l'économie par les anglophones, ce qui avait nécessairement entraîné des conséquences linguistiques. Les anglophones avaient occupé toutes les positions de commande dans l'économie pendant que les francophones avaient été relégués aux postes subalternes. En 1951, la présence des cadres francophones dans les entreprises n'était encore que de 6,7 %. Les grandes compagnies réservaient ordinairement leurs principaux emplois aux Canadians. L'historien Michel Brunet rappelle que certaines compagnies du début du XXe siècle allaient même jusqu'à afficher l'avis suivant: French need not to apply («Les francophones n'ont pas besoin de postuler un emploi»). La discrimination se poursuivit avec plus de discrétion par la suite, mais elle n'en demeura pas moins efficace.
Chantal Bouchard (dans
La langue et le nombril) a répertorié
les termes servant à qualifier la langue des Canadiens français
de l'époque. En voici quelques-uns:
| le Canadian French | le patois canadien-français | le Quebec French |
| la langue canayenne | le Quebec Patois | le parler canadien |
| le patois canadien | l'Indian jargon | le canayen |
| le misérable patois | le jargon canadien | le patois vulgaire |
| le Beastly horrible French | le langage petit-nègre | --- |
En réalité, ces qualificatifs poursuivirent les francophones pendant un siècle, c'est-à-dire jusqu'après la Révolution tranquille, lorsqu'un futur premier ministre canadien-français, Pierre Elliot Trudeau (alors ministre de la Justice), accusera les Québécois de parler un Lousy French, c'est-à-dire un français «pouilleux». Certains auteurs des années vingt nièrent le fait que les Canadiens français parlaient un «patois», même si ces mêmes auteurs reconnaissaient le caractère si particulier du français du Canada et qu'il ne paraissait pas étonnant que les étrangers le jugent plutôt mal.
- Le mauvais français
Au cours des années quarante et cinquante, le «mauvais français» des Canadiens était attribué, selon les chroniqueurs linguistiques, à la mollesse articulatoire. Évidemment, pour un linguiste, la «mollesse articulatoire» est simplement une aberration. En 1944, l'écrivain d'origine franco-ontarienne Roger Duhamel (1916-1985) s'élevait contre les bouches molles :
Nous péchons surtout par des vices de prononciation. Notre articulation est lâche, nous ne mordons pas dans les mots, nous contentant de les prononcer du bout des lèvres. Nous sommes en général, comme nous l'a reproché un jour le R.P. Lalande, des bouches molles.
Quant au grammairien québécois Jean-Marie Laurence (1906-1986), il avait décelé en 1957, du moins il le croyait, les trois grands défauts de la langue au Canada français:
Trois grands périls menacent l'intégrité du français au Canada: la mollesse de la prononciation, l'indigence du vocabulaire et l'anglicisme sous toutes ses formes.
Face à cette piètre opinion de leur langue, les Canadiens français ne pouvaient plus être fiers de leur langue. Tout leur mérite se résumait à avoir conservé et transmis leur culture d'origine au point où l'on entendait dire: «Seules nos origines peuvent nous permettre d'être fiers.» Évidemment, pour un linguiste, la prétendue «mollesse articulatoire» n'existe pas, c'est un jugement de valeur. Les Franco-Canadiens avaient juste développé une articulation différente de celle des Français. Les Canadiens, par tradition, avaient continué de privilégier, par exemple, la force articulatoire dans les voyelles orales, propre à la France des XVIIe et XVIIe siècles, alors que les Français du XIXe étaient passés à une articulation plus énergique des consonnes.
![]()
Le siècle qui avait suivi l'Acte d'Union,
soit la période de 1840 à 1950,
celui de l'impuissance et de la soumission, celui d'un Québec essentiellement
rural et catholique, était révolu. Pour plusieurs, il devenait
nécessaire que l'État québécois intervienne
enfin pour assurer la protection et la défense des citoyens sur
les plans social, économique, éducationnel et linguistique.
Les problèmes relatifs à la langue vont alors se
transformer en revendications d'ordre politique.
Dernière mise à jour:
05 mars, 2024
Histoire du français au Québec
(1) La Nouvelle-France
(1534-1760)
(2)
Le
régime britannique (1760-1840)
(3)
L'Union
et la Confédération (1840-1960)
(4)
La
modernisation du Québec (1960-1981)
(5)
Réorientations
et nouvelles stratégies (de 1982 à
aujourd'hui)
(6)
Bibliographie
générale
Histoire de la langue française