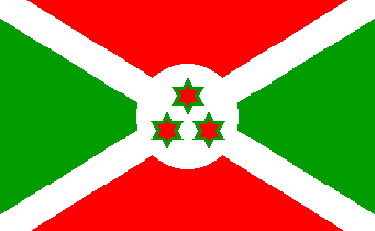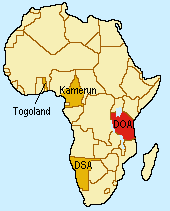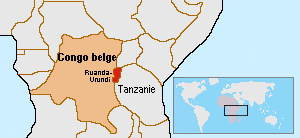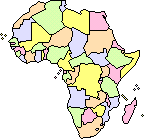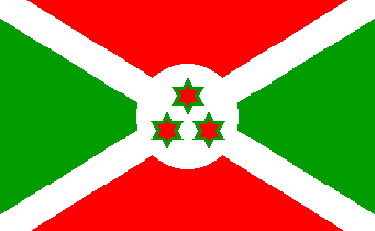
|
République du Burundi
|
|
Burundi
République du Burundi
Republika y'Uburundi
|
1 Situation géographique
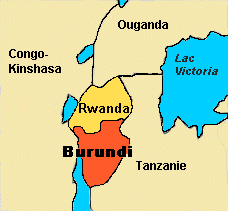 |
Le Burundi (officiellement la république du Burundi) est un
pays de hauts plateaux d'Afrique centrale situé sur la ligne de séparation
des eaux du Congo et du Nil, au
cœur
de la région des Grands Lacs. De tous les pays
voisins, c’est le Rwanda qui demeure le plus proche du Burundi, car ces deux
pays partagent des identités géographiques, humaines et historiques, sans
compter de nombreux particularismes linguistiques provenant d'une situation
similaire avec les langues locales. Rappelons aussi que le Burundi, le Rwanda et
le Congo-Kinshasa sont d’anciennes colonies belges.
Le pays est borné à l'ouest par le lac
Tanganyika et, à l’exception du petit Rwanda (au nord) qui n’a que 26 000
km², le Burundi est entouré de pays immenses dont la Tanzanie (à l’est et
au sud-est) avec ses 941 550 km², et surtout à l’ouest par le Congo-Kinshasa
avec 2 345 410 km² (voir la carte).
Depuis 2019, la nouvelle capitale politique est Gitega.
|
D'ailleurs, le premier évêque africain du pays voisin, le Rwanda, Mgr
Bigirumwami, disait à propos de la superficie de son pays encore plus petit
que le Burundi: «Quand on pose le doigt sur une carte
de l'Afrique pour indiquer le Rwanda, on le cache.» Il en est de même pour
le Burundi.
De tous les pays voisins, c’est le Rwanda qui demeure le plus proche du
Burundi, car ces deux pays partagent des identités géographiques, humaines et
historiques, sans compter de nombreux particularismes linguistiques provenant
d'une situation similaire avec les langues locales. Rappelons aussi que le
Burundi, le Rwanda et le Congo-Kinshasa ont déjà fait partie des colonies
belges. C'est donc la Belgique qui a amené le français dans ces trois
pays.
Ainsi, la situation géographique du Burundi situe cet État à la «frontière»
des «pays francophones» au nord et des pays «anglophones» au sud-ouest. La
capitale, Bujumbura, se trouve à l’extrémité ouest du pays, près du lac
Tanganyika. Bien que le Burundi (avec une superficie de 27 834 km²)
reste avec le Rwanda (au nord) l'un des plus petits États du continent, sa
densité de population est l'une des plus fortes.
2 Données
démolinguistiques
En 1997, la population du Burundi était estimée à 6,1 millions d’habitants,
mais 7,8 millions en 2005 et 8,8 millions en 2013, puis 13,2 millions en 2023.
Les Hutus représentaient alors 85 % de la population, les Tutsis, 13,8 %, et les Twas
(pygmées), 0,2 %.
|
Ethnie |
Population |
Pourcentage |
Langue |
Affiliation |
|
Hutu burundais |
11 134 000 |
85,6% |
kirundi |
langue bantoue |
|
Tutsi |
1
838 000 |
13,8% |
kirundi |
langue bantoue |
|
Malentendant |
132 000 |
1,0% |
langues de signes |
langue bantoue |
|
Pygmée twa |
37
000 |
0,2% |
twa |
langue bantoue |
|
Swahilien |
14 000 |
0,1% |
swahili |
langue bantoue |
|
Arabe |
3
700 |
0,0% |
arabe leventin |
langue
sémitique |
|
Gujarati |
3 000 |
0,0% |
gujarati |
langue indo-iranienne |
|
Lingala |
2
900 |
0,0% |
lingala |
langue bantoue |
|
Francophone |
2 200 |
0,0% |
français |
langue romane |
|
Hutu rwandais |
1
100 |
0,0% |
kinyarwanda |
langue bantoue |
|
Grec |
900 |
0,0% |
grec |
langue grecque |
|
Anglophone |
600 |
0,0% |
anglais |
langue germanique |
|
Autres |
69
000 |
0,5% |
- |
- |
|
Total 2021 |
13 238 400 |
100% |
Source: Joshua
Project, 2023 |
- |
Les groupes ethniques du Burundi comprennent les trois
principaux groupes autochtones: les Hutus, les Tutsis et les Twas. De plus,
l'immigration récente a également contribué à la diversité ethnique du
Burundi (Swahiliens, Arabes, Indiens, etc.). Après l'indépendance, le Burundi a connu des violences
interethniques récurrentes, en particulier dans l'arène politique qui, à son
tour, s'est propagée à la société dans son ensemble en faisant de nombreuses
victimes au cours des décennies. Les dynamiques ethniques entre Hutus et
Tutsis ont particulièrement façonné l'histoire et la politique burundaises
et sont devenues un objet d'étude majeur par les universitaires.
Malgré la prévalence de ce point de vue dans le passé, en
particulier pendant la période coloniale, de nombreux chercheurs et
d'intellectuels et politiciens burundais ont tendance maintenant à remettre
en question cette approche de l'ethnicité au Burundi. Il semble que la
politique actuelle s'approprie l'ethnicité comme un instrument pour
atteindre des objectifs plus grands, ce qui favorise le nivellement des
identités communautaires. Pour certains chercheurs, les différences d’origines
entre les Hutus et les Tutsis ne sont pas prouvées ou n'existent pas. De
toute façon, le Burundi ne fournit pas de données sur les différences
ethniques, à l'exemple d'autres pays, notamment en France et en Belgique,
qui ne font pas de recensement linguistique, de peur de réactiver des
antagonismes indésirables. C'est pourquoi il s'est
développé au Burundi une idéologie dont le but est d'éliminer
les distinctions entre ethnies, mais paradoxalement ce mouvement est soutenu
par les défenseurs de leur propre ethnie. C'est une politique de l'évitement
qui permet de placer le couvercle sur la marmite et d'oublier les problèmes
de fond.
Bien sûr, les réponses aux questions sur l'origine ethnique
témoignent de la perception de chaque individu concernant son ascendance
ethnique. Par conséquent, la transformation du contexte social dans lequel
le questionnement est posé, ainsi que l'évolution de la conception qu'a un individu de
ses origines ethniques ou de ses opinions à cet égard, ont une incidence sur
le dénombrement des groupes ethniques. Il est vrai qu'il n'est pas aisé de
distinguer les Hutus des Tutsis, car il existe, par exemple, des Tutsis
musulmans et des Hutus chrétiens, tout comme on trouve des Tutsis chrétiens
et des Tutsis musulmans. De plus, un individu peut avoir la citoyenneté
burundaise, parler le gujarati, être né au Rwanda et déclarer être d'origine
ethnique tanzanienne. De fait, les données sur l'origine ethnique peuvent
être variables, mais elles reflètent la perception des individus quant à leur
ascendance ethnique au moment de la collecte des données. En ce qui concerne
le Burundi, les cicatrices laissées par la violence de l’histoire ne sont
pas refermées, ce qui témoigne de l'extrême fragilité des populations en
situation de grande vulnérabilité.
C'est pour cette raison que le gouvernement burundais préfère ne pas faire
de recensement ethnique de peur de raviver un conflit qui n'aurait jamais dû
arriver.
2.1 Le kirundi
Tous les Burundais d’origine, quelle que soit leur ethnie (hutue,
tutsie ou twa), parlent la même langue, soit le kirundi (ou simplement rundi),
une langue bantoue. Certaines théories
sur l’immigration laisseraient croire que le kirundi aurait été transmis par
les Hutus, alors que les Tutsis auraient perdu leur langue ancestrale depuis
plusieurs siècles; dès lors, on peut s’interroger sur le fait que l’envahisseur
tutsi n’aie pas cherché à imposer sa langue au lieu de l’«oublier». Quoi qu’il
en soit, le kirundi est devenu aujourd’hui la langue nationale de tout le Burundi,
mais cette langue est fragmentée en de nombreuses variétés dialectales, relativement
intelligibles entre elles. Les Hutus, les Tutsis et les Twa comptent pour 96,9
% des Burundais qui ont le kirundi comme langue maternelle; si l'on ajoute les
Rwandais parlant le kinyarwanda, le pourcentage des locuteurs du kirundi atteint
les 97 %. Le kirundi est la première langue co-officielle du Burundi.
Le kirundi est la langue nationale du Burundi, alors que
le kinyarwanda est la langue nationale du Rwanda, mais ce sont en réalité deux variétés d'une même unité linguistique dans
le vaste ensemble des langues des langues bantoues. Le kirundi est une langue restée très proche
du kinyarwanda du Rwanda au point où on les confond
parfois.
Des variétés du kinyarwanda\ kirundi sont également employées dans le pays voisin, soit
le Burundi (sous le nom de kirundi), ainsi qu’en Ouganda (sous le nom
de runyarwanda), en Tanzanie
et au Congo-Kinshasa.
Le kirundi du Burundi a emprunté une grande quantité de
mots à d'autres langues, mais surtout au français, au kinyarwanda, au swahili et
au lingala. De plus, l'anglais, le portugais et l'allemand ont aussi apporté un
certain nombre de mots au kirundi.
En 2007, le gouvernement burundais adoptait une politique culturelle qui
réaffirmait la nécessité d'unification du pays par le kirundi:
|
Dans un pays comme le Burundi, où plus de la moitié de la population
n’ont pas été à l’école pour y apprendre des langues étrangères, le
Kirundi, langue commune à tous les Burundais, est un élément
unificateur qui rapproche les différentes composantes sociales, et
qui est utilisé dans la vie politique, économique et sociale.
|
Le Burundi constitue un cas d'unilinguisme rare en Afrique, alors que 97 % de
la population parle le kirundi comme langue maternelle. Il est donc plus aisé
d'adopter une langue commune.
2.2 Le français
Le français est la seconde langue co-officielle du
Burundi. C'est une langue essentiellement apprise à l’école et
utilisée dans des situations formelles ou officielles. Seule une minorité de
Burundais peut s’exprimer en français. Selon le sens qu’on accorde au mot francophone,
on estime que les locuteurs du français oscillent entre 3 % et 10 % de la
population. Cela signifie que les premiers sont des «francophones réels»
(environ 170 000 locuteurs en incluant les coopérants européens), alors que les
seconds ne connaissent que superficiellement cette langue. En réalité, la langue
française constitue une langue véhiculaire uniquement pour les Burundais très
scolarisés (les «lettrés») ayant terminé leurs études secondaires ou encore
ayant poursuivi des études supérieures. Eux seuls maîtrisent les deux langues
officielles.
Il faut préciser que le français du Burundi est
particulier, car il a emprunté beaucoup de mots au kirundi, au swahili, au
lingala, au portugais et à l'anglais; il a aussi beaucoup de calques par rapport
à la langue nationale du pays. La situation du français au Burundi, comme c'est
aussi le cas dans les autres anciennes colonies belges (Rwanda et
Congo-Kinshasa), semble plus vulnérable que dans les autres pays africains de
langue française, qui sont situés plus au Nord. Le Burundi vit une sorte de
transition en matière de politique linguistique. Le français est perçu comme un
«mal nécessaire» hérité du colonialisme afin de communiquer avec le monde
extérieur. Toutefois, durant
les années de guerre, l’usage de la langue française a fortement régressé.
2.3 L'anglais
Le Burundi est francophone, mais compte tenu de ses
voisins anglophones comme le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, sans oublier le
Rwanda qui s'y met, l'anglais prend de l'importance. Ces pays de l'Afrique de
l'Est ont commencé un processus d’intégration économique et politique qui
devrait franchir les étapes d'une zone de libre échange, c'est-à-dire un marché
commun avec comme objectif ultime l’union économique, la création d’une monnaie
commune et une fédération des États membres. L’adhésion du Burundi à ce
processus d’intégration économique et politique de l’Afrique de l’Est en juillet
2007 fut saluée comme un événement important pour l’avenir politique des
populations et du pays.
Jusqu'à présent, la langue anglaise ne fut introduite au
Burundi que grâce à l’enseignement. Aujourd'hui, compte tenu de l’adhésion du
Burundi à l’EAC (East African
Community ou Communauté d'Afrique de l'Est),
comprenant aussi le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie, l’anglais
représente une langue dont il faut absolument tenir compte dans toute tentative
d’intégration économique, ce qui implique une nouvelle politique linguistique
explicite. La région de l'Afrique de l'Est couvre une superficie de 1,8
million de km² avec une population de 132 millions (estimation de juillet 2009)
et dispose d'importantes ressources naturelles.
Non seulement l'anglais est la langue officielle de
l’EAC, mais il est aussi devenu la langue de la diplomatie, du commerce, de
la science, de l’éducation et de la culture dans toute cette région de
l'Afrique. C'est donc la langue d’intégration régionale en Afrique de l'Est.
Toutefois, l'anglais au Burundi n'est parlé
que par
quelques Européens et certains Africains anglicisés d'origine rwandaise, congolaise ou
tanzanienne. En raison
de l’ouverture du pays au marché international, surtout vers le sud, l’anglais
se répand de plus en plus dans le monde des affaires du Burundi en tant que langue
véhiculaire.
2.4 Le swahili
Le
swahili (appelé aussi kiswahili) n'a aucun statut juridique au Burundi, mais cette
langue demeure importante, notamment dans les petites entreprises commerciales,
alors qu'elle sert de langue véhiculaire. En fait, le swahili est la langue
véhiculaire la plus importante de la région des Grands Lacs, et ce, d'autant
plus que c'est la langue africaine comptant le plus grand nombre de locuteurs en
Afrique de l'Est.
L'article 119 du Traité pour l'établissement du traité de
l'Afrique de l'Est (2007) énonce que les États membres doivent promouvoir une étroite
coopération dans le domaine de la culture et des sports au sein de la Communauté
au moyen du «développement et la promotion des langues indigènes et
notamment le swahili en tant que lingua franca. D'ailleurs,
l'Académie africaine des langues (ACALAN) fut dondée en ce sens. C'est une
institution internationale spécialisée de l'Union africaine, qui a pour
mandat de développer et de promouvoir l'utilisation des langues africaines
dans tous les domaines de la société. L'ACALAN a pour partenaires l'UNESCO,
l'Organisation internationale de la Francophonie, l'Union académique
internationale et la Coopération Suisse.
Au
Burundi, le swahili est enseigné dans les universités, il est
utilisé dans les médias électroniques et est parlé par un nombre non négligeable
de jeunes urbains, de musulmans ou d'étrangers, notamment les immigrants d’origine africaine. L'Église catholique tente de freiner l’expansion du swahili
qu'elle juge trop lié à l’islam.
2.5 Les autres langues
On compte aussi des étrangers au
Burundi, surtout des Africains, parmi lesquels on distingue les Rwandais, les
Congolais (Congo-Kinshasa), les Tanzaniens, les Maliens et les Guinéens.
Beaucoup d’entre eux parlent, outre leur langue maternelle, l’anglais, le
français ou le swahili. Vivent aussi dans le pays un certain nombre d’Arabes
et d'Indiens du Gujarat, ainsi que des Européens qui forment une population flottante
de coopérants (surtout composés de Belges, de Français, de Grecs et d’Italiens).
Cela dit, au moins 15 % de la population burundaise est constituée de réfugiés
(ceux qui ont quitté leur pays), de rapatriés (ceux qui sont revenus au
pays), de refoulés (ceux qui sont renvoyés au pays) ou dispersés dans
des camps de regroupement. Il y aurait, à ce jour, plus de 800 000 personnes
déplacées suite à la «politique de déplacements» forcés du gouvernement
burundais et à la guerre civile qui ravage le pays.
2.6 Les religions
Il se pratique plusieurs religions au Burundi. La
composition religieuse est la suivante : 60 % de catholiques, 20 % de religions
indigènes, 15 % de protestants, 2 % à 5 % de musulmans. En réalité, personne ne sait exactement quels
sont les adeptes de la religion traditionnelle animiste; la plupart des
Burundais qui consultent les devins, les faiseurs de pluie, les sorciers, etc.,
portent des noms chrétiens et ont été baptisés chrétiennement.
3 Données
historiques
L’histoire du Burundi se confond avec celle du Rwanda, du moins jusqu’à
l’indépendance. Le Burundi, comme le Rwanda, aurait été peuplé vers le
VIIIe siècle avant notre ère par des Batwas ou Twas,
une population pygmoïde vivant de chasse dans la forêt; ces ancêtres des
pygmées seraient venus de l’Ouest et parlaient une langue bantoue (qui ne
serait pas le kirundi). Quelques siècles plus tard, un peuple d’agriculteurs,
les Hutus, auraient cohabité avec les Tutsis,
des pasteurs venus du Nord, qui se seraient installés progressivement entre les
Xe et le XVe siècles. Ces trois communautés d’origines
différentes se sont assimilés les unes aux autres avec le temps et ont fini
par partager la même langue bantoue, le kirundi \ kinyarwanda des
Hutus, et la même religion.
À partir du XVIe siècle, la région s’organisa en royaumes
dirigés chacun par un mwami (roi), qui représentait l’image d'Imana,
le dieu suprême et tout-puissant. L’un des mwami, issu de la dynastie
Nyiginya, finit par unifier le pays sous son autorité. Dans l'exercice du
pouvoir, le mwami ne pouvait gouverner seul, d'où la mise en place de
tout un système d'organisation politico-administrative, sociale et économique.
Dans chacun des districts du pays, on trouvait, en principe, un «chef des
pâturages» (généralement d'origine tutsie) pour l’élevage des bovins et
un «chef des terres» (généralement d’origine hutue); cette
«administration» était complétée par une organisation militaire avec des
«chefs d'armée» (recrutés généralement chez les Tutsis) et, dans les
régiments, des «lignages» tutsis et hutus. En fait, Tutsis et Hutus avaient
des terres et du bétail, bien que, si le pouvoir restait aux mains d'une
aristocratie tutsie, les deux «ethnies» cohabitaient pacifiquement, car durant
plusieurs siècles les Tutsis surent manier habilement la carotte et le bâton.
En somme, culturellement homogénéisés et biologiquement mélangés, les
deux groupes vivaient dans une certaine complémentarité sociale, certes
quelque peu inégale, mais maintenue dans une certaine cohésion nationale
dynamique. Par ailleurs, situé à l’écart des grandes voies naturelles de
communication, le Burundi, comme le Rwanda, échappa aux raids des chasseurs d’esclaves
(ce qui explique aujourd'hui la grande densité de la population) et, jusqu’au
XIXe siècle, aux grands explorateurs européens. Le Burundi
atteignit sa plus grande expansion sous le règne du mwami Ntare Rugamba
(1796-1850). Celui-ci dota le pays d’une puissante armée très entraînée et
conquit un territoire important. Sous son règne, la société burundaise était
structurée en deux classes: celle des Tutsis et celle des Hutus. Cette division
correspondait avant tout à des distinctions sociales, car un Tutsi pouvait
devenir Hutu et vice versa. Cette distinction entre Hutus et Tutsis allait se
renforcer avec l’arrivée des colonisateurs allemands, puis belges.
En même temps, le Burundi précolonial se caractérisait par
un unilinguisme plutôt rare en Afrique, car le kirundi demeurait la seule langue
langue maternelle, nationale et officielle du pays.
3.1 Le protectorat allemand
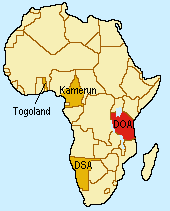 |
C'est en 1858 que les premiers Européens, soit les Britanniques John Hanning
Speke et Richard Burton, découvrirent la région; ils furent suivis par Henry
Morton Stanley et David Livingstone — dont la fameuse rencontre en 1871 se
serait déroulée au Burundi, près d’un rocher à 12 km au sud de Bujumbura
au bord du lac Tanganyika — qui attirèrent l'intérêt sur cette région
extrêmement riche, laquelle devait être bientôt soumise au régime de
l'exploitation coloniale; cela dit, la rencontre des deux explorateurs a plutôt
eu lieu à Ujiji, près du lac Tanganyika en... Tanzanie. Après 1879, des missions catholiques tentèrent de s’implanter
dans le royaume du Burundi, puis des explorateurs allemands y séjournèrent,
dont le comte Graaf von Gotzen. En 1890, les Allemands parvinrent à intégrer le Burundi (appelé alors Urundi) et le Rwanda
(appelé Ruanda) à leurs possessions d'Afrique orientale — la
Deutsch
Ost-Afrika (DOA), englobant le Burundi, le Rwanda et le Tanganyika (Tanzanie). En
1899, les Allemands fondèrent Usumbura (aujourd’hui Bujumbura). Ces derniers
imposèrent peu à peu leur protectorat au mwami Kisabo (1850-1908) qui,
en 1903, signa le traité de Kiganda avec l’Allemagne. |
Soucieux de ne pas trop dépenser pour leurs lointaines possessions, les
Allemands optèrent pour un système d’«administration indirecte» qui
plaçait le royaume sous leur contrôle. Le gouverneur allemand assurait le
rôle du mwami (roi), mais s’appuyait essentiellement sur la
collaboration des chefs locaux; les habitants du pays continuaient d’utiliser
massivement leur langue nationale. Dès cette époque, les Allemands comprirent
qu’ils devaient s’allier aux Tutsis qui dominaient la société burundaise.
Voici ce qu’écrivit à ce sujet, en 1916, l’auteur allemand Hans Meyer dans
Die Burundi (traduit en français sous le titre de Le Burundi, une
étude ethnologique en Afrique orientale, 1984):
|
Tant que les Batutsis [Tutsis] seront les maîtres du pays, un essor
intellectuel et culturel du peuple barundi demeure impossible, car seul ce bas
niveau des Bahutus [Hutus], maintenu au cours d'un isolement séculaire, assure
la domination batutsie. Pour l'instant évidemment, nous Allemands, devrons
rester en bons termes avec les Batutsis et les intéresser matériellement
à
nos initiatives en Urundi, car nous sommes encore trop faibles pour partir
ouvertement en campagne contre eux. Mais le but d'une politique coloniale à
plus long terme devra être de briser la domination batutsie, de libérer les
Bahutus du joug batutsi et de les gagner à nos visées civilisatrices qui
correspondent aussi à leurs propres intérêts.
|
Cependant, les Allemands ne purent mener à bien leurs «visées
civilisatrices», car ils perdirent peu après leur colonie de la Deutsch
Ost-Afrika. Pour ce qui est de la langue, l’influence allemande fut même
tout à fait négligeable, mais il est resté quelques germanismes dans le
kirundi. La véritable influence des Allemands fut d’avoir introduit l’Église
catholique qui, en tant qu’alliée du pouvoir politique, allait prendre la
relève dans les secteurs de l’enseignement et de la santé, et connaître par
la suite un immense succès social. On sait que, dès les années 1930, plus de
70 % des Burundais seront déjà convertis à la religion catholique. Ainsi, le
Burundi allait devenir avec le Rwanda un front de résistance à l’islam.
3.2 Le mandat belge et l’Église catholique
En 1916, les Belges, avec l'aide des Britanniques, amputèrent une partie du Rwanda qu’ils
placèrent sous leur «protectorat», tandis que les Britanniques annexaient les districts
septentrionaux à leur colonie d’Ouganda. Les forces anglo-belges
finirent par envahir toute la colonie allemande, c'est-à-dire le territoire du Ruanda-Urundi.
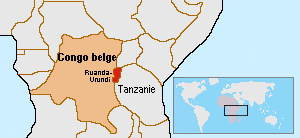 |
Après la défaite de l’Allemagne en 1918, le traité de Versailles rendit les
colonies allemandes aux pays vainqueurs. Sous mandat de la Société des Nations
(SDN), la Grande-Bretagne se vit confier l’administration du Tanganyika
(Tanzanie), alors que la Belgique administra le Ruanda-Urundi (Rwanda-Burundi) à
partir de Bujumbura (Burundi), devenue capitale du mandat belge du Ruanda-Urundi
(aujourd'hui, le Rwanda et le Burundi). Le Congo belge comprenait
six provinces: Léopoldville, Équateur, Orientale,
Kivu, Kasaï et Katanga. En 1925, le
Ruanda-Urundi fut rattaché au Congo belge dont il constituait la
septième province. |
Au début du mandat belge en 1916, l’Administration reprit la politique de
«contrôle indirect» sur le Burundi et continua de s'appuyer sur les
autorités en place, c’est-à-dire le mwami et l'aristocratie tutsie.
Le gouvernement colonial belge confia définitivement à l’Église catholique
tout le secteur scolaire et le domaine de la santé.
- Le rôle de l'Église catholique
L’Église combattit aussitôt la religion traditionnelle (païenne) basée
sur le culte de Kiranga et mit tout en œuvre pour affaiblir, puis supprimer la
théocratie burundaise (et rwandaise). Adoptant les pratiques des autorités
civiles belges, l'Église catholique favorisa les Tutsis considérés comme les
«élites» du pays. Elle assura leur «conversion» au catholicisme en leur
enseignant qu’ils formaient les «seigneurs féodaux» (évolués et
apparentés à la race blanche), alors que les Hutus et leurs chefs étaient des
«serfs» (négroïdes et sauvages) voués à la domination.
Le mythe des
«Tutsis évolués» et des «Hutus faits pour obéir» fut méthodiquement
véhiculé pendant plusieurs décennies par les missionnaires, les enseignants,
les intellectuels et les universitaires, qui accréditèrent cette vision de la
société rwandaise jusqu’à la fin des années soixante. Le
résultat de cette «mission civilisatrice» fut de donner aux Tutsis un pouvoir
qu'ils n'avaient jamais connus avant la période coloniale et d'entraîner chez
les Hutus une exploitation sans commune mesure avec leur situation
traditionnelle.
L’arrivée
des prêtres de la Société des Missionnaires d’Afrique, dite des «Pères
Blancs», en 1931 vint bouleverser la vie des autochtones, car l’Église
catholique entreprit l’évangélisation massive des habitants et tenta d’éliminer
toute concurrence. Dès leur arrivée, les Pères Blancs introduisirent l'alphabet latin et une
orthographe commune pour le kirundi du Burundi et le kinyarwanda du Rwanda, car
le kirundi au Burundi et le kinyarwanda au Rwanda devinrent les langues
d'enseignement.
Grâce à l’étroit contact qu’ils développèrent auprès des populations
autochtones, les missionnaires ont vu leur implantation facilitée: en parlant
le kirundi et en s’intégrant aux Burundais, ils ont réussi à acquérir une
très forte influence sociale, économique, mais également politique. Les
missionnaires catholiques obtinrent du gouvernement belge la suppression de la
fête religieuse nationale du Muganuro et la destitution de l’aristocratie
religieuse hutue au profit des familles princières tutsies. L’appartenance à
la religion catholique devint un critère incontournable pour accéder ou rester
dans la fonction de chef. Évidemment, beaucoup de «chefs païens» se
convertirent à la religion catholique. Signe éclatant de l’implantation du
catholicisme au Burundi: en vingt ans, plus de 70 % des Burundais devinrent
catholiques. Le français demeura la langue officielle, car, la plupart des
missionnaires étaient francophones (ou wallons). Cependant, une nouvelle
génération de prêtres flamands, d’origine plus modeste que leurs collègues
francophones (ou wallons), s’identifia davantage aux Hutus et entreprit de
former une contre-élite hutue, et leur apprit le néerlandais. Ces Hutus
devinrent les leaders de la «nation hutue» et s’impliquèrent dans la
politique active.
- L'administration coloniale belge
Le gouvernement colonial décida en 1925 de
modifier l’administration du Rwanda et du Burundi. Les fonctions de
chef devinrent héréditaires. Puis l’Administration coloniale belge
décida que, à travers tout le Burundi (et le Rwanda), les chefs
devaient être des Tutsis qui étaient «plus aptes à gérer» le pays.
En 1929, il fut même créé une «école de fils de chef» (celle d’Astrida)
afin d’assurer la pérennité du système. Les jeunes Tutsis pouvaient
aller à l’école (en français et en kirundi), tandis que les fils des
Hutus n’avaient que la possibilité de devenir agriculteurs comme
leurs parents. Par exemple, dans les écoles coloniales, on apprenait
l'arithmétique et le français aux enfants tutsis mais le chant aux
petits Hutus. Par la suite, les Belges imposèrent la fameuse carte
d’identité (1933-1934) avec la mention ethnique Tutsi ou Hutu, ce
qui eut pour effet d’accentuer la distinction sociale entre les deux
ethnies, laquelle se transformera plus tard en ségrégation
«raciale». L'enseignement du kirundi comme langue d'enseignement fut
délaissé au profit du français, alors que la langue nationale devint
une matière d'enseignement.
Ainsi, les Tutsis bénéficièrent d’avantages considérables
aux dépens des Hutus. Les Hutus furent soumis aux travaux forcés dans les
plantations, les chantiers de construction, les scieries, etc. Les Tutsis
avaient l’ordre de fouetter les Hutus, sinon ils risquaient de se faire fouetter
eux-mêmes par les colons belges. L’Administration coloniale exigea même que tout
propriétaire de dix vaches et plus soit considéré comme un Tutsi, les autres
demeurant automatiquement des Hutus. C’est alors que les Tutsis pauvres
devinrent des Hutus et que les Hutus riches devinrent des Tutsis. Une telle
dichotomie entre Tutsis et Hutus n’existait pas auparavant puisqu’un Hutu qui
possédait plusieurs têtes de bétail pouvait, de ce fait, être tutsifié, de même
que pouvaient se produire des phénomènes de détutsification ou de
hutusification.
Implantée dès 1945, cette «décision administrative» du
colonisateur belge finit par diviser encore davantage la société burundaise (et
rwandaise) de l’époque, car cette distinction signifiait que les riches étaient
des Tutsis et les pauvres, des Hutus. Les deux communautés autochtones, qui
avaient vécu en paix durant plusieurs siècles, en vinrent à se détester en
raison des rivalités suscitées par les décisions du colonisateur blanc. La
politique institutionnalisée véhiculée par le colonisateur avait développé chez
les Tutsis un complexe de supériorité, alors que chez les Hutus un puissant
sentiment de rancœur et de haine s’était installé. Enfin, l’imbrication très
étroite de l’Église et de l’État devint telle qu’on peut parler d’une «Église
d’État».
- La politique linguistique belge
Contrairement à la France qui s'est toujours dotée d’une politique
linguistique coloniale élaborée, portant sur l'imposition du
français et l'éviction des langues indigènes, la Belgique eut une attitude
différente. La Belgique était un petit pays aux moyens plus limités et sans
tradition coloniale. Pratiquant une administration indirecte («contrôle
indirect»), elle accorda aux langues africaines une place importante dans la
gestion des colonies et laissa
l’entière initiative en matière d'éducation aux missionnaires. De
plus, la Belgique était pays bilingue (français-néerlandais) aux prises avec des
populations francophones et
néerlandophones, qui s'opposaient à différents points de vue,
notamment en éducation et en administration.
Par exemple, au Burundi, si les fonctionnaires belges importants étaient
généralement francophones, les postes subalternes étaient tenus par des
néerlandophones parlant peu le français. La plupart des missionnaires affectés
dans les colonies étaient néerlandophones, alors que leurs supérieurs étaient
tous francophones. Or, les missionnaires avaient pour principal objectif
d’évangéliser les Africains, non de diffuser la langue du colonisateur, qui dans
le cas de la Belgique était ambivalente. Dans les colonies belges, comme d'ailleurs
en Belgique à cette époque, le statut du français et celui du néerlandais
n'étaient guère équitables, ce qui s'est reflété au Burundi, au Rwanda et au
Congo belge.
Afin de simplifier l'enseignement, les missionnaires ont préféré utiliser le
kirundi comme langue d'enseignement, contrairement aux Allemands qui avaient
choisi le swahili. Étant donné que les missionnaires catholiques se méfiaient du
swahili qu'ils jugeaient trop lié à l'islam, ils l'ont éliminé au profit du
kirundi. Ce choix a réduit considérablement le rôle du français qui était à
cette époque uniquement parlé par l'élite belge dans l'administration,
l'enseignement, l'armée et la religion, tandis que la plupart des subalternes
parlaient le néerlandais qu'on appelait alors le flamand. Ainsi, le rôle
des missionnaires dans les colonies belges fut beaucoup plus important que dans
les colonies françaises parce que l’État belge ne s'est impliqué que très
tardivement dans le domaine de l’éducation auprès des population africaine. En
effet, ce fut uniquement au cours de la décennie de 1950, juste avant
l'indépendance des colonies, que l'État belge a entrepris de former des élites
locales et de leur inculquer l'apprentissage du français. À la différence de la
France et de la Grande-Bretagne, il était trop tard pour former des élites
prêtes à prendre la relève au moment de la déclaration d’indépendance. C'est ce
qui explique en partie que la langue du colonisateur allait moins bien
s'implanter dans les anciennes colonies belges.
- Les mouvements de décolonisation et
le changement d'allégeance ethnique
Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements de
décolonisation atteignirent le Burundi et le Rwanda. Plus instruite et
s’estimant apte à diriger la pays, l’élite tutsie en vint à souhaiter le départ
des Belges. Pour leur part, les Hutus, tout en demandant que l’indépendance soit
retardée, dénoncèrent la «double colonisation» dont ils avaient été victimes:
celle des Tutsis (antérieurement, d'après eux), puis celle des Belges. Il
exigèrent que les Belges les débarrassent de cette première colonisation qu’ils
estimaient «inacceptables».
Se sentant trahis par leur élite tutsie devenue
anticolonialiste, le pouvoir colonial et l’Église catholique décidèrent, au
début des années cinquante, de favoriser les Hutus, plus soumis et plus
malléables. Les Tutsis furent désormais considérés comme des «ennemis» de
l’Église et de l’État. L’Église amplifia le mouvement et, à partir de 1957,
soutint ouvertement les mouvements hutus qui réclamaient des réformes sociales.
Détenant le monopole de l’enseignement, l’Église encouragea la formation d’une
élite contestataire hutue.
En 1959, commença dans le pays voisin, le Rwanda, une
véritable «révolution sociale» qui, s’inspirant des leçons apprises par les
pouvoirs belges et les représentants de l’Église catholique, amena le
remplacement du «pouvoir minoritaire tutsi» par le «pouvoir majoritaire hutu».
En favorisant systématiquement la notion de «démocratie majoritaire»,
l’Administration coloniale et l’Église catholique firent monter les tensions
entre les deux communautés ethniques et laissèrent se développer les rivalités
entre Tutsis et Hutus. La guerre civile éclata au Rwanda en 1959, alors que les
Tutsis furent pourchassés et massacrés par milliers. Plus de 170 000 Tutsis se
réfugièrent vers l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et le Congo-Kinshasa). La
prise du pouvoir par les Hutus au Rwanda entraîna le départ du mwami et l’exode
de plus de 200 000 Tutsis vers l’étranger.
Au Burundi, les Hutus n’eurent guère la possibilité de
prendre le pouvoir. Inquiets de la situation au Rwanda, les Tutsis du Burundi
prirent immédiatement les devants et accaparèrent le pouvoir politique et
l’armée. Ne pouvant éviter les conflits ethniques, les Tutsis se laissèrent
entraîner dans la spirale de la répression, surtout après l’assassinat du prince
Louis Rwagasore en 1961, un chef charismatique opposé à la discrimination
raciale et qui avait combattu toute transposition de la crise du Rwanda au
Burundi.
Lorsque s’acheva la période coloniale, la situation
sociolinguistique du Burundi pouvait être résumée ainsi : le
français a le vent dans les voiles, alors que le kirundi stagnait et
que le swahili déclinait.
3.3 Au lendemain de l'indépendance
Le Burundi accéda à l’indépendance le 1er juillet 1962 et
devenait une monarchie constitutionnelle, le tout dans un climat de conflits
ethniques accentués par la crise du Rwanda et la rébellion au Congo belge
(ou Congo-Kinshasa). En fait, l’accession à l’indépendance marqua le début de 30
ans d’instabilité politique au cours desquels se succédèrent de nombreux coups
d’État de la part des militaires tutsis et des insurrections hutues suivies de
massacres massifs des insurgés (1965, 1972, 1988, 1992). De là à penser que les
politiciens congolais avaient hérité davantage des défauts que des qualités
belges pour assurer la gestion des institutions nationales, il n’y eut qu’un
pas... vite franchi. Le français resta la langue officielle du Burundi au
lendemain de l’accession à l’indépendance.
- De coup d'État à l'autre
En 1966, la monarchie fut abolie et la république
proclamée par le capitaine tutsi Michel Micombero qui prit le pouvoir et fut
nommé président. À la suite d’une insurrection des Hutus en 1972, l’armée
tutsie, dans un réflexe de sécurité ethnique, massacra entre 100 000 et 150 000
Hutus et exclut les Hutus des sphères du pouvoir et de l’administration du
pays.
En mars 1973, le gouvernement burundais entrepris une
vaste réforme du
système d’éducation. Le principe de base de cette
réforme était de nationaliser et de rationaliser l'enseignement dans le but de
le rentabiliser. À cette fin, le gouvernement adopta
la politique de la kirundisation, c’est à dire l’adoption du kirundi, langue nationale,
comme véhicule d’enseignement pendant les six années de l’école
primaire. L’objectif visé était d’améliorer le rendement scolaire,
de soutenir la ruralisation, de réhabiliter le patrimoine culturel
burundais et de promouvoir une école dite «communautaire». Mais les
objectifs de la réforme ne devaient jamais être tous atteints en raison de
l'instabilité politique. La kirundisation de l'enseignement s’est arrêtée en
quatrième année du primaire, tandis que la ruralisation n'a jamais été mise en
œuvre et l'école communautaire n'a jamais pu s'implanter. Les programmes prévus
n'ont jamais obtenu l'adhésion totale des enseignants, faute d'une préparation
adéquate.
En 1976, un coup d’État (par le Tutsi Jean-Baptiste Bagaza)
évinça Michel Micombero, qui fut suivi d’un autre coup d’État en 1987 au cours
duquel le Tutsi Pierre Buyoya prit le pouvoir à la tête d’un «Comité militaire
de salut national». De nouveaux conflits ethniques secouèrent le Burundi en
1988; l'armée tutsie massacra encore plusieurs dizaines de milliers de Hutus,
alors que 45 000 autres se réfugièrent au Rwanda. En juin 1993, eurent lieu les premières élections libres;
Melchior Ndadaye, le
premier président hutu du Burundi, fut élu, puis assassiné quelques mois (le 21
octobre) plus tard, lors d'un coup d'État perpétré par des militaires tutsis, ce
qui déclencha à nouveau les massacres. Les Tutsis, accusés d'avoir assassiné le
président, ont commencé à être exterminés en grand nombre, mais l’armée tutsie
réussit à prendre le dessus. À nouveau, des dizaines de milliers de Hutus furent
chassés vers le Rwanda voisin.
Le nouveau président, Cyprien Ntaryamira, un autre Hutu,
succéda à Ndadaye et tenta de mettre un terme à la répression menée par l'armée
dominée par les Tutsis. Le 6 avril 1994, il fut tué à son tour, en même temps
que le président du Rwanda, Juvénal Habyarimana, dans un «accident d’avion»
causé par un missile au-dessus de Kigali (au Rwanda). Le génocide des Tutsis (au
moins 600 000 morts) qui s’ensuivit au Rwanda exacerba les Tutsis du Burundi
qui, pour leur part, contrôlaient le pouvoir politique et l’armée dans leur
pays. Les massacres des Tutsis rwandais ont servi à justifier les massacres des
Hutus burundais.
Par la suite, le Burundi fut en proie à une guerre civile
larvée. En mars 1996, le rapporteur spécial des Nations unies, chargé d'enquêter
sur la situation au Burundi, estimait à 15 000 (juste pour l’année 1995), le
nombre des victimes d'un «génocide au compte-gouttes», touchant plus
particulièrement les élites (instituteurs, infirmiers, etc.). En janvier 2000,
les pertes en vies humaines étaient évaluées, depuis avril 1994, à plus de 300
000 victimes. De son côté, l’organisation Amnistie Internationale dénonçait les
conditions dans lesquelles vivaient les 70 000 réfugiés rwandais dans les camps
du Burundi. Selon cet organisme, quelque 1500 réfugiés étaient tués chaque mois
par les forces de sécurité burundaises ou par les milices tutsies. Le génocide
contre les Tutsis était bien planifié et s'est étendu sur tout le Burundi, mais
il a surtout touché les régions du Sud: Makamba, Mabanda, Nyanza-Lac, Rumonge et
toutes les régions avoisinantes.
En juillet 1996, l'ancien président Pierre Buyoya prit le
pouvoir et chassa le président hutu. Les pays voisins, suivis par la communauté
internationale, décrétèrent un embargo, tandis que la rébellion hutue gagnait
plusieurs régions du pays.
- L'accord d'Arusha de 2000
Le 28 septembre 2000, le Conseil de sécurité de l'ONU est
parvenue, à Arusha (Tanzanie), à faire accepter un accord sur une déclaration
officielle demandant à toutes les parties burundaises (19 délégations) de cesser
les combats et d'appliquer l’Accord d’Arusha pour la paix au Burundi. Cependant,
trois délégations (sur 19) provenant des mouvements radicaux (deux délégations
hutues et une tutsie) ont refusé de signer le texte. Le gouvernement burundais
s’est dit prêt à appliquer l’accord d’Arusha, mais de nombreux obstacles ont
persisté et durent être surmontés avant sa mise en œuvre définitive.
Tout le Burundi continua de vivre dans la terreur, tandis
que 800 000 personnes vivaient dans des «camps de regroupement». Dans les
campagnes au sud, près de la frontière avec la Tanzanie, les Tutsis (14 % de la
population) se sont réfugiés dans les agglomérations, sous la protection de
l'armée qu'ils contrôlaient en majorité, tandis que les Hutus (85 % de la
population) vivent reclus sur les collines, dont ils interdisent l'accès aux
militaires. Mais au centre, à l'est et surtout au nord du pays, ces régions
étant sûres, et les Tutsis, ou ce qu'il en restait, demeurèrent sur les collines
avec leurs voisins hutus.
Comme il fallait s'y attendre, le partage du pouvoir entre
la minorité tutsie et la majorité hutue ne pouvait être que difficile, après
onze ans de guerre civile. En juillet 2004, le principal parti tutsi rejetait
l'accord présenté par la médiation sud-africaine à Pretoria. L'équilibre devait
être assuré sur une base ethnique, et l'Assemblée nationale devait être composée de
60 % de Hutus, de 40 % de Tutsis et de trois députés des Twa, tout comme le
nouveau Conseil des ministres. Pendant ce temps, en 2003, le ministère de l’Enseignement
primaire et secondaire tenta une nouvelle réforme de l'enseignement
en voulant généraliser la kirundisation dans les écoles primaires et en procédant
à une expérimentation élargie pour mesurer si celle-ci était porteuse
d’amélioration de la qualité dans l’apprentissage scolaire, mais
l'instabilité politique empêcha la réforme d'être menée à bien.
3.4 La réconciliation nationale
Le 19 août 2005, Pierre Nkurunziza, un ancien dirigeant de la guérilla, fut élu avec 62,9 % des voix comme nouveau
président de la république du Burundi, après des élections qui ont été reconnues
comme exemplaires par les observateurs internationaux. Nkurunziza était un Hutu,
alors que la vie politique, rappelons-le, a longtemps été dominée par la
minorité tutsie. Si les Tutsis ont accepté de perdre le pouvoir, y compris dans
l'armée, c'était en échange d'une présence garantie au gouvernement. Le président Nkurunziza a
alors mis en place un gouvernement en associant les autres partis
politiques ainsi qu'une forte représentation des femmes, soit sept femmes sur 21
ministres hutus et tutsis. Le nouveau président s'était donné comme priorité
d'éradiquer la corruption qui sévissait dans le pays. Cependant, plusieurs élus
étaient
considérés comme des criminels qui ont pu présenter leurs candidatures en
profitant de l'immunité provisoire octroyée en violation du droit international.
Ainsi, le président Nkurunziza était lui-même un ancien condamné à mort pour avoir
posé des mines sur la voie publique et ayant causé la mort de plusieurs civils
innocents. Il fut amnistié lors des accords d'Arusha en 2003.
En 2010, une deuxième série d'élections furent tenues dans
un climat de terreur avec la réélection du président Nkurunziza, avec plus de 91
% des voix, mais ce dernier était le seul candidat ! Les candidats présidentiels
de l’opposition s’étaient retirés pour protester contre les irrégularités du
scrutin, ce qui a d'ailleurs été dénoncé par l'opinion nationale, mais les
élections furent néanmoins validées par la communauté internationale.
3.5 Les nouvelles langues officielles de 2014
Le 28 août 2014, l'Assemblée nationale adopta à l’unanimité un projet de
loi portant sur le statut des langues et qui visait à mettre de l’ordre dans le
paysage linguistique burundais: Loi n°1/31 du 3 novembre 2014 portant statut
des langues au Burundi. Quatre langues (kirundi, swahili, français et
anglais) étaient utilisées jusqu’à ce moment, sans aucune réglementation. La nouvelle
réglementation faisait la part belle à l’anglais, langue nouvellement introduite
dans ce pays francophone des Grands Lacs africains. Cette fois, les choses
devaient
changer, la nouvelle loi devait mettre sur un pied d’égalité le kirundi, le français
et l’anglais, toutes trois appelées à être langues officielles de ce pays. Cette
nouvelle loi avait pour objet de mettre en valeur la langue nationale (le kirundi),
d'éviter des conflits linguistiques et de définir les langues officielles. La
loi proclamait que les langues officielles du Burundi étaient le kirundi, le français
et l'anglais, tandis que le swahili serait la quatrième langue enseignée à
l'école. Cependant, la Loi n°1/31 du 3 novembre 2014 portant statut des
langues au Burundi n'a pas été promulguée avant le mois de novembre 2014.
Néanmoins, les autorités se voulurent rassurantes sur le rôle du français. Le
gouvernement burundais affirma pratiquer «une diplomatie linguistique», qui
consiste à «adopter l’anglais pour être en ordre avec les autres pays membres de
la Communauté est-africaine». Le gouvernement soutenait qu'il «n’adopte pas
l’anglais pour exclure le français». Il désirait que les«francophones» et les
«angllophones» se sentent à l’aise également. Mais ce combat
s’annonçait très diffiicile, car dans ce genre de concurrence l’anglais, archi-dominant
dans la région, risquait de déclasser le français.
Le Burundi est demeuré sur la liste noire des pays où les
violations massives des droits humains sont les plus intolérables et constituent
un drame humanitaire révoltant. Non seulement, le Burundi a vécu dans des
conditions d’extrême précarité, mais les Burundais sont devenus parmi les
habitants les plus pauvres de l’Afrique. C’est pourquoi beaucoup de Burundais
sont convaincus que les dirigeants en place ne manifestent guère de réelle
volonté politique pour trouver une solution à la guerre civile qui a frappé
cruellement le pays, ainsi qu’à la recrudescence des fléaux tels que la faim, le
sida, le paludisme, etc.
En 2005, Pierre Nkurunziza fut élu président du Burundi, puis réélu
en 2010. En vertu de l'article 7 des accords d'Arusha le président
ne peut se faire élire pour un troisième mandat consécutif: «[Le
président] est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule
fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ». Or,
en avril 2015, Pierre Nkurunziza annonçait qu'il se présentait à
l'élection présidentielle burundaise de 2015, qui devait se tenir le
26 juin 2015. Le 5 mai, la Cour constitutionnelle validait cette
candidature. La candidature de M. Nkurunziza à un troisième mandat a
plongé le pays, depuis la fin d'avril 2015, dans une profonde crise
politique, émaillée de violences qui ont fait plus de 80 morts et
poussé quelque 160 000 Burundais à fuir leur pays. Les États-Unis
ont prévenu que des élections tenues dans de telles conditions ne
seraient pas crédibles et discréditeront davantage le gouvernement.
Les médias ont dénoncé l'«aveuglement» du président, qui prouve que
le maître de Bujumbura n’a qu’une seule idée en tête : «rester au
pouvoir», et ce, quel qu’en soit le prix. Comme pour les
législatives du 29 juin, l’opposition a d’ailleurs décidé de
boycotter le scrutin.
Comme il fallait s'y attendre, le président
burundais Pierre Nkurunziza a été réélu dès le premier tour pour un
troisième mandat, non sans avoir plongé, par sa candidature, ce
petit pays dans sa pire crise depuis la guerre civile. Des centaines
de personnes ont été tuées, des milliers d’autres détenues et plus
de 400 000 Burundais ont fui à l’étranger, selon différentes
organisations internationales. La Cour pénale internationale (CPI) a
d’ailleurs annoncé il y a deux semaines l’ouverture d’une enquête
pour faire la lumière sur les crimes contre l’humanité qui auraient
été commis par le régime, notamment le meurtre, la torture, le viol
et la disparition forcée. La CPI estime qu’il y a des raisons de
croire que des agents de l’État ont mené durant cette période «une
attaque généralisée et systématique contre la population civile
burundaise». Dans un rapport intitulé «Se soumettre ou fuir», publié
en septembre 2017, Amnistie internationale rapportait «une
recrudescence des exécutions extrajudiciaires, des arrestations et
détentions arbitraires et des actes de torture» au Burundi, ce qui a
contraint ainsi la population au silence ou à l’exil.
4 La politique linguistique du
Burundi
Il ne serait pas exagéré de dire que le Burundi actuel n’a pas de
politique linguistique, sinon la non-intervention. En effet, aux prises avec des
conflits ethniques incessants depuis l’indépendance, les dirigeants
politiques qui se sont succédé ont eu bien autre chose à faire que de s’occuper
des questions linguistiques.
4.1 Les textes juridiques
Rappelons tout
d’abord que, durant plus d’une vingtaine d’années
depuis l’indépendance (1962), le Burundi fut gouverné sans constitution, c’est-à-dire
de 1966 à 1974, puis de 1976 à 1981, de 1987 à 1992, et de 1996 à 1998. La
Constitution du 13 mars 1992 a été suspendue le 25 juillet 1996 par le nouveau
régime transitoire pour être remplacée par le décret-loi no 1/001/96 du 13
septembre 1996 portant sur l'organisation du système institutionnel de
transition. Depuis 1998, le décret-loi de 1996 porte maintenant le nom de
Acte constitutionnel de transition et les articles 5, 13 et 22 de la
Constitution de 2010.
- Les dispositions constitutionnelles de 2010
L’Acte constitutionnel de transition de 1998 constituait la loi
fondamentale jusqu'à la date de la promulgation d'une véritable constitution.
Ce texte de transition reprenait dans l’ensemble les dispositions de la
Constitution de 1992 relatives aux droits de l'homme et à la langue. Seul l’article
10 mentionnait expressément une disposition concernant la langue:
|
Article 10 (1998)
abrogé
1) La langue nationale est le
kirundi.
2) Les langues officielles sont le
kirundi et les autres langues déterminées par la loi.
|
Juridiquement parlant, le texte ne mentionnait pas que le français était
l’une des langues officielles du Burundi avec le kirundi. Ainsi, seul le
kirundi restait une langue officielle de jure. Qui plus est, le français
est même demeuré la «première langue officielle», alors que le kirundi
conservait le rang de «seconde langue officielle». La version de 2010 est quasi
identique:
| Article
9
1) La langue nationale est le
kirundi.
2) Les langues officielles sont le kirundi et les autres
langues sont déterminées par la loi. Tous les textes législatifs
d’application courante doivent avoir leur version originale en
kirundi.
Article 19
Toutes les femmes et
tous les hommes sont égaux en dignité, en droits et en devoirs. Nul
ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son
origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de
sa langue, de sa situation social de se convictions religieuses,
philosophiques ou politiques, du fait d’un handicap physique ou
mental, ou du fait d’être porteur du VIH sida. Tous les citoyens
sont égaux devant la loi qui leur assure une protection égale. |
En 2010, seul le kirundi est demeuré, comme auparavant, une langue officielle
de jure (de par la loi). Cependant, le français demeure l’une des deux
langues officielles dans les faits (ou de facto).
Certains
croient que l’expression «et les autres langues déterminées par la loi»
constituait une façon de faire entrer l’anglais au pays, comme ce fut la cas au
Rwanda et au Congo-Kinshasa. Jusqu'à récemment, ces «autres langues» n’ont
jamais été déterminées, ce qui signifie qu’aucune langue autre que le kirundi ne
devrait être utilisée ni dans les débats, ni dans les discours, ni dans les
projets de lois. Par ailleurs, même le kirundi ne jouit pas pleinement du statut
d’officialité que la Constitution lui confère, puisque cette langue n’est pas
obligatoire dans les débats et projets de lois à étudier et à promulguer, ni non
plus la langue exclusive de fonctionnement des institutions.
C'est pourquoi l'État burundais croit nécessaire de clarifier la situation en
déterminant lesquelles des quatre langues, entre le kirundi, le français,
l’anglais et le swahili, doivent être utilisées comme des langues officielles,
et dans quelles proportions et quels domaines obligatoires. Cela apparaît
d’autant plus urgent que certaines organisations internationales aimeraient
renforcer la situation des langues internationales parlées au Burundi. Le
gouvernement croit nécessaire de renforcer les positions de la langue nationale,
le kirundi, comme garant de l'identité culturelle et linguistique, de cohésion
sociale et de développement communautaire.
- L’accord d’Arusha de 2000
L’Accord d’Arusha pour la paix au Burundi, c’est-à-dire
l’accord signé en Tanzanie par 16 des 19 délégations burundaises en
présence du président sud-africain, Nelson Mendela, prévoit également des
dispositions à caractère linguistique. Ainsi, les articles 1 et 4 interdisaient
toute discrimination, quelle que soit la race ou la langue, la religion, l’origine
ethnique, etc.:
|
Article 1er
Tous les Burundais sont égaux en mérite et en
dignité. Tous les citoyens jouissent des même droits et ont droit à la même
protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale,
économique ou politique de la nation du fait de
sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine
ethnique.
Article 4
Toutes les femmes et tous les hommes sont égaux.
Nul ne peut être l'objet de discrimination du fait
notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa
couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions
religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'un handicap physique
ou mental. Tous les citoyens sont égaux devant
la loi, qui leur assure une protection égale.
|
Évidemment, on se demande bien à quoi peut bien servir présentement cette
disposition, puisque les faits démontrent que la discrimination constituait le
fondement de la société burundaise. Mais on pouvait espérer que de
nouvelles réformes permettraient éventuellement d’appliquer cette disposition qui engagerait
le pays vers une paix bien méritée. Par ailleurs, l’article 5 de l’accord d’Arusha reprenait les dispositions
de l’article 10 de l’Acte constitutionnel de transition de 1998, mais
remplaçait les mots «les autres langues déterminées par la loi» par «toutes
autres langues arrêtées par l'Assemblée nationale»:
|
Article 5
1) La langue nationale est le
kirundi.
Les langues officielles sont le
kirundi et toutes autres langues déterminées par la loi.
2) Tous les textes législatifs doivent avoir
leur version originale en kirundi.
Article 13
1) Tous les Burundais sont égaux en mérite et
en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont
droit à la même protection de la loi.
2) Aucun Burundais ne sera exclu
de la vie sociale, économique ou politique de la nation
du fait de
sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine
ethnique.
Article 22
1) Tous les citoyens sont égaux devant la loi,
qui leur assure une protection égale.
2) Nul ne peut être l'objet
de discrimination du fait
notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de
sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait
d'un handicap physique ou mental
ou du fait d'être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie
incurable. |
En 2018, les articles 13 et 22 se lisaient
toujours ainsi ainsi :
|
Article 13 1)
Tous les burundais sont égaux en mérite et
en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même
protection de la loi.
2) Aucun burundais ne sera exclu de
la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa
langue, de sa religion, de son sexe ou de son
origine ethnique
Article 22
1) Tous les citoyens sont
égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.
2) Nul ne peut être
l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son
ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa
situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, du fait d’un handicap physique ou mental, du fait d’être porteur du
VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable. |
Bien que le gouvernement ne fasse pas de recensement sur l'origine ethnique,
cet aspect demeure encore présent dans la Constitution adoptée par référendum le
8 mai 2018.
Pour le moment, le français reste la langue officielle de facto au
Burundi. C’est la langue de toutes les situations formelles et la grande
langue écrite, que ce soit à l’Assemblée nationale, à la Présidence, dans
les médias écrits et électroniques, les écoles, les universités, le
commerce international, etc.
Pour ce qui est de l’affichage public, les enseignes des organismes
gouvernementaux, administratifs, services de santé, etc., sont généralement
rédigées seulement en kirundi. Seuls les établissements d’enseignement ne
paraissent qu’en français. Quant aux plaques odonymiques (noms de rue), elles
sont en français à Bujumbura: par exemple, Rue de la Mission, Rue de
la Victoire, Boulevard du 28 novembre, Chaussée Peuple Murundi,
Avenue de l'Université, mais aussi Rue Buragane, Rue Makamba,
Rue Ruvubu, etc. À Kigali et dans plusieurs villes, les plaques sont
bilingues (français-kirundi).
4.2 Les langues du Parlement et de la justice
À l’Assemblée nationale, le français (surtout) et le kirundi constituent
les deux langues des débats, puis les lois sont rédigées en français,
parfois en kirundi. Dans les tribunaux, les juges utilisent la langue nationale,
le kirundi, avec les justiciables, mais rédigent leur compte rendu en
français. Les cours de haute instance n’utilisent en principe que le
français, mais les justiciables peuvent s’exprimer dans la langue de leur
choix; là aussi, les procès-verbaux ne sont rédigés qu’en français. Ainsi, la
loi n° 1/10 du 03 avril 2013 portant révision du Code de procédure
pénale mentionne que, dans l'impossibilité de «s'exprimer
dans la langue de la procédure», le Ministère public désigne un interprète à
charge du Trésor public:
|
Article 77
Si l'inculpé déclare être dans l'impossibilité de s'exprimer dans
la langue de la procédure, le Ministère public désigne un interprète
à
charge du Trésor public.
Article 195
Lorsque le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas
l'une des langues officielles utilisées par le tribunal ou s'il
s'avère nécessaire de traduire un document versé aux débats, le
président désigne d'office un interprète et lui fait prêter serment. |
L'article 195 utilise l'expression «l'une
des langues officielles utilisées par le tribunal», mais ne les désigne pas
formellement. Quant à l'article 286 de la
loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal, il
demeure tout aussi vague en recourant à la formule «dans une langue autre que
celle dont l'emploi [...] est prescrite par la loi»:
|
Article 286
Est puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une
amende de cinquante mille francs à deux cents mille francs, le
commerçant déclaré en faillite :
1° Qui n'a pas tenu les livres de commerce ou fait les
inventaires prescrits par les dispositions légales et
réglementaires ;
2° Dont les livres ou les inventaires sont incomplets,
irréguliers ou rédigés dans une langue autre que celle dont
l'emploi, en la matière, est prescrit par la loi ;
|
En somme, les lois burundaises traitent des langues
officielles, mais ne les mentionne jamais formellement, sauf dans la
Constitution. À l'heure actuelle, si le kirundi est reconnu formellement
comme la seule langue officielle et nationale, cette reconnaissance ne se
traduit pas dans les faits. En principe, l’usage de la langue officielle est
de rigueur dans tous les actes institutionnels. Ce n’est pas le cas du
kirundi puisque rares sont les textes juridiques et réglementaires qui sont
conçus, rédigés et diffusés dans cette langue. C’est plutôt le français qui
remplit davantage cette fonction dans les différentes institutions. À
l’Assemblée nationale et au Sénat, les textes règlementaires, les rapports
et les autres documents administratifs sont d'abord rédigés en français et
traduits ensuite en kirundi, le cas échéant. Même si la loi prescrit que
tout texte discuté au Parlement doit l’être à partir d’une version en
kirundi, cela na jamais été appliqué. Les discussions et les débats sont
menés en kirundi comme en français. Il en va de même des autres institutions
dont le Conseil des ministres.
4.3 L'administration publique
Dans les communications orales au sein de l'administration publique, les problèmes sont inexistants entre les
fonctionnaires et les services à la population, puisque tous les Burundais
parlent le kirundi. Ce sont les documents écrits qui font problème, car fort
peu de textes officiels sont disponibles en kirundi. Ainsi, la plupart des gens
ne peuvent lire ni formulaires, ni circulaires, ni règlements, etc., parce qu’ils
ne connaissent pas suffisamment le français. Les papiers officiels tels que les
passeports, cartes d’identité, monnaie, etc., sont rédigés dans les deux
langues officielles. De façon générale, la langue de travail entre les
fonctionnaires demeure le français. Cependant, le kirundi est resté la langue
orale des Forces armées burundaises contrôlées par les Tutsis. Dans les faits,
le français prédomine nettement dans l'Administration centrale, mais le kirundi
dans les administrations locales.
De façon générale, la conception du travail se fait en français,
bien que l’exécution soit en kirundi. C’est ainsi que les programmes des
ministères et les textes qui les régissent, ainsi que les autres documents
internes, sont conçus en français. Ils sont ensuite adaptés en kirundi chaque
fois qu'il est nécessaire de faire connaître l'information auprès des citoyens.
Dans les ministères, les réunions se font en français. La
plupart des documents, que ce soit les rapports, les programmes d’activités, la
correspondance administrative, etc., sont exclusivement rédigés en français. Les
seuls documents rédigés en kirundi concernent l’administration locale. La
correspondance administrative se fait presque exclusivement en français, sauf
dans les rares cas où la communication concerne le personnel non instruit. Dans
l'armée et la police, les ordres, les documents administratifs, les manuels de
formation, la correspondance officielle, etc., sont rédigés en français, quitte
à les adapter en kirundi lorsqu’il faut les communiquer oralement aux groupes
concernées.
Pour ce qui est de l’affichage public, les enseignes des organismes
gouvernementaux, administratifs, services de santé, etc., sont généralement
rédigées seulement en kirundi. Seuls les établissements d’enseignement ne
paraissent qu’en français. Quant aux plaques odonymiques (noms de rue), elles
sont en français à Bujumbura: par exemple, Rue de la Mission, Rue de
la Victoire, Boulevard du 28 novembre, Chaussée Peuple Murundi,
Avenue de l'Université, mais aussi Rue Buragane, Rue Makamba,
Rue Ruvubu, etc. Dans d'autres villes, elles peuvent être bilingues (français-kirundi).
Dans l'affichage public, l'article 14 de la
loi n° 1/ 02 du 11 janvier 2007 instituant le Code des douanes
est intéressant parce qu'il impose l'emploi des deux langues
officielles sur la façade des bureaux des douanes, sans les nommer :
Article 14
L'administration est tenue de faire apposer sur la façade de
chaque bureau, à un endroit très apparent, un tableau portant
cette inscription : «Douanes burundaises»- «Bureau de...» dans
les deux langues officielles avec les heures d'ouverture et de
fermeture. |
Enfin, la
loi n° 021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur
et des droits voisins au Burundi
protège les droits d'auteur dans «la langue originale», sans la mentionner
davantage:
|
Article 26
Nonobstant les dispositions de l'article 24, les utilisations
suivantes d'une œuvre protégée, soit en langue originale, soit en
traduction, sont licites sans le consentement de l'auteur:
1. s'agissant d'une œuvre qui a été publiée licitement ;
a) reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute
autre façon une telle œuvre, exclusivement pour l'usage personnel et
privé de celui qui l'utilise.
|
Il faut aussi comprendre que les communications orales se
font généralement en kirundi avec la population locale, car autant les
fonctionnaires que les citoyens tous parlent la langue nationale.
4.4 Les langues d'enseignement
À la suite des événements dramatiques qui ont secoué le Burundi depuis
plusieurs années (surtout depuis 1993-1994), le système scolaire s'est en
grande partie effondré. Beaucoup d’écoles ont été détruites ou
sérieusement endommagées, les autres ne fonctionnant que de façon partielle
en raison des dégâts matériels (par exemple, le mobilier scolaire ayant été
utilisé pour le chauffage) et de l’insécurité de la population. Souvent,
les bâtiments scolaires ont été «réquisitionnés» par les milliers de
personnes déplacées à la recherche d'un abri. Une bonne partie de la
population hutue est réfugiée dans les collines et s'est cachée durant des
années, et dans ce contexte de nombreux parents ont été réticents à envoyer
leurs enfants à l’école.
Pendant plus d'une décennie, environ un enfant sur deux n'a pas fréquenté l’école primaire et il semble
que les fillettes aient été encore plus exposées à ce genre d’exclusion. De plus, bien que la contribution financière demandée aux parents
pour l'école primaire soit relativement accessible — quelque 500 à 700
francs burundais (un dollar américain s’échangeant à 640 Fbu au taux
officiel —, c’était encore trop pour ceux qu’on appelle les «indigents».
Des directeurs d'école ont renvoyé chez eux les «élèves indigents» qui
n'avaient pas payé leur minerval (belgicisme désignant les «frais de
scolarité»), ce qui est contraire aux directives ministérielles qui
interdisent la discrimination à l'encontre des «enfants indigents». Toutes
ces difficultés ont entraîné une sous-scolarisation. Il en est résulté que
seulement 35,3 % des enfants burundais ont été alphabétisés, soit l’un des
plus bas de toute l’Afrique (contre 60,5 % au Rwanda voisin, 77,3 % au
Congo-Kinshasa, 51,7 % au Togo). Depuis quelque temps, le gouvernement burundais
a mis sur pied des «écoles temporaires» dans de nombreuses agglomérations
afin d’accroître la fréquentation scolaire. De plus, selon une étude de l'UNICEF
de 2002, il y aurait eu 10 577 enfants physiquement et mentalement handicapés au
Burundi avec diverses catégories de handicaps : défauts d'élocution,
traumatismes physiques liés à la guerre, maladies mentales, infirmités
physiques, cécité et surdité.
Rappelons que l’article 53 de la
Constitution de 2018 que les parents ont le droit et le devoir d'éduquer et
d'élever leurs enfants, et qu'ils sont soutenus dans cette tâche par l’État:
Article 53
1)
Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la
culture.
2)
L’État a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès.
3)
Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions
fixées par la loi. |
Cependant, lorsque les enfants burundais commencent à fréquenter l’école
primaire, il n’est pas dit qu’ils termineront leurs études. En effet,
seulement la moitié de la population mâle (52% des garçons) termine ses
études primaires, alors que c’est 32% pour les filles, parfois moins. Au
secondaire, quelque 10% des garçons commencent leurs études secondaires, et
seulement 3,6% pour les filles.
Dans le cadre de la Campagne appelée «Back to School 2012-2013», plus de 4000
enseignants de 572 écoles primaires de différentes provinces du Burundi ont
suivi du 6 au 18 août 2012 une formation sur le module «École amie des enfants».
Cette formation avait pour objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement
primaire au Burundi et de donner aux enfants toutes les chances de fréquenter
massivement l’école et d’y rester, afin d’achever leur cycle scolaire du
primaire dans les meilleures conditions d’apprentissage possibles. Avec
l’abolition des frais de scolarité au primaire décrétée par le gouvernement du
Burundi en 2005, le taux net de scolarisation a connu une progression
importante, car il est passé de 59% en 2005 à 96,1% en 2011, dont 97,6% pour
les garçons et 94,8% pour les filles.
Toutefois, les résultats concernant la réussite scolaire plaident en faveur
d’une nette amélioration de la qualité de l’enseignement. En effet, d'après
l'UNICEF, près de quatre enfants sur dix ont redoublé en 2011 et près d’un
enfant sur dix a abandonné ses études en cours d’année. Actuellement, seul un
enfant sur deux achève ses études primaires au Burundi, et à peine plus de 15 %
d’entre eux accèdent à l’enseignement secondaire, en majorité des garçons. Les
raisons les plus souvent invoquées comme ayant contribué à un si piètre résultat
sont les suivants: la grande pauvreté des parents, les violences sur le chemin
de l’école, le travail des enfants, les grossesses des filles et les mariages
précoces.
- Les types d'écoles burundaises
Au Burundi, on distingue quatre types d’écoles : les écoles publiques dites
d'État, les écoles publiques «sous convention», les écoles privées et les écoles
consulaires.
Les écoles publiques d'État sont celles qui sont sous la responsabilité de
l’État en ce qui concerne les infrastructures et les équipements, le salaire du
personnel et l’approvisionnement en matériel pédagogique comme les manuels
scolaires. Les écoles publiques «sous convention» sont des écoles publiques
administrées par les congrégations religieuses, mais l’État conserve la
responsabilité du personnel enseignant. Jusqu’ à présent, cinq congrégations
religieuses ont signé une convention avec l’État : l'Église catholique, l’Église
adventiste du 7e jour, la Communauté des
Églises de Pentecôte du Burundi, la Communauté islamique du Burundi et l'Église
évangélique des amis.
Quant aux écoles privées, elles sont gérées par des institutions privées et
sont normalement reconnues à la suite d'inspections réglementaires par les
services habilités au sein du ministère de l'Éducation. Cette reconnaissance
officielle repose sur la conformité avec les programmes publics, sauf que la
langue d'enseignement peut être le français, l'anglais ou le swahili, voire
l'arabe. Dans l’enseignement primaire, les écoles privées ne représentent
qu'environ 2 % de toutes les écoles, soit une quarantaine d'établissements.
Contrairement aux écoles dites «sous convention» qui sont réparties sur tout le
pays, les écoles privées sont presque toutes localisées à Bujumbura (87,5 %).
Voici ce que prescrivent les articles 13 et 14 de la
loi n° 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de
l'enseignement de base et secondaire sur cette question:
|
Article 13
Le système éducatif burundais comprend
l’enseignement public et l’enseignement privé.
L’enseignement public est un enseignement organisé par l’État ou par les
collectivités locales. L’enseignement sous le régime d’une convention scolaire
confessionnelle ou autre fait partie de l’enseignement public.
L’enseignement privé est un enseignement organisé par les établissements
scolaires créés par des personnes physiques ou morales, des associations ou des
fondations dotées de la personnalité civile, dans le respect des conditions et
normes fixées par le ministère ayant l’enseignement de base et secondaire dans
ses attributions.
Article 14
En vue d’une meilleure efficacité pédagogique
et/ou administrative, les pouvoirs publics peuvent gérer eux-mêmes les
établissements d’enseignement public ou les confier à des associations à
vocation éducative moyennant une convention. Tous les établissements
d’enseignement public et privé sont soumis à un régime d’inspection et de
contrôle. |
Pour ce qui est des écoles consulaires, ce sont des écoles organisées par les
représentations diplomatiques : elles fonctionnent généralement selon le régime
pédagogique des pays d’origine de ces représentations. Ce sont des cas
d'exception, selon l'article 2 de la
loi n° 1/19 du 10 septembre 2013:
|
Article 2
La présente loi s’applique aux écoles
publiques et privées y compris celles qui sont ouvertes à l’étranger et dont les
programmes d’enseignement sont conformes au système éducatif burundais.
Les écoles établies par les missions diplomatiques et consulaires constituent
des exceptions. Les modalités de leur agrément et de leur fonctionnement sont
fixées par le Ministre en charge des relations extérieures. |
Il n'existe que quelques écoles «consulaires», qui sont sous
la juridiction de la France, de la Belgique, du Congo-Kinshasa et de la
Tanzanie. Les langues d'enseignement peuvent être le français, l'anglais ou
le swahili, et toute autre langue autorisée par le gouvernement burundais,
mais en principe ces écoles sont indépendantes et payées par le pays
concerné.
- Le kirundi comme langue d'enseignement
En vertu de l'article 11 de la
loi n° 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de
l'enseignement de base et secondaire, les langues d'enseignement
sont le kirundi, le français, l'anglais et le swahili (ou kiswahili):
|
Article 11
La maîtrise de la langue nationale et la connaissance
d'autres langues font partie des objectifs fondamentaux
d'enseignement.
Le kirundi, le français et l'anglais sont des langues
d'enseignement.
Le kirundi, le français, l'anglais et le kiswahili sont des
langues enseignées.
D'autres langues peuvent être introduites par la loi.
|
Cependant, ces quatre langues n'ont pas le même statut et
elles ne sont pas enseignées de façon équivalente. Le kirundi, on le sait, est la langue maternelle de la
grande majorité des Burundais. Dès 1973, le gouvernement burundais avait
entrepris la “kirundisation” de l'enseignement dans les programmes
scolaires. Dès lors, le kirundi devait devenir la seule langue
d'enseignement dans toutes les écoles primaires publiques, renvoyant le
français au statut de «langue étrangère». Cette politique de kirundisation
demeure encore en vigueur, mais uniquement durant les quatre premières
années de l’école primaire.
L'article 29 de la
loi n° 1/19 du 10 septembre 2013 énonce que «dans les écoles maternelles et les structures communautaires,
les apprentissages se font en kirundi et/ou en d'autres langues
reconnues par la loi, mais en respectant le programme national de
référence». De fait, le kirundi est la seule langue
d'enseignement des écoles maternelles publiques.
Selon la réglementation scolaire du Burundi, l’âge
d’admission en première année de l’école primaire est de sept ans. Comme la
durée du niveau primaire est de six ans, une scolarisation normale devrait
se terminer à 12 ans avant d'entreprendre le secondaire, mais à cause des
nombreux redoublements la scolarisation primaire peut se terminer à 13 ou 14
ans au terme de laquelle l'élève passe le concours d'accès au secondaire.
Cela signifie aussi que l'enseignement généralisé en kirundi ne dure que
quatre ans pour devenir une matière d'enseignement.
Dans les établissements privés et consulaires, le français est
prédominant, ainsi que l'anglais pour les confessions protestantes.
- Le français
Dans les écoles publiques, à partir de la cinquième année du
primaire, le français remplace progressivement le kirundi, mais le maître
peut à tout moment expliquer les notions difficiles en kirundi. Au
secondaire et dans tout l'enseignement supérieur, le français demeure la
principale langue d’enseignement, en dépit de l'article 81 de la
loi n° 1/19 du 10 septembre 2013 :
|
Article 81
À l'exception des langues enseignées, la langue
d'enseignement au secondaire est le français, l'anglais ou toute
autre langue qui sera fixée par la loi.
Les langues enseignées dans l'enseignement secondaire sont : le kirundi ;
le français ;
l'anglais ;
le kiswahili.
Les cours à enseigner en plus des langues sont définies par
décret.
|
Pendant que le français devint la seule langue
d'enseignement pour environ dix heures de cours par semaine, le kirundi est
enseigné durant deux heures comme discipline. Il en est ainsi pour les
programmes de formation professionnelle (art. 115 de la de la
loi n° 1/19 du 10 septembre 2013):
|
Article 82
Les objectifs d'enseignement, les contenus des programmes,
les méthodes d'enseignement, les volumes horaires, les supports
pédagogiques, les activités d'évaluation ainsi que le certificat
et le diplôme à délivrer pour toute section d'enseignement
secondaire sont fixés par décret.
Article 115
Les programmes de la formation professionnelle sont dispensés
dans la langue française ou toute autre langue que tous les
apprenants peuvent comprendre aisément. |
Cependant, dans la grande majorité des cas, les écoles
privées utilisent le français comme langue d’enseignement depuis la première
année du primaire.
Selon le Rapport PASEC en
matière d'enseignement primaire (2010), un test appelé MLA (Monitoring
and Learning Achievment) a été administré en 2002 à 2199 élèves.
L'évaluation s'est déroulée dans les trois domaines classiquement proposés
par cette enquête internationale : le français, les mathématiques, la vie
courante, mais un quatrième domaine a été ajouté, à savoir le kirundi, car
cette langue nationale est aussi la langue d’enseignement de la première
année à la quatrième année primaire. Au plan des disciplines évaluées, les
élèves ont obtenu de très bons résultats en kirundi avec une moyenne de 75,7
%, et en «vie courante» (69,2 %), avec des résultats relativement faibles en
mathématiques (52, 6 %) et de mauvais résultats en français (44,7 %). En
somme, le français, langue d’enseignement à partir de la 5e année, semble
donc peu maîtrisé. Le seuil minimal de maîtrise apparaît comme très bon pour
la «vie courante» (96,1 %) et le kirundi (92.9 %), mais moyennement bon en
mathématiques (60 %), et très mauvais en français (34 %), ce qui semble
inquiétant. D’ailleurs, beaucoup d'enseignants ne parlent pas très bien le
français, une langue que beaucoup ne maîtrise que difficilement. Un ancien
rapport de l’UNICEF signale que la plupart des enseignants maîtrisent mal le
français parlé. Ensuite, très peu de familles parleraient le français comme
langue d’échange à domicile.
Dans
beaucoup d'écoles secondaires, il est encore obligatoire pour les élèves de
s'adresser aux enseignants en français, car cela les oblige à améliorer leur
niveau d'expression. Cependant, comme la plupart des élèves ne terminent pas
leurs études secondaires, très peu d’entre eux réussissent à apprendre
convenablement le français. Précisons que le kirundi est néanmoins enseigné
en tant que matière jusqu’à la fin des «humanités» (belgicisme désignant
la fin du lycée).
Par contre, le niveau de performance des élèves des
établissements privés apparaît nettement meilleur en français que celui des
élèves des écoles publiques. Cette situation peut s’expliquer par le fait
que, dans les écoles privées, le français est la langue d’enseignement dès
la première année du primaire.
- L'anglais et le swahili
Dans certaines écoles urbaines (surtout à Bujumbura), depuis
2005, l'anglais a été introduit pour être enseigné comme langue étrangère en
raison de trois à quatre heures par semaine au secondaire. Le ministère de
l'Éducation a également mis en place des cours intensifs de français et
d'anglais dans un certain nombre d’écoles secondaires. Pour le moment, ces
élèves reçoivent en moyenne trois ou quatre heures d’anglais par semaine
durant six ans. À plus long terme, il est prévu que les élèves burundais
puissent s'exprimer en français et en anglais. Pour le moment, il y a loin
de la coupe aux lèvres, car il faut faire face à la grave pénurie du corps
professoral apte à enseigner l'anglais. Or, cette langue demeure peu
enseignée dans les écoles secondaires pour diverses raisons, dont le manque
de formation des enseignants et la non-implication financière des pays
anglophones dans cet enseignement. Il semble bien difficile de demander à un
enfant d'apprendre une langue que le maître lui-même ne maîtrise pas. Bien
souvent, les enseignants ont reçu une formation de deux semaines à la fois
en anglais et en swahili pour ensuite enseigner ces deux langues.
En février 2014, le gouvernement a instauré un
nouveau programme d'anglais et de swahili dès le primaire. En
général, la tendance est de retirer deux heures hebdomadaires au
cours de kirundi et de français et une heure au calcul, pour les
attribuer au swahili et à l'anglais.
|
2007 |
Kirundi |
Français |
Anglais |
Swahili |
Calcul |
|
1re
année |
8 h |
8 h |
2 h |
2 h |
8 h |
|
2e
année |
8 h |
8 h |
2 h |
2 h |
8 h |
|
3e
année |
4 h |
8 h |
2 h |
2 h |
9 h |
|
4e
année |
4 h |
8 h |
2 h |
2 h |
9 h |
|
5e
année |
4 h |
13 h |
0 h |
0 h |
10 h |
|
6e
année |
4 h |
3 h |
0 h |
0 h |
10 h |
Cette réforme a soulevé beaucoup de controverses
dans les milieux de l'éducation, le débat portant
essentiellement sur la capacité d'un enfant de sept ans à
maîtriser correctement quatre langues à la fois au cours de sa
scolarité primaire, alors qu'il ne sait même pas encore écrire
dans sa langue maternelle. Certains
éducateurs s'opposent à l'introduction de ces deux nouvelles
langues, en raison notamment du manque de matériel didactique et
de la formation de courte donnée aux enseignants; ils critiquent
également la précipitation de la décision du gouvernement qui
n'aurait jamais consulté ni les enseignants ni les responsables
de l'éducation.
Cependant, le
Décret n° 100/078 du
22 mai 2019 portant fixation des langues d'enseignement et
échelonnement des langues enseignées à l'école fondamentale
est venu changer la donne:
Article 2
Les langues d'enseignement sont le kirundi et le français. L'anglais
peut devenir une langue d'enseignement pour les écoles où les
conditions exigées sont remplies. Ces conditions seront précisées
dans une ordonnance ministérielle.
Article 4
Le kirundi est la langue d'enseignement aux premier et deuxième
cycles de l'enseignement fondamental sauf pour les mathématiques qui
sont enseignées en français dès la quatrième année.
Article 5
Le français est la langue d'enseignement à partir du troisième cycle
du fondamental sauf pour l'Entrepreneuriat, Sciences humaines, Arts
et EPS qui sont enseignés en kirundi.
Article 6
Le kirundi et le français sont des langues enseignées à partir de la
première année de l'enseignement fondamental tout en respectant les
spécificités de l'apprentissage de chaque langue.
Article 7
L'anglais est enseigné à partir de la troisième année de
l'enseignement fondamental.
Article 8
Le kiswahili est enseigné à partir de la cinquième année de
l'enseignement fondamental. |
Ainsi, quatre langues font partie de l'enseignement comme
discipline: le kirundi, le français, l'anglais et le kiswahili. Évidemment,
il s'agit là d'un programme ambitieux de la part d'un pays qui ne fait pas
partie des nations riches, car l’enseignement des quatre langues, à savoir
le français, le kirundi, l’anglais et le kiswahili, rend complexe le
parcours scolaire et la progression des apprentissages. L'un des défis
auxquel le gouvernement doit faire face est, entre autres, la faible
maîtrise des langues par les enseignants, particulièrement l’anglais et le
kiswahili, ainsi que l’absence de préalables suffisants chez les
enseignants. La formation des enseignants ne les a pas préparés à
l'’enseignement multiple des langues.
En fonction de tous ces défis, le Conseil des ministres a
décidé qu’en première année le kirundi à l’écrit et le français à l’oral
seront enseignés, et que ce dernier sera enseigné avec recours à l’écrit à
partir de la deuxième année. L’anglais sera intégré à partir de la troisième
année, d’abord à l’oral, puis à l’écrit à partir de la cinquième année et le
kiswahili sera introduit en cinquième année à l’oral avant une intégration
de l’écrit en sixième année. De plus, une transition linguistique de
l’enseignement du kirundi au français dans les disciplines des mathématiques
et des sciences et technologies doit débuter à partir de la quatrième année,
pour préparer l’enfant à l’enseignement en français à partir de la cinquième
année.
- L'enseignement
supérieur
Dans l’enseignement
supérieur, c’est le français qui est le véhicule exclusif de
l’enseignement. L’anglais est une matière enseignée dans les
différents facultés et instituts de l’enseignement supérieur,
généralement dans les premières années. Il existe des unités de
formation à l’Université du Burundi et à l’École normale
supérieure, où cette langue est utilisée comme véhicule du
savoir. Le kiswahili est aussi enseigné comme matière à la
Faculté des lettres et sciences Humaines, au Département des
langues et littératures africaines, mais de façon très sommaire.
Créée en 1964, l’Université du Burundi à Bujumbura est l’unique université
publique; elle compte actuellement plus de 13 000 étudiants répartis dans huit
facultés et trois instituts. Dans l'enseignement supérieur,
le français sert de langue d’enseignement, sauf dans les programmes de langues étrangères. Ainsi, le Département
de langue et littérature anglaise de la faculté des lettres et sciences
humaines offre, depuis plus de trente ans, un programme de formation en anglais
d’une durée de quatre ans destiné généralement aux futurs enseignants en
anglais (écoles secondaires).
Il existe aussi l'École normale supérieure, qui a été
créée en 1965, afin de former les enseignants de l’école secondaire. Fusionnée
avec l’Université du Burundi, elle est devenue une structure indépendante en
décembre 1999. Elle compte trois départements: «Langues et Sciences humaines»,
«Sciences naturelles» et «Sciences appliquées». En 2013, l'Université du Burundi
a mis en place un nouveau département de kirundi-swahili à l'Institut de
pédagogie appliquée (IPA).
4.5 Les médias et la vie économique
Des quelque 40 titres de journaux paraissant entre août 1991 et juin 1996,
seuls quatre continuent de paraître régulièrement aujourd'hui. Il s'agit du
quotidien national de langue française Le Renouveau du Burundi,
propriété de l'État, de l'hebdomadaire privé d'information et d'analyse L'Avenir
publié depuis le 1er juillet 1997, de l'hebdomadaire en langue
kirundi Ubumwe diffusé par l’État et du bimensuel Ndongozi y'Uburundi
appartenant à l'Église catholique. Subsistent aussi d'autres journaux à
parution fort irrégulière, comme le bimensuel privé Le Patriote. De
façon générale, la presse écrite reste contrôlée de près par le
gouvernement. Plusieurs titres de périodiques paraissent en kirundi. Ainsi,
les quelques journaux qui paraissent régulièrement au Burundi sont édités en
français, et dans une moindre proportion, en kirundi.
L'espace audiovisuel est occupé par trois radios et une télévision
privées. Ainsi, à côté de Télé 10 Burundi (français, anglais,
swahili, etc.), émettent Radio-Culture (français), Radio-Umwizero
ou Radio de l’Espoir (kirundi, swahili et français) et Radio-CCIB
FM+ (français). Des radios internationales comme la British
Broadcasting Corporation (anglais et kirundi), et la Voix de l’Amérique
(français et kirundi), sont présentes sur la bande FM, ainsi que Radio
France Internationale qui n’émet qu’en français.
Une chaîne de la radio nationale au Burundi diffuse en kirundi et une autre en
français. Les radios privées diffusent, en plus du kirundi et du français,
également en swahili et en anglais. Dans la télévision burundaise, le kirundi et
le français ont une importance approximativement égale. Le Burundi accorde donc
une place relativement importante à la langue nationale, parlée par toute la
population.
En ce qui a trait à la vie économique,
les Burundais sont très pragmatiques. Dans la vie quotidienne, le kirundi et le
swahili à Bujumbura sont les langue des affaires et des communications
normales. Dans les contacts plus formels, le français est privilégié, mais le
swahili (à Bujumbura) et l’anglais peuvent aussi servir de langue
véhiculaire. Les enseignes commerciales dans le centre-ville de Bujumbura sont
généralement en français, mais il en existe également en anglais ou en
swahili, les deux premières langues se disputant la préséance. Les
affichettes des petits commerçants dans les centres urbains sont rédigées
plutôt en swahili, la langue des affaires par excellence, mais à l’intérieur
du pays elles sont en kirundi. Le français reprend ses droits sur les chantiers
de construction, les affiches indiquant le nom du propriétaire, l'entreprise de
construction, le maître d'œuvre, le financement du projet, etc. À l’entrée
des usines, du port ou de l'aéroport, tout paraît en français.
Dans le Code de commerce
(2010), l'une des rares lois réglementant les langues dans le monde
du commerce et des affaires, impose aux commerçants de tenir leurs livres «soit en
kirundi, soit en français, soit en toute autre langue déterminée par
la loi»:
|
Article 27
Tout commerçant doit tenir une
comptabilité régulière qui fait état de ses opérations commerciales
et de sa situation de fortune conformément au plan comptable
national.
À ce titre, le commerçant tient
notamment les livres de commerce suivants :
1° Un livre journal qui comprend
les livres d'achats et les livres de recettes avec toutes les
pièces justificatives ;
2° Un livre des inventaires qui retrace sa situation
patrimoniale.
Le commerçant est tenu de garder copie
des factures, pièces justificatives, lettres, télégrammes et
transmissions télégraphiques, par fac-similé ou électronique se
rapportant à son commerce qu'il envoie, ou qu'il reçoit et de les
classer régulièrement. Ces livres devront être tenus
soit en kirundi, soit en français, soit en toute autre langue déterminée par
la loi. Par dérogation à l'alinéa précédent, des documents
informatiques peuvent tenir lieu de livre journal et de livre
d'inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés
et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute
garantie en matière de preuve.
L'authenticité des documents
électroniques se fait selon les mécanismes de cryptographie publique
ou de cryptographie asymétrique ou d'autres technologies conformes à
un ensemble d'exigences minimales généralement reconnues dans le
commerce international.
|
Il n'existe guère d'autres langues déterminées par la loi.
4.6 Le monde de la Francophonie
Le Burundi est membre de l'Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) depuis 1970. De façon générale, la francophonie semble relativement mal perçue au Burundi, comme
d'ailleurs au Rwanda. La France aurait joué un
rôle suspect lors des événements reliés au
génocide de 1994 au Rwanda. Quant aux évêques catholiques, ils semblent
complètement indifférents à la Francophonie internationale. L’Église du
Burundi, l’une des grandes puissances économiques du pays, entretient même
des relations vieilles de plusieurs décennies avec les Églises d'Angleterre,
de Suède, de Norvège, des USA, etc., c’est-à-dire des relations
privilégiées avec le monde chrétien anglophone ou anglophile.
N'oublions pas que 90 % des Burundais ne connaissent pas le français. Tous ces
facteurs vont donc peser lourdement sur l'avenir de la francophonie burundaise...
ou ce qu’il en reste. On estime qu'en 2010 quelque 682 000 Burundais pouvaient
s'exprimer en français à des degrés divers. Le poids de l’histoire et la force de l’inertie
laisseraient croire que le français pourrait conserver ses anciennes
prérogatives. Toutefois, plusieurs considérations actuelles portent à penser
que c’est le français qui pourrait bien être évincé.
On assisterait actuellement dans la région des Grands Lacs
à une «offensive américano-britannique» afin d’y imposer l’anglais. Or,
on sait que, une fois que l’anglais est admis comme langue officielle au sein
d’une organisation internationale ou nationale, les Américains, souvent
aidés des Britanniques, font tous les efforts nécessaires pour éliminer les
autres langues qui ne deviennent que des véhicules de traduction. Pensons à ce
qui se passe présentement au Rwanda et au Congo-Kinshasa, alors qu’on essaie
subtilement de faire entrer le «loup dans la bergerie» (l’anglais). Mais
voilà que la Belgique semble maintenant vouloir renouer avec ses anciennes
colonies au moment où les Anglo-Saxons envahissent le Burundi, le Rwanda et le
Congo-Kinshasa. Comment la Belgique va-t-elle recoller les morceaux pour
récupérer l’espace économique en détresse et l’influence culturelle
perdue? De toute façon, l’«invasion de l’anglais» au Burundi est loin d’être
avancée et sa situation ne se compare pas à celle du Rwanda.
Avant 1992, le français et le kirundi étaient considérés comme
les langues officielles du Burundi. Selon l’article 10 de la Constitution de
1992, les langues officielles sont le kirundi et les autres langues déterminées
par la loi. L’article 9 de la
Constitution de 2004
reprend les dispositions de la Constitution de 1992, et ajoute que tous les
textes législatifs doivent avoir leur version originale en kirundi. Si l’on s’en
tient strictement aux dispositions constitutionnelles, l’officialité n’est
reconnue qu’au kirundi. Cependant, le français demeure de facto l’une des deux
langues officielles.
Le 28 novembre 2014, à Dakar, en marge du XVe
Sommet de la Francophonie, un Pacte
linguistique entre la Francophonie et la république du Burundi (2014) a été
signé par Abdou Diouf et le président burundais Pierre Nkurunziza. Cet accord,
qui lie les deux parties jusqu’à fin 2018, porte sur plusieurs aspects,
notamment le renforcement de l’enseignement du français dans le système éducatif
et de l’offre de formation des professeurs, un meilleur accès à des produits
culturels et des médias francophones, la promotion de la langue française dans
la sous-région, etc.

On peut résumer la situation au Burundi en affirmant que le
kirundi est la langue de communication entre les dirigeants et le citoyen. Les
discours et les réunions à l’intention de la population rurale se tiennent en
kirundi. Le français, quant à lui, bien que parlé et compris par très peu de
Burundais (moins de 15%), reste essentiellement la langue de l’administration,
de l’enseignement et des relations internationales. Les deux autres langues
parlées au Burundi sont le swahili et l’anglais, mais le nombre de leurs
locuteurs est très restreint et les occasions d’usage fort limitées.
Rappelons que la situation géographique du Burundi le situe
à la «frontière» des pays francophones et anglophones, la «ligne Maginot
linguistique» dit-on, ce qui rend ce petit pays plus vulnérable à l’influence
de l’anglais. Bien qu’il ait été traditionnellement un «pays
francophone», le Burundi subit depuis plusieurs années les assauts de l’expansion
anglophone de la part du Rwanda, de la Tanzanie, de l’Ouganda, mais aussi du
Royaume-Uni et des États-Unis, et ce, dans la mesure où la Belgique semble avoir
abandonné depuis plusieurs années son ancienne colonie. L’hypothèse du «complot anglo-saxon» occupe
depuis longtemps les esprits, du moins si l’on en croit les propos tenus en
1957 par l'ex-président français François Mitterrand, alors qu'il était
ministre de la Justice (cabinet Guy Mollet): «Tous les ennuis que nous avons
eus en Afrique occidentale française n’ont rien à voir avec un désir d’indépendance,
mais avec une rivalité entre les blocs français et britannique. Ce sont des
agents britanniques qui ont fomenté tous nos ennuis.» À supposer que le
complot soit réel, il y a plus grave!
Selon un observateur de Médecins sans frontières, voilà
plusieurs années, soit depuis 1990, que les Britanniques rêvaient de supplanter les
Français et les Belges dans la région des Grands Lacs. Depuis la fin de la
guerre froide, l'Afrique est même devenue plus «visible» pour les
États-Unis, et les relations bilatérales que la France a longtemps entretenues
avec de nombreux pays du continent s'en trouvent ainsi profondément modifiées
(lire «diminuées»). D’ailleurs, en mars 1998, le voyage en Afrique du
premier président américain (Bill Clinton) à visiter ce continent est venu
encore confirmer que les «terres francophones» s'ouvrent maintenant à la
compétition politique, économique et culturelle. La preuve en est que
maintenant ce sont les Américains qui soutiennent militairement le Burundi, et
ce, de manière très active. En 2012, le Burundi a introduit une demande
d'adhésion au Commonwealth, cette association anglophone d'anciennes colonies ou
protectorats de l’Empire britannique. Il s’agissait du second pays de la régions
des Grands Lacs, traditionnellement francophone, à faire une telle demande, le
Rwanda ayant déjà été admis comme 54e membre du
Commonwealth en 2009. Puis le Burundi a retiré sa demande de candidature.
Si l’on fait exception des rivalités entre langues
coloniales, le Burundi n'a pas de réels problèmes avec ses minorités
linguistiques, car il s'agit avant tout de minorités ethniques. Au plan
de la politique linguistique, ce sont des problèmes de préséances
linguistiques coloniales ou ethniques (entre Tutsis et Hutus). Le Burundi n'est
pas le seul État au monde à connaître ce genre de difficultés ethniques —
pensons au Rwanda, à l'Afrique du Sud, à l'Éthiopie, à l'Érythrée, etc.
—, mais ce pays semble pour le moment incapable de trouver des solutions qui
exigent la participation de toutes les couches de la population à la gestion du
pays.
Compte tenu de la situation du Burundi, on pouvait s'attendre à ce
que, dans un avenir assez proche, le gouvernement burundais, à l'instar du
Rwanda, proclame trois langues officielles, à savoir le kirundi, le français et
l'anglais. Cette politique éventuelle a pour objectif de garantir à la fois
un enracinement culturel dans le milieu avec le kirundi et l’ouverture sur le
monde avec le français et l'anglais. Pour beaucoup de dirigeants burundais,
l'option de faire coexister les deux langues internationales permet de
bénéficier des possibilités offertes par l’une et l’autre, et de répondre
efficacement aux sollicitations géopolitiques du continent africain et du reste
du monde. Ce que l'on ne dit pas, c'est que le kirundi ne peut concurrencer le
français, mais face à l'anglais le français pourrait perdre des plumes.
Cependant, ce ne serait pas au profit du kirundi, qui s'affaiblirait encore
davantage. Seul 'anglais en sortirait gagnant en prenant progressivement un rôle
accru dans les tribunaux, l'enseignement primaire et seconde, surtout dans
l'enseignement supérieur, ainsi que dans les médias et les communications
internationales. À long terme, le Burundi perdra une partie de son identité liée
au monde francophone depuis plus d'un siècle de cohabitation. Dans les faits, la
seule façon d'éviter la concurrence des langues internationales, c'est de les
évincer totalement. Dès lors, le Burundi serait condamner à l'isolement, un prix
lourd à payer pour survivre.
Dernière
mise à jour:
20 août 2025
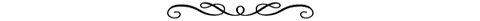
|
BIBLIOGRAPHIE ANONYME. «Bonne gouvernance et gestion des conflits au
Burundi», sans lieu ni date,
[http://www.undp.org/rba/special/frnagfiii/burund3f.htm].
ACQUIER, Jean-Louis. Le Burundi, Éditions
Parenthèses, Marseille, 1986, 126 p.
ASSEMBLÉE NATIONALE. Rapport d'information de la
Mission d'information de la commission de la Défense nationale et
des Forces armées et de la commission des Affaires étrangères,
sur les opérations militaires menées par la France, d'autres pays
et l'Onu au Rwanda entre 1990 et 1994, Paris, 15 décembre
19998, [http://www.assemblee-nationale.fr/2/dossiers/rwanda/r1271.htm].
BEN HAMMOUDA, Hakim. Burundi, Histoire
économique et politique d’un conflit, Éditions L’Harmattan,
Paris, 1995, 203 p.
CHRÉTIEN, Jean-Pierre. «Interprétations du génocide
de 1994 dans l’histoire contemporaine du Rwanda» dans Clio en
Afrique, Paris, été 1997, [ http://up.univ-mrs.fr/~wclio-af/numero2/sources/index.html].
COUVERT, Claude. La langue française au
Burundi, IRAF, Paris 1985, 162 p.
DE L’ESPINAY, Charles. «Les Églises et le génocide
dans la région des Grands Lacs est-africains», Paris, sans date, [ http://www.u-paris10.fr/gdr1178/lesp-egl.htm].
ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS. Art. «Burundi», sans lieu ni date,
[ http://www.universalis-edu.com/doc/atlas/Articles/C933811_1.htm].
FREY, Claude. Le français au Burundi,
lexicographie et culture, EDICEF, Paris 1996, 223 p.
GAHAMA, Joseph. Le Burundi sous administration
belge, 1919-1939, Éditions Karthala, Paris, 1983, 465 p.
MWOROHA, Émile. Histoire du Burundi, des
origines à la fin du XIXe
siècle, Éditions Hatier, Paris, 1987, 275 p.
NYABUHINJA, Théodore. «Statut et interaction des
principales langues parlées au Burundi» dans Dire, n° 4,
Limoges, 1992, p. 19-27.
RÉPUBLIQUE DU BURUNDI.
Rapport PASEC, enseignement primaire:
quels défis pour une éducation de qualité; en 2015?, ministère
de l'Enseignement de base et Secondaire, de l'Enseignement des
métiers, de la Formation professionnelle et de l'Alphabétisation,
Bujumbura, 2010, 164 p.
WILLAME, Jean-Claude. Les Belges au Rwanda, le
parcours de la honte, Bruxelles, GRPI/Complexe, 1997, 216 p.
|