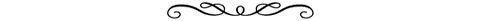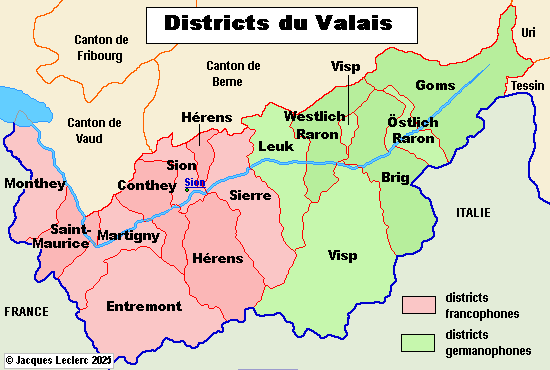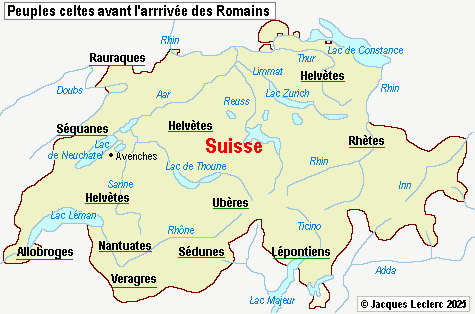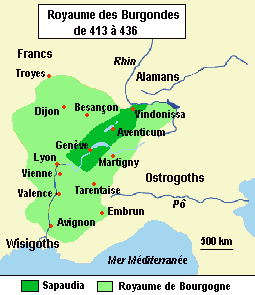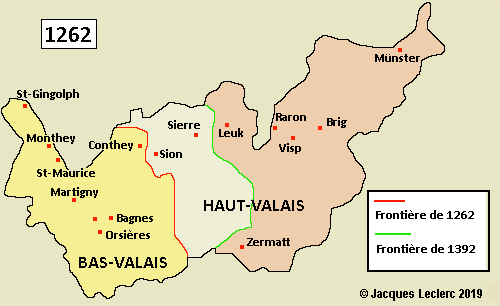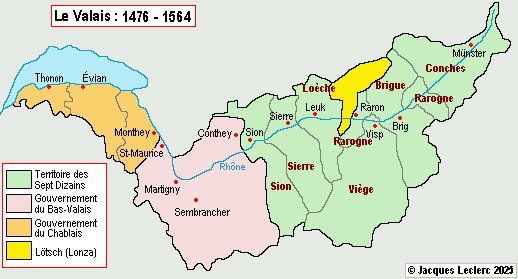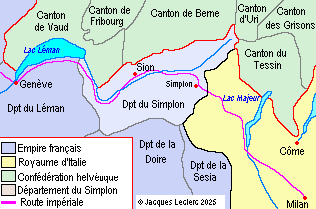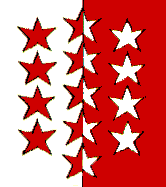
|
Canton
du Valais / Wallis
(Confédération
suisse)
|
|
Canton du Valais
Kantons Wallis |
|
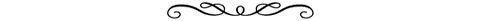
Plan de l'article
1 Situation géographique
1.1 L'organisation administrative
1.2 L'organisation politique
2 Données
démolinguistiques
2.1 La répartition linguistique
2.2 Les francophones
2.3 Les germanophones
2.4 Les langues étrangères
3 Bref historique du
Valais
3.1 Les Celtes
3.2 La romanisation
3.3 La Sapaudia et le franco-provençal
3.4 Le Valais après le traité de Verdun
3.5 La Maison de Savoie |
3.6 La
mainmise du Haut-Valais
3.7 Les divisions confessionnelles
3.8 La Révolution française
3.9 Le 20e canton suisse
4 Les
dispositions constitutionnelles
4.1 La Constitution actuelle
4.2 Les projets de réforme avortés
5 La
politique linguistique du Valais
5.1 Les langues de la législation et de la réglementation
5.2 Les langues de la justice
5.3 Les langues de l'administration cantonale
5.4 Les langues de l'éducation
5.5 Les médias |
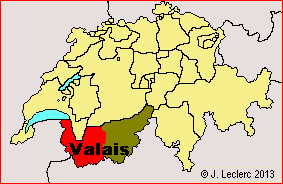
|
Le canton du Valais (en allemand: Wallis)
est l'un des cantons les plus grands de la Suisse avec 5224 km²; c'est
aussi un canton-frontière parce qu’il est situé au sud-ouest de la
Suisse. Il est limité au nord par le lac Léman, le canton de Vaud et
le canton de Berne, à l’est par les cantons d’Uri et du Tessin, au
sud par l’Italie, à l’ouest par la France (voir
la carte des 23 cantons).
La capitale du canton, Sion (en allemand: Sitten),
est une ville de quelque 89 900 habitants, sise dans le Bas-Valais, la partie
occidentale canton. À l’exemple des cantons de Berne et de Fribourg, le canton
du Valais constitue l’un des trois cantons officiellement bilingues
(français-allemand) de la Confédération suisse.
|
1.1 L'organisation administrative
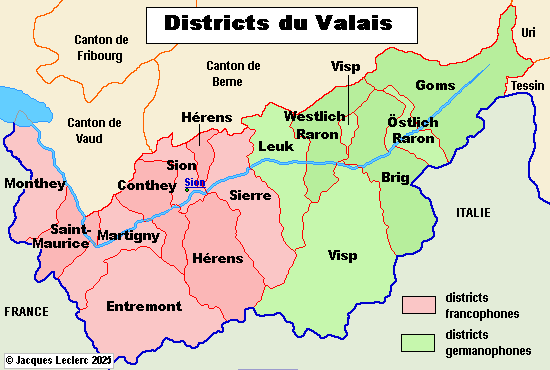 |
Le canton compte en principe 13 districts, un héritage des
«dizains»
(en allemand: Zenden) ou divisions territoriales historiques provenant de l'Ancien Régime:
- Districts francophones
(occidentaux): Conthey, Entremont, Hérens, Martigny, Monthey, Saint-Maurice, Sierre et Sion;
- Districts germanophones (orientaux):
Brig (fr. Brigue), Goms (fr.
Conches), Leuk (fr. Loèche), Östlich Raron (fr. Rarogne
oriental), Visp (fr. Viège), Westlich Raron (fr. Rarogne occidental);
les districts de Westlich Raron et d'Östlich Raron sont en fait des
demi-districts, ce qui correspondrait à 13 districts au total.
Dans la carte de gauche, les districts sur fond rouge sont
francophones, alors que les districts sur fond vert sont germanophones.
On dénombre aussi quelque 122 communes.
Les six villes les plus importantes du canton du Valais sont Sion, Sierre, Martigny et
Monthey pour le Bas-Valais, et Viège et Brigue pour le Haut-Valais.
|
Le canton du Valais est divisé en trois arrondissements pour l'organisation
de ses services, notamment pour la construction et l'entretien des routes,
des cours d'eau, et du lac Léman. Ces
arrondissements sont les suivants
: le Haut-Valais, le Valais central et le
Bas-Valais. Chaque
arrondissement est dirigé par un chef d'arrondissement et comprend plusieurs
secteurs d'entretien.
1.2 L'organisation
politique
La Confédération suisse donne une large
autonomie aux cantons suisses. Chacun des cantons dispose d'une constitution
propre, d'un parlement, d'un gouvernement, de tribunaux et de sa fonction
publique. Les droits politiques peuvent aussi varier d'un canton à l'autre,
voire d'une commune à l'autre. Comme les autres cantons, le Valais dispose
de larges prérogatives en ce qui concerne l'éducation et la formation, la
santé, l'aide sociale, l'organisation de la justice, la police ou les
transports; le canton lève aussi des impôts et des taxes.
Le pouvoir législatif est exercé par le Grand Conseil, l'autorité suprême en
Valais, sous réserve des droits du peuple des attributions des cantons,
selon la Constitution fédérale. En plus de la législation, le Grand Conseil
est chargé d'élire les membres les juges au Tribunal cantonal. Le Grand
Conseil est un parlement unicamériste, composé de 130 députés et de 130
députés-suppléants élus pour 4 ans à la biproportionnelle. Il doit élire
pour un an parmi ses membres un président ainsi qu'un premier et un second
vice-présidents.
Le pouvoir exécutif est exercé par le
Conseil d'État, formé de cinq membres, élus pour un mandat de quatre ans, au
suffrage universel, par un scrutin majoritaire à deux tours.
En terme de population, ce sont les districts de Martigny (52 410), de Sierre
(51 445), de Sion (50 795) et de Monthey (50 414), qui sont les plus populeux,
donc des districts francophones.
|
District |
Chef-lieu |
Population (2023) |
Superficie |
Communes |
|
Brigue |
Brigue-Glis |
28 713 |
434,26 km² |
7 |
|
Conthey |
Conthey |
30 873 |
234,26 km² |
5 |
|
Entremont |
Sembrancher |
16 169 |
633,03 km² |
5 |
|
Conches |
Goms |
4 426 |
588,11 km² |
8 |
|
Hérens |
Vex |
11 455 |
465,60 km² |
6 |
|
Loèche |
Loèche |
13 317 |
336,01 km² |
12 |
|
Martigny |
Martigny |
52 410 |
263,35 km² |
10 |
|
Monthey |
Monthey |
50 414 |
256,72 km² |
9 |
|
Rarogne occidental
(Westlich) - demi-district |
Rarogne |
8 208 |
270,90 km² |
11 |
|
Rarogne oriental
(Östlich) - demi-district |
Mörel-Filet |
3 235 |
127,16 km² |
6 |
|
Saint-Maurice |
Saint-Maurice |
14 708 |
190,62 km² |
9 |
|
Sierre |
Sierre |
51 445 |
418,50 km² |
10 |
|
Sion |
Sion |
50 795 |
130,70 km² |
5 |
|
Viège |
Viège |
29 676 |
863,80 km² |
19 |
|
Total |
|
365 844 |
5 224,25 km² |
122 |
Les districts ne disposent pas de pouvoir politique
autonome; ils demeurent des entités géographiques et électorales.
Cependant, ils sont devenus des circonscriptions électorales pour
l'élection du Grand Conseil, ce qui assure une représentation
géographique des différentes régions du canton. Les districts sont
composés de communes. Le gouvernement a, dans chaque district, un
représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.
2.1 La répartition linguistique
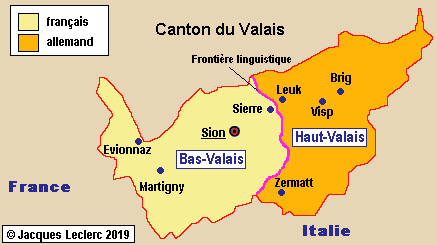 |
Au sud des Alpes bernoises, le canton du
Valais/Wallis se présente comme un canton bilingue.
La frontière linguistique (le Röstigraben),
passe entre Sierre (Siders en all.) et Leuk
(Loèche en fr.), et descend vers le sud à l'ouest de Zermatt.
De part et d’autre de la frontière linguistique, les lieux principaux ont
quasiment tous deux noms: l’un germanophone et l’autre francophone. Ainsi,
la capitale Sion et aussi connue sous le nom de Sitten, alors que et la ville haut-valaisanne bien connue
pour son industrie chimique, à la porte de la vallée qui conduit à Zermatt,
s’appelle en allemand Visp (en français, Viège).
Les francophones et les germanophones sont répartis dans deux zones
distinctes sur le territoire. En effet, la frontière linguistique sépare le
canton en deux régions culturelles distinctes: le Bas-Valais
ou Valais romand à l’ouest
(regroupant les francophones) et le Haut-Valais
ou
Oberwallis à l’est (regroupant
les germanophones), par opposition à l'Unterwallis
(Bas-Valais).
|
Selon les districts valaisans, la répartition linguistique
était la suivante lors du recensement effectué en 2005 :
Districts
germanophones |
Allemand
% |
Français
% |
Autres
% |
Population
2005 |
|
Brig (Brigue) |
91,9 |
1,4 |
6,7 |
23
984 |
|
Goms (Conches) |
92,8 |
0,6 |
6,6 |
4 761 |
|
Leuk (Loèche) |
91,8 |
2,4 |
5,8 |
12
121 |
|
Raron (les 2
demi-districts) |
96,1 |
0,8 |
3,1 |
10
888 |
|
Visp (Viège) |
87,2 |
4,5 |
8,3 |
27
200 |
|
Total |
|
|
|
78 954 |
|
Districts
francophones |
Français
% |
Allemand
% |
Autres
% |
Population
2005 |
|
Conthey |
90,6 |
2,7 |
6,7 |
21
841 |
|
Entremont |
91,9 |
1,7 |
6,4 |
12
990 |
|
Hérens |
95,0 |
2,2 |
2,8 |
9 919 |
|
Martigny |
88,6 |
1,5 |
9,9 |
36
627 |
|
Monthey |
87,7 |
2,6 |
9,7 |
37
505 |
|
Saint-Maurice |
90,1 |
2,0 |
7,9 |
11
252 |
|
Sierre |
80,2 |
8,1 |
11,7 |
43
120 |
|
Sion |
85,1 |
5,1 |
9,8 |
39
367 |
|
Total |
|
|
|
212 621 |
|
Ainsi, fin 2005, le Valais germanophone comptait 27,1 % de
la population du canton, contre 72,8 % pour le Valais francophone. Il faut toujours se
rappeler que, selon la jurisprudence suisse, toute personne, n'étant ni de
langue maternelle française ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait
sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième
langue, est considérée comme francophone ou germanophone. C’est que les droits
linguistiques ne sont accordés qu'aux communautés dont la langue est reconnue
comme officielle ou co-officielle. Dans le canton du Valais, ce sont le français
et l'allemand. C'est pourquoi on ne
tient compte dans les statistiques officielles que des francophones OU des
germanophones, et non pas des «allophones», ceux qui parlent une autre langue.
Cela étant dit, les locuteurs d'une langue donnée ne
forment pas nécessairement des territoires linguistiquement homogènes à 100 %. On constate donc qu'il y a des minorités linguistiques
dans tous les districts, sans aucune exception. Dans les districts germanophones, les francophones les
plus nombreux sont dans les districts de Visp (4,5 %) et Leuk (2,4 %). Dans les
districts francophones, les germanophones sont surtout présents dans les
districts de Sierre (8,1 %) et de Sion (5,1 %). Les autres minorités
linguistiques sont présentes dans les districts francophones de Sierre (11,7
%), Martigny (9,9 %), Sion (9,8 %) et Monthey (9,7 %), ainsi que dans le
district germanophone de Visp (8,3 %). À la fin de l'année 2005, le Valais germanophone comptait 27,1 % de la
population du canton, contre 72,8 % pour le Valais francophone.
2.2 Les francophones
Les francophones parlent le français standard (langue
romane) et résident
dans les districts suivants: Sierre, Sion, Hérens, Conthey, Martigny, Entremont,
Saint-Maurice et Monthey.
Parmi les francophones, il faut ajouter un certain nombre
de locuteurs bilingues parlant aussi le franco-provençal, une
langue parfois appelée arpitan,
mais que ses locuteurs continuent le plus souvent de désigner par le terme de
«patois». Le franco-provençal est une
langue romane
faisant partie plus précisément du franco-provençal. En Valais, cette langue
dont les formes sont très différentiées selon les vallées, a décliné un peu
moins vite qu’ailleurs en Suisse, et elle compte quelques milliers de locuteurs,
notamment dans les vallées suivantes: Val de Nendaz, Val d’Hérémence, Savièse,
et surtout Val d'Hérens, où les communes des Haudères
et d’Evolène font souvent figure de
seule «vraie» zone franco-provençalophone en Suisse. Les enfants y ont parfois
encore le franco-provençal comme langue maternelle, car dans ces villages les
personnes de 40 ou 50 ans et plus le pratiquent sur une base quotidienne, et la
vie politique locale fonctionne
largement en franco-provençal.
En
chiffre absolus, il y a certes moins de locuteurs du franco-provençal en
Valais qu'il n'y en a en Vallée d'Aoste (Italie), mais dans le contexte suisse la
situation valaisanne, bien que largement ignorée par les autorités
cantonales, fait figure de situation linguistiquement plus enviable que dans
d’autres zones où le franco-provençal était vivant il y a peu encore. On peut lire aussi le texte de référence du
linguiste Manuel Meune sur le
franco-provençal (voir le texte), ainsi qu'une variante du
dialecte valaisan (ou saviésan).
2.3 Les germanophones
Pour leur part, les germanophones résident dans les districts de Goms, de Brig,
de Visp, de Leuk et d'Östlich Raron et de Westlich Raron. Comme la plupart des germanophones de Suisse, les
germanophones du Valais parlent une
langue germanique, plus précisément le suisse alémanique appelé le Schweizerdeutsch,
ou encore le haut-valaisan
ou le Walliserdütsch, mais n'écrivent qu'en allemand standard.
On sait que cette variété d’allemand régional est demeurée très vivante
dans toute la Suisse alémanique. De façon générale, les germanophones de
Suisse n'aiment pas s'exprimer en «allemand d'Allemagne» qu'ils apprennent à
l'école primaire. Cette langue germanique est non seulement employée à la
maison, entre amis, dans la rue, dans les communications informelles, mais elle
envahit aussi toute la vie sociale: les affaires, les écoles, les tribunaux, la
radio et la télévision, les parlements cantonaux, les commissions fédérales,
etc. En fait, les Suisses alémaniques utilisent l’«allemand d'Allemagne»
surtout lorsque les circonstances de la vie publique les y obligent, et ils n’écrivent
qu’en «allemand d'Allemagne».
- Les Walser
Il existe encore une autre petite communauté linguistique (quelque
100 locuteurs?) de langue germanique installée dans la vallée de Goms depuis
longtemps: les locuteurs du walser. Le walser
(voir la page particulière)
est une variété alémanique de l’allemand parlée dans les cantons du Valais
et du Tessin ainsi qu'en Italie (Vallée d’Aoste). Cette minorité n'a obtenu
aucun statut reconnu dans le Valais, ni en Autriche, ni dans la
Vallée d'Aoste.
2.4 Les langues étrangères
Les langues autres langues nationales du canton sont
l'italien et le romanche. Pour les langues étrangères, outre l'anglais, il
faut mentionner le portugais, les plus courantes dans le canton du
Valais sont, outre l'anglais, le portugais, l'albanais, le turc, etc.
L'anglais est particulièrement répandu dans les centres touristiques comme
Zermatt, Saas-Fee, Crans-Montana et Verbier, où de nombreux touristes
internationaux s'y rendent.
La région du Valais a été habitée dès la préhistoire,
soit vers 3200 ans avant notre ère.
Le Valais entra dans l'histoire au IVe siècle avant notre ère avec
l'installation des Celtes qui se partagèrent la région: les Nantuates dans la région de Monthey, les Véragres dans la région de
Martigny (appelée Octoduros), les Sédunes dans la région de Sion et les Ubères sur le territoire des actuels districts
germanophones.
3.1 Les
Celtes
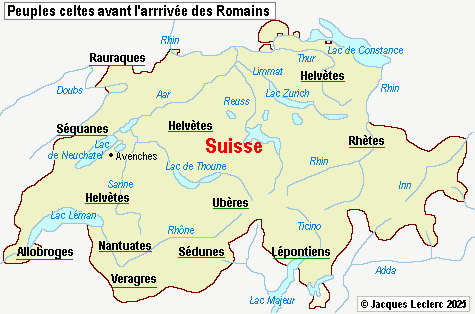 |
Cependant, l'histoire
a davantage retenu la présence des Helvètes installés plus au nord (voir
la carte) dans d'autres cantons. Les
Nantuantes étaient installés dans la haute vallée du Rhône entre le lac Léman et le défilé
de Vernayaz. Leur nom signifie «les habitants de la vallée» et il semble bien que ce
soit la forme latine (Vallenses) que l'on retrouve dans le nom du Valais.
Plusieurs peuples celtiques occupaient le territoire de la Suisse actuelle, dont les Rauraques au nord-ouest, les Rhètes en Suisse orientale et dans les Grisons, le Tessin peuplé de Lépontiens, alors que le Valais actuel était partagé entre les Nantuates, les Véragres, les Sédunes et les Ubères; les Allobroges occupaient la région de Genève. Mais ce sont les Helvètes qui sont demeurés les plus célèbres Gaulois dans l'histoire de la Suisse.
Dans
sa Guerre des Gaules (Livre III, chap. 1), Jules César parle ainsi de ces
peuples: «En partant pour l'Italie, César envoya Servius Galba avec la 12e
légion et une partie de la cavalerie chez les Nantuates, les Véragres et les
Sédunes, dont le territoire s'étend depuis les frontières des Allobroges, le lac
Léman et le Rhône jusqu'aux grandes Alpes.» |
3.2
La romanisation
En l'an 15 avant notre
ère, les Celtes furent vaincues et l'empereur Auguste
incorpora la région à l'Empire romain, qui fit partie de la province de Rhétie-Vindélicie dont la
capitale était Augsbourg.
La pax romana qui s'ensuivit permit l'essor de la région, située sur la route
stratégique du col du Grand-Saint-Bernard.
Mais les Romains demeurèrent peu
nombreux et se limitaient à un certain nombre de fonctionnaires attachés au
gouverneur de la province, quelques dizaines de soldats chargés de la sécurité
des routes et du gouverneur, ainsi que quelques spécialistes et techniciens
œuvrant dans des chantiers de construction particuliers comme les édifices
publics et les routes.
Rien pour latiniser les
autochtones avec succès. Néanmoins, pendant quatre siècles, Rome exerça
sur le Valais
son influence économique et culturelle, donc linguistique. Les populations celtes se latinisèrent
progressivement d'autant plus que les routes favorisèrent la diffusion des
idées.
À partir du
IIIe siècle, la langue latine parlée par
les habitants subit des changements importants du fait de
l'affaiblissement du pouvoir romain et des menaces venant des peuples germaniques.
En effet, des tribus germaniques commencèrent à s'installer
sur les frontières du Rhin et du Danube. Pour leur
part, les Burgondes s’étaient établis en alliés et fondèrent un royaume rhodanique
dont le Valais faisait partie.
3.3 La Sapaudia et le franco-provençal
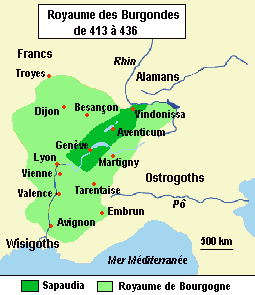 |
Les Burgondes occupèrent toute la Savoie ainsi que la région du
Valais. Ils
fondèrent la Sapaudia, qui correspond aujourd'hui aux cantons de Genève,
Vaud et Neuchâtel et les régions françaises (savoyardes) à proximité; le
Valais n'en faisait donc pas partie. Le
terme de Sapaudia
signifierait «pays des sapins», ce qui donna «Savoie». Comme
les envahisseurs germaniques étaient minoritaires, ils n'ont pu imposer leur langue, mais ils ont
quelque peu influencé le latin parlé par les
habitants. Puis une nouvelle vague de transformations linguistiques
aboutit à la disparition graduelle du latin parlé pour se transformer en
divers parlers franco-provençaux qu'on désignera par le terme de «patois».
Cette transformation linguistique s'étala du Ve
siècle au IXe
siècle.
Durant tout le Moyen Âge, les
parlers romands s'implantèrent partout
dans toute la Suisse romande sous la forme d'un parler d'oïl dans le Jura
(«patois jurassien») et sous la forme des
parlers franco-provençaux ailleurs
en Suisse romande, notamment dans le canton du Valais («patois valaisan»). Cependant, ces
«patois»
n'ont jamais été écrits: on employait le latin comme langue écrite. En même
temps, toute la région s'était christianisée. En 515, le roi burgonde
Sigismond, fraîchement converti au
catholicisme, fonda
l'abbaye de
Saint-Maurice et fit de ce lieu de culte le symbole de la nouvelle
religion. En 534, la Burgondie fut annexée par la monarchie franque. |
3.4 Le Valais
après le traité de Verdun
Le Valais fit partie de l'empire de Charlemagne,
puis passa à la Lotharingie. C'est à Worms en 839, lors de la dislocation de
l'Empire carolingien que l'on trouve la plus ancienne mention du comté du
Valais, attribué à Lothaire et
confirmée lors du traité de Verdun
de 843. Mais quelques années plus tard, en 859, le Valais
fut attribué à Louis II, à la fois roi d'Italie et empereur d'Occident (855-975). En
999, le roi Rodolphe III de Bourgogne (970-1032), par la Charte de
donation, conféra les droits comtaux sur le Valais à l’évêque de Sion,
Hugues, ainsi qu'à ses successeurs. La Charte de 999 fut le véritable acte
fondateur du Valais comme État. Dans les faits, l'évêque de Sion devint
prince d'Empire, tandis que l'évêché devenait la principauté épiscopale de Sion.
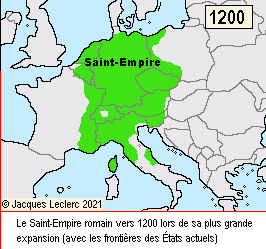 |
En 1032, la région, comme toute la Suisse (ainsi que l'Allemagne, l'ouest
de la France et le nord de l'Italie), fut rattachée au
Saint Empire romain germanique, mais elle resta politiquement
morcelée entre de nombreux seigneurs féodaux qui se
considéraient relativement libres des politiques de l'empereur.
Au
XIIe siècle, le
principal détenteur du pouvoir dans le Valais était encore l’évêque de
Sion, qui représentait l'autorité impériale. Mais l’enchevêtrement des
seigneuries favorisait les risques de conflits dans le pays. Trois puissances se partagèrent le territoire du Valais:
l’évêché de Sion, l’abbaye de Saint-Maurice et le comté de Savoie à partir de
la mort de Rodolphe III en 1032. Durant toute cette période, deux types de
parlers s'étaient développés: d'une part, les parlers franco-provençaux issus du
latin, d'autre part, les parlers alémaniques issus du germanique commun. Les
premiers étaient surtout utilisés dans le Bas-Valais, les seconds dans le
Haut-Valais |
3.5 La Maison de Savoie
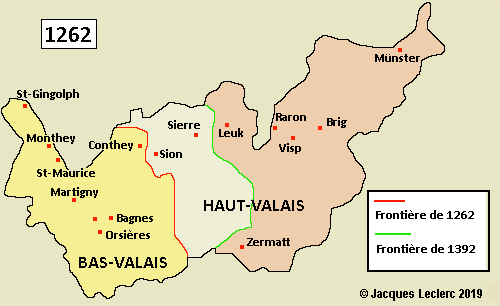 |
Les comtes de Savoie
s'approprièrent le Bas-Valais de culture latine. Menacé, Henri de Rarogne,
évêque de Sion de 1243 à 1271, s'allia à Berne (1252)
de culture germanique.
Le futur comte de Savoie, Pierre II, envahit alors tout le Valais en 1260 et s'empara
de plusieurs châteaux. L'évêque de Sion fut dans l'obligation de signer la paix, mais il
en résulta en 1262 un Valais coupé en deux :
le Bas-Valais continua de faire partie des possessions
savoyardes, mais le Haut-Valais resta aux mains de l'évêque de Sion.
Puis les comtes de Savoie virent accroître
l'étendue de leurs possessions au cours de la période qui s'étendit du XIIIe
au XVe siècle, notamment sous Pierre II
(1263-1268): Vaud, Valais, Chambéry (acquis en 1232), Piémont et Lombardie.
Mais la Savoie continua d'avoir des prétentions sur le Haut-Valais
germanique.
Les guerres reprirent entre la Savoie et l'évêque de Sion dont la ville fut
livrée plusieurs fois au pillage. En 1388, lors de la bataille de Viège, les patriotes haut-valaisans
vainquirent les troupes savoyardes. En 1391, après la mort d'Amédée VII,
dit «le comte Rouge», un traité de paix fut signé, le 24 novembre 1392 et la
frontière entre la Savoie et le Valais fut définitivement fixée.
|
3.6 La mainmise du Haut-Valais
À partir de 1476, le
Haut-Valais,
c'est-à-dire le territoire des Sept-Dizains (Sion, Sierre, Loèche, Brigue, Viège, Conches et
Rarogne) gouverna le Bas-Valais et se rapprocha
des cantons confédérés,
notamment du canton de Berne. La Savoie ne reconnaîtra cette annexion qu'en
1526. Le terme Dizains fait référence aux divisions territoriales
historiques du Valais, similaires aux districts actuels. À l'origine, il
y avait dix dizains, d'où la dénomination dix-ain, qui sont
devenus des unités autonomes au sein de la république des Sept Dizains.
Ces entités ont joué un rôle important dans l'histoire politique et
administrative du Valais en influençant son organisation territoriale et
sa participation à la Confédération.
Après
l'annexion du Bas-Valais par les Sept-Dizains, il s'ensuivit deux siècles de luttes
sanglantes qui ne prirent fin qu'avec la fin du pouvoir temporel de l'évêque de Sion
en passant par la participation aux guerres d'Italie et aux guerres de Bourgogne.
La défaite des Suisses à Marignan (à 16 km au sud-est de Milan en Italie) et la victoire du
roi de France, François 1er,
changèrent définitivement la donne, non seulement au Valais, mais dans toute
la Suisse. Le 29 novembre 1516, François 1er
conclut une «paix perpétuelle» avec les
Suisses qui se mettront dorénavant au service des rois de France jusqu'à la Révolution
française; puis la Suisse confédérée adoptera une politique de
neutralité et cessera d'être une puissance militaire.
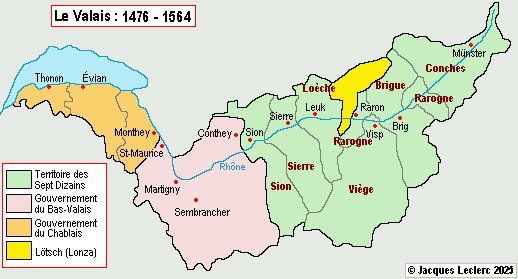 |
Entre-temps, le Bas-Valais romand était devenu un «pays sujet» du Haut-Valais
germanique, même si la Savoie ne reconnut cette annexion
qu'en 1526. Le Lötschental (Lötsch en allemand; Lonza en rhéto-roman) était
d'abord une vallée farouchement indépendante, mais il devint un
territoire commun des Sept Dizains et intégrée parmi les autres
en 1476.
En plus du Bas-Valais, le Chablais (pris à la
Savoie) fut soumis au Haut-Valais à partir de 1536. En 1564, la
Savoie reprit le Chablais de Thonon et en 1569 le Chablais
d'Évian. Mais le Bas-Valais conserva le Chablais de Monthey. De
nos jours, le Chablais de Thonon et d'Évian est français, celui
de Monthey est suisse (rattaché au Valais).
Le nombre de dizains en Valais évolua au fil du
temps, notamment lors de l'acquisition de nouveaux territoires
et de l'intégration dans la Confédération suisse. Le terme de
«district» devait finalement remplacer «dizain» en 1848 avec
l'adoption de la nouvelle Constitution fédérale.
|
3.7 Les divisions confessionnelles
À la longue, le pouvoir temporel pratiqué par l'épiscopat
valaisien,
ainsi que les erreurs accumulées par le clergé et l'ignorance des gens pour les questions
religieuses entraînèrent un mouvement favorable au développement du
protestantisme. En 1526, le pape Clément VII ordonna au chapitre de Sion
«de procéder sommairement contre les gens adonnés aux pratiques
superstitieuses, les luthériens, les hérétiques, les fauteurs et les sectateurs
de l’hérésie, et de les punir». En 1529, le Valais signa une alliance perpétuelle avec les cantons catholiques,
alors que Berne favorisait
l’implantation de la Réforme. En 1536, les Bernois envahirent le pays de Vaud et
le Chablais français au sud du lac Léman. Les positions de l'Église catholique
dans le Valais s'affaiblirent devant la montée du
protestantisme.
- La tolérance religieuse
En 1551, la Diète du Valais imposa la tolérance religieuse qui
fut respectée
durant une vingtaine d’années. Le pape
Clément VIII (1592-1605) dépêcha des capucins savoyards dans le Bas-Valais et le Haut-Valais.
Les manifestations d’indépendance de la part des «patriotes» se
multiplièrent jusqu'à ce qu'ils réussissent en 1613 à imposer un «Conclusum»
(décret germanique) à
l'évêque: dorénavant, celui-ci ne pouvait plus s'opposer aux décisions de la
Diète (Assemblée délibérante), il devait recevoir des
mains du grand bailli (représentant des autorités) les insignes de ses fonctions et de son pouvoir. Quant au
bailli, il pouvait convoquer la Diète sans en référer à l'évêque et assermenter
seul le gouverneur. La séparation des pouvoirs spirituel et temporel était
réalisé. En 1618, la Diète renouvela l’alliance avec erne, puis avec les
Grisons, sans l'assentiment de l’évêque et en 1627 les patriotes expulsèrent
les jésuites.
- L'attachement à la religion catholiqueDans le domaine de la religion, la Diète
valaisanne demeura sur ses positions dans son attachement à
la religion catholique et interdit aux protestant de
siéger à son assemblée ou d'occuper des charges publiques. Mais la résistance
des protestants et les menaces de guerre civile dans le Valais favorisèrent une
certaine modération. Finalement, la Réforme protestante se révéla un échec dans
le Valais. Il est vrai
que, contrairement aux autres régions de la Suisse romande, aucun théologien
protestant n'était intervenu au Valais afin de galvaniser les foules. De plus, en
restant fidèle au catholicisme, les Valaisans conservaient l'avantage de faire
du commerce avec Milan et l'Espagne. Il en résulta un maintien plus profond,
d'une part,
des parlers franco-provençaux dans le Bas-Valais, d'autre part, des dialectes alémaniques
dans le Haut-Valais.
En même
temps, les Valaisans participaient activement au service dans les armées
étrangères tout au long de l'Ancien Régime. En général, ils se mettaient au
service du roi de France. Ce faisant, les Valaisans devenaient plus familiers
avec la langue française et étaient portés à délaisser leurs parlers
franco-provençaux. En même temps, les Valaisans du Bas-Valais influencèrent ceux
du Haut-Valais, car les germanophones servirent aussi le roi de France. L'élite haut-valaisanne se
familiarisa de plus en plus avec la culture
française, surtout à l'époque du siècle des Lumières. Dès
lors, l'influence de la France et
de sa langue s'étendit sur tout le Valais. Non seulement le français
fut parlé par les élites bas-valaisannes, mais également par les élites haut-valaisannes.
Le français s'implanta aux dépens du franco-provençal (le patois valaisan) et
de l'alémanique. Dans les milieux bourgeois, les enfants commencèrent à
résister au patois franco-provençal et au haut-valaisan alémanique; certains préféraient
s'exprimer en français ou en allemand.
3.8 La Révolution française
Les Valaisans accueillirent favorablement les premiers échos de la Révolution française,
surtout dans le Bas-Valais qui entrevoyait ainsi la possibilité de se défaire de
la tutelle du Haut-Valais germanisant. Mais les nouvelles idées se répandirent tant au
Bas-Valais qu'au Haut-Valais. En 1798, après le passage de l'armée française, le
Valais fut incorporé à la
nouvelle République helvétique
calquée sur le modèle français. La distinction entre cantons, alliés, sujets et
bailliages fut abolie et les frontières administratives furent redessinées sans
tenir compte de l’évolution historique.
Toutefois,
le modèle français s'avéra inapplicable en Suisse en raison des
différences de religion, de langue et de culture. Non seulement le territoire
suisse fut attaqué de partout par ses puissants voisins, mais la guerre civile
éclata dans le pays. La République helvétique ayant rendu l'âme le 18 septembre
1802, Bonaparte imposa, le 18 février 1803, l'Acte de médiation par lequel la
Suisse redevenait une confédération constituée de 19 cantons, ce qui
correspondait à six de plus qu’auparavant (Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin,
Vaud et Saint-Gall), car l’Acte prévoyait la suppression des «pays sujets» ou
«pays alliés». Le Valais devint un État indépendant appelé
République
rhodanique, mais il s'agissait d'une indépendance contrôlée par Napoléon
Bonaparte qui en avait fait un protectorat français afin de mieux contrôler les
passages vers l'Italie.
Le Haut-Valais se vit
dans l'obligation de reconnaître officiellement l'affranchissement du Bas-Valais.
- Le département français du Simplon
Au début de l'année 1810, Napoléon se trouvait à l'apogée de sa puissance. L'année précédente avait vu la défaite de l'Autriche,
mais la paix de Vienne du 14 novembre 1809 permettait à la France d'annexer les Provinces illyriennes, ce qui renforçait l'intérêt pour annexer le canton du Valais afin de construire la route du Simplon, une petite municipalité dans le canton du Valais.
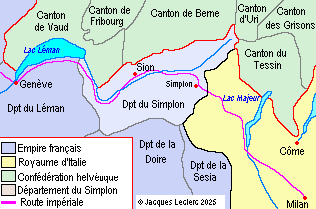 |
Napoléon entreprit très vite la construction de la route du Simplon destinée à relier directement Paris à Milan par le plus court chemin entre Lyon et la ville lombarde et la nécessité de la contrôler. Pendant un peu plus de trois années, de novembre 1810 jusqu'à la fin de 1813, le Valais fut annexé à la France pour former le département du Simplon, les Valaisans devenant pendant cette période des citoyens français.
La préfecture du Simplon qui dépendait directement du ministère de l'Intérieur fut fixée à Sion, ce qui favorisait le transfert de la ville des princes-évêques germanophones et germanophiles dans une cité devenue francophone. Durant tout le temps de l'occupation, les quelque 126 000 Valaisans donnèrent du fil à retordre aux Français au point où la France dut abandonner ses tentatives d'assimilation pour privilégier le maintien de l'ordre. |
En novembre 1810, la République rhodanique fut intégrée à l'empire de
Napoléon Ier sous le nom de «département du
Simplon» avec trois arrondissements : Sion, Brigue et Saint-Maurice.
Le département est créé par l'article 2 du décret du 12 novembre 1810, portant
réunion du Valais à l'Empire français:
|
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA
CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE :
Considérant que la route du
Simplon, qui réunit l'Empire [français] à notre Royaume
d'Italie, est utile à plus de soixante millions d'hommes ;
qu'elle a coûté à nos trésors de France et d'Italie plus de
dix-huit millions, dépense qui deviendrait inutile si le
commerce n'y trouvait commodité et parfaite sûreté ;
Que le Valais n'a tenu
aucun des engagements qu'il avait contractés, lorsque nous avons
fait commencer les travaux pour ouvrir cette grande
communication ;
Voulant d'ailleurs mettre
un terme à l'anarchie qui afflige ce pays, et couper court aux
prétentions abusives de souveraineté d'une partie de la
population sur l'autre,
Nous avons décrété et
ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — Le
Valais est réuni à l'Empire.
ART. 2. — Ce territoire
formera un département sous le nom de département du Simplon,
ART. 3. — Ce département
fera partie de la septième division militaire.
ART. 4. — Il en sera pris
possession, sans délai, en notre nom, et un commissaire général
sera chargé de l'administrer pendant tout le reste de la
présente année.ART. 5. — Tous nos ministres seront chargés de
l'exécution du présent décret.
Signé : Napoléon
Par l'Empereur : Le
ministre secrétaire d'État,
Signé : Hugues-Bernard
Maret, Duc de Bassano |
Au cours de la période française, le français devint une langue administrative
dans tout la Valais, ce qui eut comme résultat de dévaloriser tous les patois
romands et alémaniques.
- Le retour en Suisse
Le 28 décembre 1813, les Autrichiens pénétrèrent dans le département du Simplon, atteignirent Sion le lendemain et occupèrent le territoire jusqu'en mai 1714, au moment où le traité de Paris remettait définitivement le Valais à la Suisse. Malgré la durée éphémère du département du Simplon (1810-1813), son intégration à la France fit pencher la balance en faveur du français qui devint (temporairement) ainsi la seule langue officielle du Valais.
Après le départ des Français en 1813, le Valais se divisa à
nouveau entre le
Bas-Valais et le Haut-Valais. Les Haut-Valaisans voulurent revenir à la situation d'avant la
Révolution, alors que le Bas-Valais était un «pays sujet» du Haut-Valais
lui-même allié de la Confédération helvétique. Après bien des tergiversations,
Bas-Valaisans et Haut-Valaisans finirent par s'entendre pour une constitution
commune qui fut adoptée le 12 mai 1815.
3.9 Le 20e
canton suisse
Le 4 août 1815, le Valais devint le 20e
canton de la Confédération
helvétique. Dans l'Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, on pouvait
lire l'article 75:
|
Article 75
Le Valais, le territoire de
Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et
formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie
du canton de Vaud, lui est rendue. |
Par ailleurs, la Suisse obtint le statut de «pays neutre»
et prit le nom de Confédération helvétique. En réalité, ce statut servait bien
les intérêts des puissants voisins qui ont toujours utilisé la Suisse comme
voie de passage pour aller envahir les autre États voisins.
- Les conflits ethniques
Cela étant dit, les tensions entre le Bas-Valais et le
Haut-Valais ne cessèrent pas après l'adoption de la nouvelle Constitution
valaisanne, ce
qui dégénéra entre conflits ethniques, notamment entre les germanophones et
les romandophones. La Constitution de 1815 ne traitait pas de la langue et
décrétait la division du Valais en 13 circonscriptions encore appelées «dizains»
(en allemand: Zenden):
Conches, Brigue, Viège, Rarogne, Loèche, Sierre,
Sion, Hérens, Conthey, Martigny, Entremont, Saint-Maurice et Monthey. C'est
seulement lors de la Constitution de 1848 que le mot
«district» remplacera «dizain». À partir de 1837, des familles réformées émigrées de Berne
s'installèrent à Sion et fondèrent une école protestante.
L'arrivée du train
dans les années 1860 (ligne Paris-Milan) modifia l'équilibre linguistique
du canton. L'industrialisation amena des milliers d'immigrants francophones
dans le canton du Valais. L'allemand perdit progressivement de son importance
au profit du français; des villes comme Sion et Sierre devinrent
majoritairement francophones, alors que les patois valaisans régressaient continuellement.
De plus, en raison des dures conditions de vie et des changements socio-économiques provoqués par la révolution industrielle,
plusieurs centaines de milliers de Suisses furent contraints de quitter leur pays.
Or, c'est la partie francophone patoisante du Valais qui fournit le plus
d'émigrants, notamment en Argentine. Durant ce temps, de nombreuses familles
haut-valaisannes virent s'établir au Bas-Valais, surtout à Monthey, à Sierre et
à Sion. Ce faisant, les Haut-Valaisans implantèrent davantage l'alémanique et
l'allemand dans le Bas-Valais. Pendant que les écoles germanophones enseignant
l'allemand, les écoles bas-valaisannes offraient l'enseignement en français
aux dépens des patois valaisans.
- La patois valaisan
À cette époque, l'idéologie préconisée en matière de langue, notamment en France, était de valoriser le français normalisé aux dépens des patois considérés de moindre valeur, d'où le terme de «patois» plutôt que «langue».
Contrairement à une idéologie très répandue à cette époque, les parlers franco-provençaux
appelés «patois n'ont jamais été une corruption du français. Il s’agit bel et
bien de langues à part entière, toutes issues du latin implanté jadis dans les
territoires aujourd'hui dits de «langues romanes», sauf que ces patois n'ont
jamais été valorisés socialement, mais combattus.
La décision de rendre l’école obligatoire pour tous tout au long du XIXe siècle en Europe francophone et au Canada français a également entraîné l’imposition d’une langue française standardisée, voire «pure», ainsi que l’interdiction des éléments considérés — les régionalismes et les mots étrangers — comme un appauvrissement ou une détérioration qui menacerait l’intégrité de la langue commune. D'ailleurs, beaucoup de familles et de municipalités suisses s'opposèrent à l’obligation scolaire qui leur était imposée parce qu'elles percevaient cette mesure comme une uniformisation et un empiètement sur leur liberté. Il faut aussi se rappeler qu'à cette époque les enfants étaient considérés comme de la main-d'œuvre et qu'il valait mieux qu'ils ne restent pas trop longtemps à l'école. Très souvent, les enfants étaient obligés de travailler et n’avaient pas le temps d’aller à l’école! Le maniement du rabot ou de l'aiguille était plus important
que de savoir lire et écrire. Dans un règlement scolaire (art. 8) de 1824
émis à Monthey dans le Chablais valaisan, on pouvait lire cette directive:
«Les régents interdiront à leurs écoliers et s'interdiront absolument à
eux-mêmes l'usage du patois dans les heures d'école et en général dans tous
les cours de l'enseignement.» Ce fut la seule réglementation du genre
édictée dans le canton du Valais.
Néanmoins, l'exemple de Monthey fut imité par d'autres communes
par une sorte d'interdiction morale qui s'étendit dans le canton afin de
supprimer un comportement jugé socialement «nuisible». Dans la vie
quotidienne, le patois fut associé à un monde rural qu'on devait bannir pour
accéder à la modernité véhiculée par le français.
Bien avant le canton du Valais, Genève avait déjà interdit le
patois en 1668 et le canton de Vaud en 1806. En cette fin du XIXe siècle, pendant que l'emploi du patois était réprimé et discrédité par les autorités dans tout le territoire romand, l'alémanique, le «patois allemand», lui, fut toléré dans la partie germanophone. Il s'agissait évidemment d'une politique du deux poids deux mesures. Par la suite, le patois franco-provençal périclita au profit du français. Les grandes villes virent progressivement disparaître les locuteurs du franco-provençal;
seuls les zones rurales et les villages conservèrent leur patois ancestral.
Dans cette idéologie, la langue, c'est comme la religion: les fautes d'orthographe ou de grammaire
durent être traquées comme les péchés, il y eut le «bon» français et le «mauvais», des «bons» actes et des «mauvais». L'ascétisme dans la religion comme le rigorisme dans la langue. Le Règlement pour les écoles primaires du canton du Valais du 24 octobre 1874, issu de la Loi sur l'Instruction publique de 1873, précisait en ces termes les buts premiers de l'école primaire :
| L'école primaire a essentiellement pour but de former le cœur et l'esprit des élèves pour en faire des hommes religieux et moraux, et partant de bons citoyens ; de leur inculquer de bonne heure des idées d'ordre et de travail, et de leur communiquer les connaissances les plus nécessaires à la vie. |
Dans ce but, un personnel enseignant «capable et dévoué» était nécessaire : sa formation à l'École normale devait y pourvoir. En Suisse, lorsqu'un candidat était admis comme instituteur, il devenait «régent» et bénéficiait alors d'une influence incontestée au-delà des murs de l'école, en tant que titulaire d'une fonction publique.
Les femmes enseignantes devaient être célibataires et portaient le titre de
«maîtresse d'école».
Depuis la fin du XIXe siècle, les signes
du déclin des patois se multiplièrent dans le canton du Valais; le processus
allait s'accélérer après la Deuxième Guerre mondiale. Les parents
préféraient que leurs enfants apprennent d'abord le français plutôt que leur
patois qu'ils connaissaient déjà. De façon générale, il semble que les
femmes aient été plus sensibles aux arguments des enseignants qui
encourageaient à parler français à la maison. Cette époque de dévalorisation
du patois eut pour effet de marginaliser progressivement l'emploi du patois
valaisan. Les autorité scolaires incitèrent les instituteurs à combattre le
patois. Les établissements d'enseignement jouèrent un rôle important dans la
régression du patois, mais le patois valaisan survécut plus qu'ailleurs en
Suisse, même si les écoles valaisannes ne purent résister à condamner «l'usage funeste des patois» considérés comme une «défectuosité».
Le XIXe siècle constitue une période
importante au point de vue linguistique, car c'est au cours de cette période
que le paysage linguistique de la Suisse romande s'est profondément
transformé. Ce fut l'époque où les locuteurs de la Suisse romande adopta le
français comme langue parlée, celui-ci étant déjà présent comme langue
écrite depuis le Moyen Âge.
Dès lors, si l'on fait exception du Valais, une grande partie de la
Suisse romande abandonna rapidement les «patois» locaux traditionnels comme
moyen habituel d’expression orale. Dans le canton du Valais, le franco-provençal perdura
davantage que dans les autres cantons romands, de sorte que le français pouvait encore être considéré comme une langue étrangère. On peut en lire un exemple du valaisan en cliquant ici, s.v.p.
De fait, les patois franco-provençaux sont encore plus ou moins employés
dans une vaste région à cheval entre la France (Rhône, Savoie, etc.), la
Suisse (Suisse romande) et l’Italie (Vallée d'Aoste).
- La Constitution valaisanne de 1907
C'est dans la Constitution de 1907 que, pour la première
fois, le français et l'allemand furent déclarés langues «nationales»:
|
Article 12 (1907)
1) La langue française et la langue allemande sont déclarées
nationales.
2) L'égalité de traitement entre les deux langues doit être
observée dans la législation et dans l'administration. |
Durant la premier quart du XXe
siècle, les germanophones ont conservé une certaine prééminence dans le canton,
puis la situation s'est progressivement inversée au profit des francophones.
En 2023, la population valaisanne a augmenté de 2,4%. Cette croissance paraît
bien plus élevée que la moyenne suisse de la même année, qui était de 1,7%. De
plus en plus de personnes établissent leur domicile en Valais. Le canton a un
tel pouvoir d'attraction qu'il pourrait atteindre le seuil de 415 000 personnes
domiciliées en 2050.
La Constitution valaisanne actuellement en vigueur a été
adoptée le 8 mars 1907. Elle apparaît pour plusieurs désuète. Quelques
tentatives de réforme ont eu lieu, sans succès.
4.1 La Constitution actuelle
La
Constitution cantonale de
1907 légèrement modifiée
traite sommairement des langues aux articles 12 et 62. Seul le paragraphe 1
de l’article 12 déclare que le français et l’allemand sont les deux
langues «nationales» (officielles du canton):
|
Article 12
1) La
langue française et la langue allemande sont déclarées nationales.
2) L'égalité de traitement entre les deux langues doit être observée
dans la législation et dans l'administration.
|
Quant à l’article 45 (aujourd'hui aboli), il précisait la durée
de certains fonctions du Grand Conseil (Parlement) et la composition
linguistique de ces membres:
|
Article 45
Le Grand Conseil élit
pour un an un président, deux vice-présidents et pour quatre ans quatre
scrutateurs et deux secrétaires,
l'un de langue française, l'autre de langue allemande.
|
Le second article traitant de la langue concerne
l'article 62 sur la langue des tribunaux:
|
Article 62
1) Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge substitut; par
arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel; et pour
le canton, un Tribunal cantonal.
2) Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues
nationales.
|
La Constitution ne comprend que des dispositions d’ordre
général, surtout en ce qui a trait à la proclamation des langues officielles.
Mais il faut surtout retenir l’un des grands principes du droit suisse: la
territorialité des langues et l’unilinguisme territorial. Ce principe reconnu
dans la Constitution fédérale constitue l'élément fondamental du droit des
langues pour tous les citoyens du pays. D’ailleurs, la jurisprudence des
tribunaux (fédéraux) a toujours privilégié le principe de la territorialité
des langues aux dépens de la liberté d'expression.
Autrement dit, ce droit à la langue n’est pas d’ordre personnel (sauf
pour l’Administration centralisée à Berne pour le gouvernement fédéral et
à Sion pour le gouvernement cantonal), mais d’ordre territorial. Ce type de
«bilinguisme» dérive du principe que les langues en concurrence dans un État
bilingue sont séparées sur le territoire à l'aide de «frontières
linguistiques» rigides et non poreuses.
Les droits linguistiques sont alors accordés aux
citoyens résidant à l'intérieur d'un territoire donné et un changement de
lieu de résidence peut leur faire perdre tous leurs droits (linguistiques),
lesquels ne sont pas transportables comme l'est, par exemple, le droit de vote.
Dans les faits, l’État, comme c’est le cas du canton du Valais, peut être
officiellement bilingue, mais il applique un unilinguisme local, sauf dans des
cas très particuliers. Une telle pratique n’est possible que lorsque les
communautés linguistiques sont très concentrées géographiquement.
4.2 Les projets de réforme avortés
La Constitution de 1907 a fait l'objet de réformes,
mais n'a jamais pu aboutir.
Le 25 avril 2023, le
texte final d'un projet de constitution fut adopté par l'Assemblée par
87 voix contre 40. Cependant, le projet de
Constitution fut refusé en votation populaire, le 3 mars 2024, après 117
ans. Le projet d'une nouvelle constitution cantonale a obtenu 27,17% de oui,
contre 68,13% de non, auxquels s’ajoutent 4,70% de bulletins entièrement
blancs, nuls ou sans réponse spécifique à cette première question sur
l’acceptation ou non du projet dans sa version incluant le droit de vote et
d’éligibilité des personnes étrangères en matière communale.
Ceux qui rêvaient de changement ou de révolution
devront passer leur tour. Pourtant, le texte proposé ne devait pas
bouleverser le canton de fond en comble, mais il modernisait le canton et le
préparait aux défis à venir. En d’autres mots, le projet met de l’ordre et
de la cohérence dans l’existant. Cet effort de modernisation reflète les
forces politiques choisies par la population du canton. Le Valais reste
divisé entre progressistes et conservateurs, entre habitants de la plaine et
ceux des montagnes ou entre francophones (plus progressistes) et
germanophones (plus conservateurs). La population a préféré conserver le
texte fondateur de 1907.
À l’exemple des autres cantons suisses, le Valais n’a jamais adopté de
loi linguistique spécifique, telle qu’on en retrouve dans plusieurs États,
que ce soit en Arménie (Loi
sur la langue de 1993), en France (Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue
française), en Catalogne (Loi
sur la politique linguistique du 7 janvier 1998),
en Lituanie (Loi sur la langue officielle de 1995), au Québec (Charte
de la langue française de 1977), en Pologne (Loi
sur la langue polonaise de 1999), en Macédoine du Nord (Loi
sur l'emploi des langues de 2019), etc.
Cependant, le canton dispose d’une trentaine de lois non linguistiques dont
certains articles à portée linguistique apparaissent ici et là. La liste d’une
partie de ces quelque 25 lois présentées au début de cette page témoigne des
préoccupations linguistiques de la part des autorités cantonales. Ces lois
cantonales traitent de façon ponctuelle de l'usage des langues dans
l'organisation cantonale, judiciaire, scolaire, ainsi que des élections, du
notariat, de l'expropriation, de l'état civil, du registre foncier, de l’assurance-invalidité,
du tourisme, etc.
5.1 Les langues de la législation et de la
réglementation
Au Parlement cantonal (appelé «Grand Conseil») de Sion (capitale du
Valais), les députés s'expriment dans la langue de leur choix, soit le
français, le suisse alémanique (ou Schweizerdeutsch) ou l’allemand (Hochdeutsch).
Les débats sont assurés de la traduction simultanée. De façon générale,
les lois sont discutées en français, parfois également en suisse alémanique,
puis rédigées en français et traduites en allemand; elles sont enfin
promulguées à la fois en français et en allemand. Évidemment, étant donné
le plus petit nombre de députés germanophones, la langue des débats est
normalement le français, puis l'allemand standard et parfois le suisse alémanique.
Rappelons à l’article 45 de la Constitution qui oblige le Grand Conseil
(Parlement) à élire «pour un an un président, deux vice-présidents et pour
quatre ans quatre scrutateurs et deux secrétaires, l'un de langue française,
l'autre de langue allemande». Le
Règlement du Grand
Conseil (2001-2023) prévoit quelques dispositions à cet
effet, dont l'article 55:
|
Article 55
Publication
1) À l'exception des
débats à huis clos, les débats et décisions du Grand Conseil sont
publiés intégralement et sans retard sur le site officiel du canton du
Valais et dans le bulletin des séances du Grand Conseil.
2) Les membres des commissions
intéressées et le Conseil d'État peuvent demander une copie des textes,
avant leur publication, lorsque cette consultation s'avère indispensable
pour la préparation d'une session agendée avant la publication. La
présidence peut accorder une telle autorisation à d'autres personnes.
3) Sont en outre publiés le budget, le
compte de l'État, les rapports des organes du Grand Conseil ainsi que,
dans les deux
langues, les projets
d'actes législatifs et de décisions, les messages et les rapports du
Conseil d'État.
Article 66
Assermentation
1) La formule du serment, lue dans les deux langues par un membre de
la présidence ou du bureau provisoire, est la suivante:
"En présence du Dieu
tout-puissant, je jure d'observer et de maintenir fidèlement la
Constitution du canton du Valais, de défendre et de respecter les
droits, la liberté et l'indépendance du peuple et des citoyens,
d'éviter et d'empêcher de tout mon pouvoir tout ce qui porterait
atteinte à la religion de nos pères et aux bonnes mœurs, d'exercer
en toute conscience la charge dont je suis revêtu, de ne jamais
excéder les attributions de mon mandat. Que Dieu m'assiste dans
l'exécution de ces engagements."
2) La formule de
la promesse solennelle, lue dans les deux langues, par un membre de la
présidence, est la suivante:
"Je promets sur mon
honneur et ma conscience d'observer et de maintenir fidèlement la
Constitution du canton du Valais, de défendre et de respecter les
droits, la liberté et l'indépendance du peuple et des citoyens,
d'éviter et d'empêcher de tout mon pouvoir tout ce qui porterait
atteinte aux bonnes mœurs, d'exercer en toute conscience la charge
dont je suis revêtu, de ne jamais excéder les attributions de mon
mandat."
3) A l'appel de
son nom par l'un des membres de la présidence, chaque personne
assermentée dit, debout et la main levée: "Je le jure" ou "Je le
promets".
4) Les députés et les députés-suppléants absents font le serment
ou la promesse au début de la première séance à laquelle ils assistent.
|
Les lois, décrets et arrêtés sont publiés en
français et en allemand, et les deux versions font autorité. Généralement, les
lois, décrets, ordonnances ainsi que les arrêtés sont communiqués officiellement
en allemand dans la partie allemande du canton et en français dans la partie
française.
De fait, l'article 138 de la
Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs
(1996-2024) reprend les dispositions sur les publications
officielles du Grand Conseil, en français et en allemand:
Article 70a
Signatures
1) Après qu'un acte a été adopté par le Grand Conseil, le service
parlementaire en établit
des exemplaires originaux en
français et en allemand.
2) Le président du Grand Conseil et le chef du service
parlementaire signent les exemplaires originaux de l'acte et pourvoient
à leur transmission.
Article 138
Publication des actes du Grand Conseil
1) Le Conseil d'État organise les publications officielles par la
voie du Bulletin officiel, qui paraît chaque semaine
en français et en allemand.
Il peut charger un éditeur de cette publication, l'État restant dans
tous les cas propriétaire des matières publiées et des supports utilisés
pour leur publication.
2) Les actes législatifs sont publiés de manière centralisée sur
une plate-forme en ligne accessible au public sur le site officiel du
canton du Valais (plate-forme). Ils ne sont réputés connus et ne lient
que s'ils sont publiés dans le recueil officiel du canton du Valais sur
la plate-forme. Le texte de la publication de ces actes mentionne le
nombre de signatures requises pour une demande de référendum ainsi que
le délai référendaire.
3) Les autres actes du Grand Conseil ainsi que le résultat des
élections et nominations sont publiés soit dans le Bulletin officiel,
soit dans le bulletin des séances du Grand Conseil. La présidence
d'entente avec le Conseil d'État en décide.
|
Dans les organismes reliés au Parlement cantonal, que ce
soit la Présidence ou le Bureau, un régime d'alternance est respecté, ce qui
entraîne en principe une prise de parole soit en français soit en allemand,
selon les personnes occupant les fonctions. Dans les faits, en raison de la
proportion 80-20 en faveur du français, les présidents germanophones ont
tendance à présider les assemblée en français plutôt qu'en allemand.
Dans les commission parlementaires, le français est très
majoritaire. Étant donné que seulement le tiers des
des francophones possède une connaissance suffisante de l’allemand (et encore
moins pour le suisse alémanique) pour pouvoir
suivre une conversation, alors que les deux tiers des germanophones maîtrisent
assez bien
le français, il en résulte que le français occupe presque toute la place dans les commissions.
Afin de faire changer les choses, une vingtaine de
députés des deux langues ont accepté l’offre lancée par la direction du
Parlement pour suivre des cours linguistiques «en tandem». Cela signifie que, sous la direction d’un député-professeur bilingue, un
francophone et un germanophone s’expliquent mutuellement les objets législatifs
tout en apprenant la langue de l'autre.
5.2 Les langues de la justice
Dans les tribunaux, les autorités judiciaires compétentes pour l'ensemble
du canton emploient la langue du district concerné, soit l’allemand soit le
français. Bref, dans la partie allemande du canton, la procédure a lieu en
langue allemande, dans la partie française, en langue française. L’article
4 du
Règlement d'application de la loi d'organisation judiciaire (abrogé en 2011) précisait ainsi la procédure:
|
Article 4
[abrogé]
Langue écrite ou parlée
1) Les écritures et
interventions orales des parties ou de leurs conseils peuvent être
faites dans l'une des
deux langues nationales,
sauf devant les juges de commune et les tribunaux de police où la langue
du siège est de règle.
2) Les tribunaux de district et d'arrondissement rédigent leurs actes et
rendent leurs décisions ou jugements dans la langue du siège. Il en est de
même, en principe, pour les juges des mineurs.
3) Au Tribunal cantonal, les actes, décisions et jugements sont rédigés, en
principe, dans la langue du tribunal qui a instruit le procès.
4) Il peut être dérogé à cette règle lorsque les circonstances le
justifient, notamment pour mieux sauvegarder le droit d'être entendu d'une
partie. Lorsque l'État, des établissements ou des corporations qui en
dépendent sont en justice contre une personne privée, la langue maternelle
de celle-ci prévaut.
5) Demeurent réservées les dispositions particulières de la législation
spéciale.
|
Les citoyens sont, en principe, tenus d’employer la langue du district
concerné, mais les deux langues officielles sont néanmoins permises, «sauf
devant les juges de commune et les tribunaux de police, où la langue du siège
est de règle».
Il
existe pour l'ensemble du territoire cantonal un office central du juge
d'instruction, composé du juge d'instruction cantonal et de deux juges
d'instruction; les deux langues officielles sont représentées; c'est l'essentiel
des articles 11 et 19 de la
Loi
d'organisation judiciaire
(2000):
|
Article 11 Juge d'instruction cantonal et attributions
1) Il existe pour
l'ensemble du territoire cantonal un office central du juge
d'instruction, composé du juge d'instruction cantonal et de deux juges
d'instruction; les
deux langues officielles sont représentées.
Article 19
Conditions de représentativité
1) Les
langues,
les régions et les forces politiques doivent être équitablement
représentées au sein des autorités judiciaires cantonales, de première
et de deuxième instances, d'instruction pénale et du Ministère public.
|
Il en est ainsi à l'article 44 de la
Loi
cantonale sur le travail (2016-2025), qui autorise l'emploi
de l'allemand ou du français:
Article 39
Siège et procédure
1) Le Tribunal du travail a son siège à Sion.
2) Il tient ses séances
à Sion pour les affaires de
langue française et à Viège pour les affaires de langue allemande.
Il peut aussi décider de tenir des séances dans une autre localité du
Valais.
Article 44
Langue de la procédure
1) La procédure est conduite
dans l'une des deux langues officielles du canton
(art. 129 CPC).
2) L'Autorité de conciliation, le Tribunal du travail et la
Commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi
sur l'égalité adressent leurs communications, décisions ou jugements
dans la langue commune des parties soit l'allemand ou le français.
3) À défaut de langue commune,
c'est la langue du travailleur qui prévaut pour autant que cette langue
soit l'une des deux langues officielles. |
D'après l'article 29 de la
Loi sur l'organisation de la justice
(2009-2024), le principe de
la représentativité linguistique est obligatoire
au sein des autorités judiciaires cantonales, de première et de deuxième
instances, et du Ministère public:
|
Article 29
Exigences de représentativité
1) Les langues,
les régions et les forces politiques doivent être équitablement
représentées au sein des autorités judiciaires cantonales, de première
et de deuxième instances, et du Ministère public. |
- La procédure civile
Dans le canton du Valais, la procédure civile est
régie par le Code de procédure civile suisse et des dispositions spécifiques
au canton. Elle détermine comment faire valoir un droit en justice en cas de
litige civil, y compris les formes de saisine du juge, les délais à
respecter et les règles fondamentales applicables aux parties et aux
autorités.
L'article 129 du Code de procédure civile suisse
énonce que «la procédure est conduite dans la langue officielle du
canton dans lequel l’affaire est jugée»:
Article 129
La procédure est conduite dans la langue officielle du canton
dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent
plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la
procédure. |
Les articles 64 et 166 du
Code de procédure civile valaisan (1998) vont également dans le sens de la répartition des langues sur le
territoire:
|
Article 64
Langue
1) Les requêtes
écrites et les interventions orales des parties ou de leurs
représentants sont
faites dans l'une des deux langues officielles du canton,
sauf devant le juge de commune, où la langue du siège prévaut.
2) Le juge de
commune et le juge de district adressent leurs communications, décisions
et jugements dans la
langue du siège.
3) Le Tribunal
cantonal adresse ses communications, décisions et jugements
soit en allemand soit en
français, en principe dans la langue du juge qui a instruit
ou dans celle de l'acte introductif d'instance.
4) Le juge peut,
s'il l'estime nécessaire, ordonner la traduction des pièces qui ne sont
pas rédigées dans l'une des deux langues officielles du canton par un
expert qu'il désigne et se faire assister aux audiences d'un interprète
assermenté.
Article 166
Exigences formelles
1) Le titre est
produit en copie et en nombre d'exemplaires suffisant pour le juge et les
parties.
2) Le juge ou une
partie peut requérir la production de l'original.
3) La partie qui
administre une preuve
par un titre en langue
étrangère doit en produire une traduction
sur requête du juge ou d'une autre partie. |
L'article 84 de la
Loi
d'application du Code civil suisse (2009-2025) reprend des
dispositions similaires à l'égard des deux langues officielles:
Article 84
Langue de la procédure
1) Les écritures et les interventions orales des parties ou de
leurs mandataires
peuvent être faites en allemand ou en français.
2) La commission
adresse ses communications, décisions ou jugements dans la langue
commune des parties,
s'il s'agit de l'allemand ou du français. À défaut de langue commune, la
langue du locataire ou du fermier prévaut pour autant que cette langue
soit l'une des deux langues officielles.
Dans les autres cas, la commission décide. |
Le règlement ne dit pas que le
justiciable choisit la langue du procès, car la «langue du tribunal» est
celle du siège, c'est-à-dire du district. L'article 7 de la
Loi d'application du Code de procédure civile suisse (
2009-2025)
présente exactement les mêmes dispositions.
Article 7
Langue de la procédure
1) Les écritures et les
interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent
être faites en allemand ou en
français, sauf devant le juge de
commune où la langue du siège
prévaut.
2) Le juge de commune et le tribunal de district
adressent leurs communications, décisions et jugements
dans la langue du siège.
3) Le Tribunal cantonal adresse ses communications,
décisions ou jugements en allemand
ou en français, en principe dans
la langue utilisée
par l'autorité de première instance ou celle ressortant de
l'écriture introductive d'instance. |
- La
procédure pénale
La procédure pénale
dans le canton valaisan concerne la manière dont les infractions pénales
sont constatées, poursuivies et jugées. Elle est administrée par différentes
autorités judiciaires, telles que les tribunaux de police, les juges de
district, les tribunaux d'arrondissement et le Tribunal des mesures de
contrainte. La procédure peut être déclenchée par une plainte, et implique
la protection des victimes et des droits des prévenus.
Article 17
Langue de la procédure
1) Pour les actes de procédure comme pour les débats,
l'allemand ou le français peuvent être utilisés indifféremment.
2) Cependant, la procédure devant les tribunaux de police a lieu
en langue allemande dans le Haut-Valais
et en langue française dans le Valais
romand. |
L’article 4 du
Code de procédure pénale (1962) est également explicite à ce sujet:
|
Article 4
Langue
1) Pour les actes de procédure comme pour les débats,
on peut se servir de l'une ou
de l'autre des deux langues officielles.
2) Cependant
la procédure devant les
tribunaux de police a lieu en langue allemande dans le Haut-Valais et en
langue française dans la partie romande du canton.
3) Lorsqu'une
personne appelée à participer au procès ou fait l'objet d'une enquête
préliminaire ne comprend pas la langue dans laquelle a lieu la
procédure, le juge
nomme un interprète,
à moins qu'un juge ou le greffier ne comprenne la langue de cette
personne. L'appel de l'interprète et ses obligations sont réglés par les
dispositions applicables aux experts.
Article 136
Plaidoiries
1) Après la clôture de l'administration des preuves, le président
donne la parole au Ministère public pour son réquisitoire.
Celui-ci a lieu en langue
allemande dans la partie allemande du canton et en langue française dans
la partie romande.
Devant le tribunal cantonal, le Ministère public peut requérir dans
l'une ou l'autre des deux langues officielles.
[...] |
Dans les cours d'appel, les citoyens ont le choix entre les deux langues
officielles du canton. Lorsque toutes les parties donnent leur accord, un juge
peut autoriser l’emploi de l’autre langue officielle. Lorsqu'une partie, un
témoin ou un expert ne comprend pas la langue dans laquelle doit avoir lieu la procédure, le juge peut nommer un interprète. Comme dans le canton de
Berne, il est possible de se passer de son aide, si le juge ou le greffier
comprend l’autre langue.
L'article 25 de la
Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
(2006-2018) énonce qu'un mineur ne peut être discriminé en
raison notamment de sa langue et de sa nationalité:
| Article 25 Principes relatifs au régime de la privation de liberté
1) Le mineur privé de liberté a droit à la protection particulière due à
son âge et
à sa vulnérabilité et au respect de ses droits.
2) Il ne peut être
discriminé en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son âge,
de sa langue,
de sa nationalité, de sa religion, de ses convictions religieuses ou de
ses pratiques culturelles.
3) Il a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à sa
sécurité. La
peine vise à favoriser son insertion sociale.
4) L'exercice des droits du mineur n'est restreint que dans la mesure
requise par
la privation de liberté, par les exigences de la vie collective et par le
fonctionnement
normal de l'établissement. |
Enfin, tout acte notarié peut être rédigé en français ou en allemand, quel que
soit le district. Et les notaires ne sont pas obligés de connaître les deux
langues officielles. Voici ce qu'en dit l'article 78 de la
Loi
sur le notariat (2006-2023):
|
Article 78
Langue - Principes
1) L'acte reçu en
minute doit être rédigé en français ou en allemand (langue officielle).
2) L'acte délivré
en brevet peut être dressé dans une autre langue connue du notaire et de
la partie qui requiert son concours. |
5.3 Les langues de l'administration cantonale
Dans ses rapports avec les citoyens, l’Administration cantonale emploie
toujours la langue d'usage du district concerné: c’est donc le français dans
les districts francophones (Bas-Valais) et l’allemand dans les districts germanophones
(Haut-Valais). Les
documents écrits sont souvent rédigés dans les deux langues, mais ils ne sont
distribués qu’en allemand ou qu’en français (selon les districts); la
documentation bilingue est à peu près inexistante. La chancellerie de l'État
pourvoit toujours aux traductions des documents officiels. Par conséquent, lorsque des citoyens communiquent par écrit auprès de l’Administration,
ils doivent le faire en français dans les districts francophones et en allemand
dans les districts germanophones. Autrement dit, les écrits destinés à des
autorités ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue
officielle du district concerné.
- Le respect des langues
officielles
C'est ainsi que l'article 6 du
Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale (1997-2018)
exige de tenir compte des deux langues officielles:
|
Article 6
Langues
1) L'administration veillera au respect des principes découlant de l'égalité
entre les deux langues officielles
en adressant les communications et réponses
dans la langue du destinataire.
2) Les procédures se dérouleront en outre dans le respect du
principe de territorialité
par l'emploi de la langue en usage dans la région concernée,
au moins pour la décision. Le droit du particulier découlant de
l'article 12, alinéa 1 de la Constitution cantonale reste garanti. |
L'article 5 de la
Loi sur les services numériques des autorités (2024) exige que les
services numériques cantonaux doivent être disponibles au
moins dans les deux langues officielles :
Article 5
Principes
7) Les services numériques cantonaux doivent
être disponibles au moins dans les deux langues officielles
et pouvoir être utilisés de manière
simple et interopérable avec les moyens technologiques courants. Le
Conseil d’État peut prévoir des exceptions. |
La
Loi sur les droits politiques (2004-2022) concerne les élections,
ce qui exige également l'usage des deux langues officielles:
|
Article
57
Langue
1) Chaque citoyen peut exiger de recevoir le matériel de vote
dans l'une des deux langues
officielles du canton.
[...]
Article 107
Examen préalable
1) Toute demande d'initiative doit être signée par tous les auteurs
de l'initiative puis être annoncée à la Chancellerie d'État avant la
récolte des signatures.
2) La Chancellerie d'État vérifie que la liste à signer satisfait
aux exigences de la présente loi. Elle peut modifier le titre d'une
initiative qui induit en erreur, contient des éléments de publicité ou
prête à confusion. En cas de contestation, le Conseil d'État tranche en
dernière instance cantonale.
3) Après cet examen, le titre et le texte de l'initiative,
dans les deux langues, sont publiés au Bulletin officiel.
Le délai pour la récolte des signatures y est également mentionné.
4) La Chancellerie d'État examine la concordance des textes
dans les deux langues
et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.
Article 108
Liste des signatures
1) Outre les exigences formulées à l'article 101 de la présente loi,
la liste des signatures doit contenir:
a)
le titre et le texte de
l'initiative dans les deux langues;
|
- La naturalisation
Selon l'article 3 de la
Loi sur le droit de cité valaisan (1994-2013),
tout étranger qui demande le droit de cité communal doit
avoir des connaissances suffisantes de l'une des deux langues officielles du
canton:
Article 3
Naturalisation ordinaire des étrangers - conditions
1) Pour demander le droit de cité communal, l'étranger doit:
1. avoir son domicile
depuis trois ans dans la commune auprès de laquelle la requête est
présentée et y rester en principe domicilié durant la procédure;
2. avoir des
connaissances suffisantes d'une des deux langues officielles du
canton;
|
La loi ne précise pas que l'étranger en question devra résider
dans un district francophone ou un district germanophone s'il veut utiliser
auprès de l'Administration la langue qu'il connaît.
- L'état civil
L'article 3 de l'Ordonnance
sur l'état civil
(2007)
reconnaît que
le français et l'allemand sont les
deux langues officielles du canton, mais le registre de l'état civil est tenu en allemand
dans les arrondissements de Brig-Glis et Visp, et en français
dans les arrondissements de Sierre, Sion, Martigny et Monthey:
Article 3
Langue officielle
1)
Le français et l'allemand sont les
deux langues officielles du canton.
2) Le registre de l'état civil
est tenu en langue allemande
dans les arrondissements de Brig-Glis et Visp; il est tenu en langue française
dans les arrondissements de Sierre, Sion, Martigny et Monthey. |
- La toponymie
En matière de
toponymie, l'article 6 de la Loi sur la mensuration officielle (2006-2016) prévoit une commission pour chacune des deux langues
officielles, qui est chargée d'orthographier les
noms locaux :
Article 6
Commission de nomenclature
1) Pour
chacune des deux langues
officielles, il est institué une commission
de nomenclature chargée d'orthographier les
noms locaux.
2) Chaque commission est composée de trois à cinq membres nommés
par le Conseil d’État pour la période administrative. Le secrétariat est
assuré par l’instance de surveillance.
3) L’instance de surveillance coordonne les travaux des
commissions.
4) La commission vérifie
la conformité linguistique
des noms géographiques relevés par l’ingénieur géomètre
et transmet ses conclusions
et ses recommandations à l’instance compétente pour la détermination des
noms. |
- L'affichage
Il n'existe pas de loi ni de règlement concernant
l'affichage public ou commercial, mais l'unilinguisme territorial s'applique
de façon pragmatique. De façon générale, seules les institutions communes du
canton sont bilingues, sauf les affiches multilingues (allemand, français,
italien et anglais) dans les sites touristiques. Dans les faits, les
affiches sont unilingues françaises dans la partie romande et unilingues
allemands dans la partie germanophone. L'exemple le plus marqué représente
la «Banque cantonale du Valais» dans le Bas-Valais et la «Walliser
Kantonalbank» dans le Haut-Valais.

- Le personnel administratif
De plus, la
Loi sur
le personnel de l’État du Valais (2010-2020) veille
à une représentation équitable des deux langues officielles
et promeut le bilinguisme au sein du personnel:
Article 4
Principes de la politique du personnel
1) Le Conseil d'État définit et défend les principes de la politique
du personnel. Celle-ci est orientée mandats de prestations du service
public et besoins de ses employés, et se fonde notamment sur les
principes suivants:
i) elle
veille à une représentation équitable
des deux langues officielles
ainsi que des régions constitutionnelles;
j) elle promeut le
bilinguisme au sein du personnel;
|
Le personnel administratif n’est bilingue et n’assure les services dans
les deux langues officielles que dans l’Administration centralisée de la
capitale (Sion). Il n’existe pas de législation cantonale spécifique à cet
effet, mais de nombreuses lois prévoient un ou deux articles sur la composition
linguistique des membres dans les commissions, comités, services
administratifs, corps de police, etc. Tout citoyen du canton peut, par écrit ou
oralement, demander et recevoir des services dans la langue de son choix à l’Administration
centrale de Sion. Cependant, par défaut, l’Administration s’adressera d’elle-même
en français dans les districts francophones et en allemand dans les districts
germanophones.
L’administration cantonale comprend une trentaine de chefs
de service, dont une douzaine sont germanophones. La plupart des chefs de
service germanophones habitent dans la périphérie de la capitale, c’est-à-dire
dans la zone francophone. Les services de traduction du canton comptent à peine
deux postes officiels pour quelque 5000 fonctionnaires cantonaux. C'est pourquoi
le système fonctionne surtout de manière interne, c'est-à-dire entre les membres
du personnel où il existe des germanophones et des francophones. Il en résulte
parfois des traductions approximatives puisque certains documents dépendent de
la bonne foi de traducteurs improvisés.
L'Ordonnance de la Loi sur la
police cantonale (2017-2024) ne mentionne que peu d'exigences
précises aux candidats, sauf qu'ils devront subir des «tests de langue»:
Article 54
Examen et sélection
1) Les candidats qui satisfont aux conditions
d'admission intègrent le processus de sélection qui comprend
notamment des tests de
langues, de sport et psychométriques, des
entretiens, une évaluation psychologique et un examen médical.
2) La sélection se déroule par phases éliminatoires. |
L'Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (2007-2019)
porte sur la Commission cantonale de
recours en matière agricole, dont la composition comprend neuf membres, dont
trois de langue allemande, et de deux greffiers juristes, dont un de langue allemande, et de
deux greffiers juristes suppléants, dont un de langue allemande :
|
Article 2
Composition
1)
La commission est composée de neuf membres,
dont trois de langue allemande.
2) Elle est assistée de deux greffiers juristes,
dont un de langue allemande, et de
deux greffiers juristes suppléants, dont un de langue allemande.
Article 3
Organisation
1) Le Conseil d'État désigne le président et le vice-président pour
une période administrative. Les mandats sont renouvelables.
2) Chaque décision est prise par une cour de trois membres,
dont un greffier juriste de la
langue de traitement du dossier. |
C'est le Conseil d'État qui désigne le
président et le vice-président pour une période administrative.
5.4 Les langues de l’éducation
Le système scolaire dans le canton du Valais comprend tous
les degrés de l'enseignement, de l’école primaire aux études supérieures et en
distinguant l’école obligatoire, la formation dite secondaire II et la formation
tertiaire (les études supérieures).
La
Loi sur l'instruction publique fut une grande loi régissant l'éducation
dans le canton du Valais. Cependant, la plupart des articles ont été abrogés
au cours des dernières années, y copris ceux portant sur la langue. Une
nouvelle loi est en préparation. Néanmoins, les articles reproduits
ci-dessous de la
Loi sur l'instruction publique (1962-2021) demeurent valides; ils
concernent notamment la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire I
dans les écoles publiques pour les élèves domiciliés dans
le canton, la durée de la scolarité obligatoire, ainsi que l'enseignement
religieux:
Article 11
Gratuité de l'enseignement
1)
L'enseignement primaire et l'enseignement secondaire du premier
degré sont gratuits dans les écoles publiques pour les élèves
domiciliés dans le canton. Un règlement du Conseil d’État fixe
la subvention cantonale et les modalités de prise en charge
financière des communes.
2) L'enseignement secondaire du deuxième degré est
gratuit dans les écoles publiques pour les élèves dont le
représentant légal est domicilié dans le canton.
3) Le règlement fixe les conditions d'admission aux
écoles secondaires du deuxième degré des élèves non domiciliés
dans le canton.
Article 14
Durée de la scolarité obligatoire
1) La durée de la scolarité obligatoire est de onze ans. En
règle générale, elle comprend huit années d'école primaire et
trois années de cycle d'orientation.
Article 57
Principes
1) Les Églises sont responsables de l'enseignement religieux
et de l'animation spirituelle dans les écoles, pour les membres
de leur confession. L'État et les communes apportent leur
concours.
2) L'enseignement religieux des Églises fait partie du
plan d'études. Il est donné dans le cadre de l'horaire scolaire.
L'élève en est dispensé sur communication écrite. La signature
des parents est nécessaire pour l'élève qui n'a pas 16 ans
révolus.
3) Si une Église n'est pas en mesure d'assumer sa tâche
dans le cadre de l'école, l'État subventionne l'enseignement
religieux donné en dehors de l'horaire scolaire. |
La législation scolaire du canton du Valais semble plus souple que dans les
deux autres cantons bilingues (Fribourg et Berne), dans la mesure où elle
pourrait laisser le choix de la langue et de l’école aux parents. Dans
les faits, les enfants doivent fréquenter, sauf exceptions, les écoles de la
commune où ils résident.
- L'enseignement primaire
Dans le canton du Valais, l'enseignement primaire, qui
fait partie de la scolarité obligatoire, dure huit ans et comprend deux
cycles de quatre ans chacun. L'âge d'entrée à l'école est fixé à quatre
ans révolus au 31 juillet. Le premier cycle du primaire met l'accent sur
le développement des compétences sociales, tandis que le second cycle
introduit l'apprentissage de deux langues nationales (français ou
allemand) de l'anglais à partir du second cycle. La
Loi sur l'enseignement primaire (2013-2021) précise que «la
langue de scolarisation est le français pour la partie francophone du
canton et l'allemand pour la partie germanophone».
Article 29
Langue d'enseignement
1) La langue de scolarisation est
le
français pour la partie francophone du canton et l'allemand
pour la partie germanophone.
2) Le Département est compétent pour décider des cas
particuliers.
3) Il favorise les
échanges linguistiques et en
fixe les règles.
Article 44
But
Durant ses premières années de scolarité, l'enfant progresse
sur la voie de la socialisation et acquiert des compétences
et des stratégies inhérentes au travail scolaire, complétant
et consolidant les apprentissages fondamentaux de la langue
de scolarisation. La priorité est donnée aux méthodes et aux
domaines qu'il est particulièrement important de développer
de manière précoce et qui préparent les apprentissages
futurs.
Article 49
But
1) Le cycle 2a [du primaire] pour but de faire acquérir
à l'élève des connaissances, des capacités, des compétences,
des aptitudes, des comportements et la maîtrise des outils
fondamentaux du savoir.
2) L'apprentissage des
langues étrangères est introduit. |
Bine que l’élève soit tenu de fréquenter
l'école primaire de la commune où il réside, une autorisation à fréquenter
l'école d'une commune voisine peut être accordée à un enfant pour lui
permettre de fréquenter l'école de sa langue maternelle. La règle juridique veut
qu'un enfant fréquente l'école de son lieu de résidence. Pour les enfants dont
la langue maternelle est différente de celle du lieu de résidence, il est
possible de déroger à cette règle à la condition d'obtenir une autorisation. Par
exemple, un enfant de langue maternelle allemande peut fréquenter les écoles
enfantines (au cycle préscolaire) et primaires des villes de Sion et Sierre, qui
dispensent un enseignement dans cette langue, minoritaire dans le canton. Si
cela ne pose pas de problème au point de vue juridique et administratif, il peut
subsister des difficultés d'ordre pratique dans le transport des enfants ou la
capacité d'accueil des écoles concernées, qui sont avant tout ouvertes aux
élèves résidant à Sion et à Sierre.
Bref, l’enseignement public doit être
offert dans
la langue officielle du district: les enfants fréquentent normalement l’école
allemande dans les districts germanophones et les écoles françaises dans les
districts francophones.
- L'enseignement secondaire
Pour les personnes peu familières
avec la notion de «maturité gymnasiale», cette expression peut paraître
insolite, car elle n'a rien à voir ni avec les fruits ni avec les
exercices physiques. En Suisse, un gymnase est un
établissement d'enseignement secondaire du deuxième cycle (un lycée en
France), qui propose une formation dite «de maturité», de culture
générale ou de commerce; selon les cantons, on parle aussi de «collège»
ou de «lycée». Quant au mot maturité, il désigne un
certificat délivré à la fin des études secondaires, ce qui correspond en
France au baccalauréat, au CESS en Belgique ou au DES au Canada
français.
Le
Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité
(2009-2017) énonce que les élèves doivent
maîtriser une
langue nationale et acquérir de
bonnes connaissances dans d'autres
langues nationales et étrangères. Les disciplines fondamentales
en langues concernent :
a) la langue première: le
français pour le Valais romand et l'allemand pour le
Haut-Valais;
b) la deuxième langue: l'allemand ou le français selon la
région linguistique;
c) une troisième langue: l'anglais, l'italien ou le grec;
Pour l''option spécifique, il
faut choisir parmi les disciplines suivantes l'anglais,
l'espagnol. le grec, l'italien ou le latin. Parmi les
disciplines cantonales, il faut choisir le
latin ou l'italien-économie
(disciplines combinées) pour les collèges
francophones, le latin
ou l'italien
pour le collège germanophone.
Article 2
Objectifs des études gymnasiales
3) Les élèves maîtriseront une
langue nationale et acquerront de
bonnes connaissances dans d'autres
langues nationales et étrangères.
Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et
sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les
particularités des cultures dont
chaque langue est le vecteur.
4) Les élèves seront aptes à se situer dans le monde
naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses
dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques.
Ils se prépareront à y exercer leur responsabilité à l'égard
d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.
Article 15
Choix des options spécifiques
1) Durant le second semestre de la première année de
collège, l'élève effectue le choix de l'option spécifique.
Toutes les offres proposées lui sont accessibles moyennant, le
cas échéant, un rattrapage du programme de première année. Les
frais de rattrapage sont à la charge des élèves.
2) Dans les collèges
francophones, au terme de la
première année de collège, deux niveaux de mathématiques sont
prévus. Le cours de mathématiques fortes est réservé aux élèves
choisissant les options spécifiques (groupe de disciplines)
suivantes: physique et applications des mathématiques ainsi que
biologie et chimie.
Article 16
Limites dans le choix des options
1) Une langue étudiée
comme discipline fondamentale ne peut pas être choisie comme
option spécifique.
2) La même discipline ne peut
pas être choisie à titre d'option spécifique et d'option
complémentaire.
3) Le choix de la musique ou des
arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique,
des arts visuels ou du sport comme option complémentaire. |
Enseignement des
langues durant la scolarité obligatoire dans la partie francophone du canton
| |
Niveau |
Français |
L2 : allemand |
L3 : anglais |
|
1 |
Primaire |
7,4 |
|
|
|
2 |
Primaire |
7,4 |
|
|
|
3 |
Primaire |
8,4 |
1,8 |
|
|
4 |
Primaire |
8,4 |
1,8 |
|
|
5 |
Primaire |
8,7 |
2,4 |
|
|
6 |
Primaire |
8,7 |
2,4 |
|
|
7 |
Secondaire
I |
6 |
4 |
2 |
|
8 |
Secondaire
I |
6 |
3 |
3 |
|
9 |
Secondaire
I |
6 |
3 |
2 |
| |
Nombre
minimal de leçons par année |
|
18,4 |
7 |
| |
Nombre
minimal de leçons par année |
|
18,4 |
7 |
L2 : allemand
Début de I'enseignement de I'allemand : 3e année
L3 : anglais
Début de I'enseignement de I'anglais : 7e
année
Enseignement des
langues durant la scolarité obligatoire dans la partie germanophone du canton
| |
Niveau |
Allemand |
L2 : français |
L3 : anglais |
|
1 |
Primaire |
7,3 |
|
|
|
2 |
Primaire |
7,3 |
|
|
|
3 |
Primaire |
7,2 |
1,5 |
|
|
4 |
Primaire |
7,2 |
1,5 |
|
|
5 |
Primaire |
8,1 |
2 |
|
|
6 |
Primaire |
8,1 |
2 |
|
|
7 |
Secondaire
I |
5 |
4 |
2 |
|
8 |
Secondaire
I |
5 |
3 |
3 |
|
9 |
Secondaire
I |
5 |
3 |
2 |
| |
Nombre
minimal de leçons par année |
|
17 |
7 |
| |
Nombre
minimal de leçons par année |
|
17 |
7 |
L2 : français
Début de l'enseignement du français : 3e année
L3 : anglais
Début de l'enseignement de l'anglais : 7e
année
Après avoir réalisé en 1992 une enquête auprès de parents d'élèves
concernés par l'introduction de l'enseignement bilingue, certaines communes ont
introduit des classes bilingues. Les quatre communes valaisannes (Sierre, Sion,
Monthey et Brigue-Glis) ayant introduit des projets d'enseignement bilingue à
partir de l'école enfantine ou au degré primaire ont opté pour un
enseignement sous la forme d'immersion partielle: 50 % de l'enseignement est
donné en français, 50 % en allemand. Deux des cinq écoles de formation
professionnelle supérieure du canton du Valais proposent également un
enseignement bilingue: l’École d’ingénieurs du canton du Valais et l’École
suisse de tourisme. Dans toutes ces écoles, les professeurs d’allemand (des
germanophones) ne parlent que l’allemand avec les élèves et les professeurs
de français (des francophones) que le français. Cependant, l’élève a la
possibilité de s'adresser aux enseignants dans la langue de son choix.
- L'enseignement spécialisé
les écoles préprofessionnelles sont des
établissements du secondaire II, qui offrent une année de transition aux
jeunes sortant de l'école obligatoire, mais qui ne sont pas encore prêts à
s'orienter vers une formation professionnelle ou des études. Cette année de
cours permet de renforcer les connaissances de base des élèves (en
mathématiques, sciences expérimentales, français, allemand, anglais). L'article 14 du
Règlement des écoles préprofessionnelles (2007) précise, comme pour
toute école du secteur public, la langue d'enseignement de l'école:
Article 14
Langue d'enseignement
La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours
est considérée comme langue I. L'allemand ou le français est
obligatoirement la langue II enseignée. |
L'article 11 de l'Ordonnance
sur l'organisation de la maturité professionnelle (2014-2024) énonce
que la première et la deuxième langue
nationale sont le français et l'allemand, tandis que la troisième
langue est l'anglais:
Article 11
Objectifs, contenus et forme
1) Les branches des différents domaines ainsi que leurs
objectifs et contenus sont définis par le plan d'études
cadre fédéral.
2) Les plans d'études des filières de formation
reconnues rédigés au niveau régional et/ou par établissement
et avalisés par le département complètent le plan d'étude
cadre fédéral, mais ne peuvent déroger aux éléments édictés
par ce dernier.
3) Dans le domaine fondamental,
la première et la deuxième langue nationale sont le français
et l'allemand. La première langue, dite "langue standard",
est celle parlée dans la région où se situe l'école. La
troisième langue est l'anglais.
4) L'école organise le travail interdisciplinaire
dans les branches et le travail interdisciplinaire centré
sur un projet conformément à l'ordonnance sur la maturité
professionnelle fédérale du 24 juin 2009 et aux indications
du plan d'études cadre fédéral. Elle précise cette
organisation dans son plan d'études. |
L'article 7 du
Règlement sur l'organisation de la maturité professionnelle (1999)
reprend les mêmes exigences linguistiques:
Article 7
Admission selon les modèles homogène et additif avec examen
1) Pour les élèves qui ne remplissent pas les conditions
ci-devant, l'admission est subordonnée à la réussite d'un examen
écrit dans les trois branches suivantes:
-
français,
- allemand,
-
mathématiques.
2) Les écoles professionnelles
peuvent introduire une quatrième branche.
3) L'examen est réussi lorsque
la moyenne de toutes les notes de branches est d'au moins 4,0 et
qu'il n'y a pas plus d'une note insuffisante. La moyenne est
arrondie à une décimale près.
4) Les écoles professionnelles
sont compétentes pour organiser les examens d'admission.
5) L'élève de l'école cantonale
d'art qui ne remplit pas les conditions ci-devant peut être
admis provisoirement. Son admission définitive est subordonnée à
la réussite d'un examen écrit de
français, d'allemand et de
mathématique, subi au terme du premier semestre. |
La maturité professionnelle est basée sur la pratique
et doit permettre aux diplômés de poursuivre des études dans une haute école
spécialisée. Il existe actuellement six maturités professionnelles
différentes: technique, commerciale, artisanale, artistique, santé-sociale,
et technico-agricole. En principe, les titulaires d’une maturité
professionnelle disposent ainsi d’une double qualification: non seulement
ils ont une profession et peuvent se présenter sur le marché du travail,
mais ils ont également démontré une aptitude aux études et peuvent accéder
aux hautes écoles spécialisées sans passer d’examen.
- La Haute École
spécialisée
 |
En 1999, le Grand Conseil du
canton du Valais a créé la Haute École spécialisée Valais
(HES-SO, anciennement HEVs), un établissement de formation de
niveau universitaire au sens de la Loi fédérale sur les
hautes écoles spécialisées (HES) du 6 octobre 1995. Selon
l'article 3 de cette loi, les hautes écoles spécialisées
dispensent un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par
un diplôme et préparant à l’exercice d’activités
professionnelles qui requièrent l’application de connaissances
et de méthodes scientifiques, ainsi que, selon le domaine,
d’aptitudes créatrices et artistiques. |
Dans le Valais, la Haute École spécialisée de Suisse
occidentale, ou HES-SO Valais-Wallis, propose des formations dans
divers domaines tels que l'ingénierie, la santé, l'économie, le
travail social et l'art. Elle est composée de plusieurs hautes
écoles, dont la Haute École d'ingénierie, la Haute École de gestion,
la Haute École de santé, ainsi que l'École de design et la Haute
École d'art. D'autres domaines se sont
ajoutés: technique et technologies de l’information; architecture,
construction et planification; chimie et sciences de la vie;
agriculture et économie forestière; économie et services; design;
santé; travail social; musique, arts de la scène et autres arts;
psychologie appliquée; linguistique appliquée.
La
Loi sur la Haute École spécialisée de Suisse occidentale
Valais/Wallis (2015-2025) identifie cet établissement par le
sigle HES-SO Valais/Wallis;
l'enseignement est offert en français
et/ou en allemand, voire en anglais:
Article 3
1) L’enseignement dans les filières de la HES-SO
Valais/Wallis
est dispensé
en français et/ou en allemand.
Le Conseil d’État en fixe les modalités par voie
d’ordonnance.
2) La HES-SO Valais/Wallis encourage en
particulier
les études bilingues en français et en allemand.
3) Des cours
peuvent être
donnés dans une autre langue, notamment en anglais,
avec l’approbation de la direction générale.
4) La HES-SO Valais/Wallis offre en principe la
possibilité d’obtenir un diplôme "Bachelor" et/ou
"Master"
avec mention
"bilingue" (allemand/français)
pour toutes les filières proposées. |
Selon l'article 24 de la
Loi d'application sur la Haute École spécialisée (1999),
les langues d'enseignement
dans la HES-Valais sont en règle générale le français et/ou l'allemand,
sinon l'anglais:
Article premier
But et champ d'application
1) La présente loi organise, sous la dénomination
"Haute École spécialisée Valais" (ci-après HES-Valais),
une entité de formation de niveau universitaire au sens
de la LHES.
Article 9
Organes
1) Les organes de la HES-Valais
sont:
a) le conseil de la HES-Valais;
b) la direction générale;
c) le conseil de direction.
2) On veillera à une répartition
appropriée entre les personnes de
langue allemande et française.
Article 24
Langues d'enseignement
1) Les langues d'enseignement
dans la HES-Valais sont en règle générale
le français et/ou l'allemand.
En principe, pour favoriser le
bilinguisme, un enseignement
équilibré en français et en
allemand est dispensé.
2) Certains enseignements peuvent être donnés
dans d'autres langues, notamment
l'anglais. |
L'article 5 du
Règlement de l'École des métiers santé et social (2018) impose
l'allemand ou le français comme langue seconde obligatoire:
Article 5
Langue d'enseignement
1) La langue dans laquelle
l'école donne officiellement ses cours est considérée
comme
langue I.
2) L'autre langue
cantonale, l'allemand ou le français, est
obligatoirement la langue II enseignée.
3) Demeure réservée la situation
des classes bilingues. |
Pour les élèves de langue
étrangère, le
Règlement d'exécution de la loi sur l'enseignement spécialisé
(1987-2008) prévoit
soutien pédagogique à leur intention:
|
Article 30
Cas concernés
Un soutien pédagogique est organisé, selon les besoins,
à l'intention des élèves de langue
étrangère et des élèves dont le
milieu familial est dans l'impossibilité d'aider à surmonter le
handicap scolaire d'un élève.
Article 31
Application
1) L'application de cette mesure peut se faire en petits
groupes (trois à cinq élèves) ou individuellement, en dehors des
heures de classe, à domicile ou dans un local mis à disposition
par l'autorité scolaire communale.
2) Pour les
élèves de langue étrangère,
ce soutien peut se faire durant les heures de classe dans des
locaux prévus à cet effet.
3) Des évaluations périodiques -
en principe chaque trimestre - s'effectuent avec la
collaboration de l'enseignant titulaire et des parents.
|
En ce qui a trait aux
enseignants, le
Règlement fixant le statut du corps enseignant de l'École suisse de
tourisme (1992) impose la maîtrise de
l'une des langues officielles du canton avec de bonnes connaissances de
l'autre:
|
Article 6
Conditions
d'engagement
1) Pour être nommé membre du corps enseignant, le
candidat doit, en principe, remplir les conditions de base
suivantes:
a) avoir une
formation universitaire complète dans la(les) branche(s)
enseignée(s) ou une formation jugée équivalente;
b) pour l'enseignement des branches du domaine
touristique, être en contact étroit avec la pratique
touristique et économique;
c) posséder une solide expérience professionnelle;
d) posséder une expérience de l'enseignement ou faire
preuve d'aptitudes pédagogiques;
e)
maîtriser l'une des langues officielles du canton avec
de bonnes connaissances de l'autre;
f) être en bonne santé.
2) Le directeur et les sous-directeurs doivent en
outre démontrer de bonnes aptitudes dans l'administration et
la gestion scolaires ainsi que dans la conduite du
personnel. |
- L'apprentissage des langues
L’enseignement des langues secondes dans le canton du Valais semble plus
important que dans la plupart des autres cantons, sauf au Tessin. En 1969, le Grand Conseil valaisan exigeait
déjà l'introduction de l'enseignement de la deuxième langue (le français
pour les germanophones et l’allemand pour les francophones) dans les écoles
primaires. On appelle cela en Suisse: la «langue de proximité».
Trois ans plus tard, l'enseignement de la deuxième langue à partir
de la 3e année débutait; puis, l'enseignement de la langue seconde a été
reporté en 4e primaire. Présentement, tous les élèves à partir de 9/10 ans
suivent des cours de langue seconde (allemand ou français) dès la 4e primaire
en raison de deux heures par semaine. De la 7e à la 9e année scolaire, la
langue seconde devient une branche principale à laquelle on consacre quatre à
cinq leçons par semaine (180 à 225 minutes par semaine). À la fin de la
scolarité obligatoire, chaque élève a donc bénéficié de six ans
d'enseignement de l'allemand, respectivement du français, à raison de
centaines de leçons. Toutefois, les résultats obtenus ne correspondent pas
toujours à l'investissement consenti et un renouvellement de l'enseignement de
la langue seconde a été envisagé. Enfin, à l’âge du cycle d’orientation ou de
l’école secondaire, c’est-à-dire quand les élèves ont accompli leurs six années
de primaire et ont 12 ans, l’anglais s’ajoute respectivement à l’allemand et au
français.
En mai 2008, le canton du Valais adhérait à
l'harmonisation inter-cantonale (voir
la liste des cantons participants) en ce qui a trait à
l'enseignement des langues étrangères, pour un total de trois:
|
Article 4
Enseignement des langues
1)
La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la
5e année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7e année,
la durée des degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à
l’article 6. L’une des deux langues étrangères est une deuxième
langue nationale, et son enseignement inclut une dimension
culturelle ; l’autre est l’anglais. Les compétences attendues dans
ces deux langues au terme de l’école obligatoire sont de niveau
équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement
obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des
Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce
qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction
des deux langues étrangères.
2)
Une offre appropriée d’enseignement facultatif d’une troisième
langue nationale est proposée durant la scolarité obligatoire.
|
Tous les élèves doivent commencer
l'apprentissage d'une deuxième langue nationale et de l'anglais à
l'école primaire, au plus tard en 3e et
en 5e année scolaire (comptage basé sur
neuf années de scolarité obligatoire); en incluant dans la scolarité
obligatoire, comme prévu par l'accord
inter-cantonal de 2007 (ou concordat Harmos), deux
années obligatoires d'école enfantine ou deux années d'un cycle
élémentaire, il s'agira alors de la 5e
et de la 7e année scolaire (comptage
basé sur onze années de scolarité obligatoire). Les cantons du Tessin et
des Grisons pourront déroger à cet échelonnement dans la mesure où une
troisième langue nationale y est enseignée à titre obligatoire.
- L'enseignement
universitaire
Le canton du Valais ne dispose pas à proprement parler d’universités.
Elle sont «remplacées» par des écoles de formation supérieure telles que le Studienzentrum Brig (dépendant de l’université de Berne), l’Institut
universitaire Kurt Bösch, l’École d’ingénieurs (Sion), l’École
supérieure d’informatique de Sierre (Sierre), l’École suisse de tourisme
(Sierre), etc.
Les Valaisans qui désirent étudier à l’université doivent
fréquenter ce type d’établissement dans les autres cantons. Les francophones
choisissent généralement les université de Genève, Lausanne, Neuchâtel et
Fribourg; les germanophones fréquentent plutôt les université de Berne et de
Zurich, mais beaucoup d’entre eux privilégient Lausanne et Fribourg. En
règle générale, les étudiants disposent de bourses de l’État valaisan
leur permettant de poursuivre leurs études universitaires en dehors du canton.
5.5 Les médias
|
|
Le Valais n'a rien à envier aux autre cantons en ce qui a
trait aux médias. Dans le Bas-Valais, le journal le plus populaire est Le
Nouvelliste; dans le Haut-Valais, le Walliser Bote sert de quotidien
allemand correspondant. Les informations officielles du canton sont publiées dans
les Feuilles d'avis du Valais. D'autres journaux régionaux existent
comme Le Journal de Sierre et Le Confédéré de Martigny. La chaîne de télévision locale est
le Canal 9 et les stations de radio sont Rhône FM et Radio-Chablais pour la partie francophone
et Radio Rottu pour la partie germanophone. Évidemment, les Valaisans
ont accès à tous les journaux étrangers, en français comme en allemand, ainsi
qu'aux médias électroniques romands ou germanophones.
|

Contrairement à de nombreux pays dans le monde où
cohabitent deux ou plusieurs langues sur le territoire national, la Suisse ne
connaît pas de véritables conflits linguistiques. En pratiquant la séparation
territoriale des langues, même dans les cantons bilingues comme ceux du Valais,
de Fribourg et de Berne, la Confédération suisse a su préserver les deux
communautés linguistiques française et allemande. Dans le canton du Valais,
les francophones et les germanophones jouissent de tous les avantages d’une
majorité. Il n’y a pas de ville-frontière dans le canton à l’exemple des
communes de
Fribourg et de Bienne (Berne); les langues française et allemande sont vraiment
séparées sur le territoire cantonal. On peut affirmer aussi que les autorités
cantonales semblent se montrer plus accueillantes à l’égard de l’«autre
langue officielle». Cette attitude se manifeste surtout dans le domaine
scolaire où les frontières linguistiques ne sont pas aussi rigides qu’ailleurs
en Suisse.
Cependant, au plan national, les germanophones savent très
bien qu’ils constituent la majorité et que la Suisse est gouvernée par une
majorité massivement allemande, par des politiciens, des chefs d'entreprise,
des fonctionnaires qui pensent et ordonnent en suisse alémanique. Pour le reste, les deux
groupes linguistiques se tournent le dos avec une surprenante indifférence.
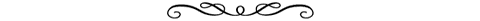
Dernière
mise à jour:
09 août, 2025
BREGY, Anne-Lore, Claudine BROHY
et Gabriela FUCHS. «Enseignement bilingue en Valais» dans Le
point sur la recherche, bulletin d’information, Neuchâtel,
Commission de coordination de recherche et Institut de recherche
et de documentation pédagogique, janvier 1998.
CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE. Le quadrilinguisme en
Suisse, présent et futur, Berne, Département fédéral de
l'Intérieur, 1989, 333 p.
DESSEMONTET, François. Le droit des langues en Suisse,
Québec, Éditeur officiel du Québec, Documentation du Conseil de
la langue française, no 15, 1984, 150 p.
FROIDEVAUX, Didier. «Contacts de langues et politiques
linguistiques», dans Les langues et leurs images, Éditions
Marinette Matthey, 1997, Neuchâtel/Lausanne, IRDP/LEP, p. 99-101.
GRIN, François et Giorgio SFREDDO. «Minority Language and
Socio-Economic Status: The Case of Italian in Switzerland» dans Cahiers
du département d'économie politique, Genève, 1996,
Université de Genève.
LANG, Jean-Bernard. «La situation linguistique de la Suisse»
dans Actes du colloque international sur l'aménagement
linguistique (Ottawa, 25-29 mai 1986), Québec, CIRB, Presses
de l'Université Laval, 1987, p. 315-327.
LECLERC, Jacques. Langue et société, Laval, Mondia Éditeur,
coll. «Synthèse«, 1992, 708 p.
LECLERC, Jacques. Recueil des législations linguistiques
dans le monde, tome III: «La France, le Luxembourg et la
Suisse», Québec, Les Presses de l'Université Laval, CIRAL,
1994, 204 p.
SALAMIN, Michel. Le Valais de 1798 à 1940,
Éditions du Manoir,
Sierre, 1978.
VOYAME, Joseph. «Le statut des langues en Suisse» dans Langue
et droit / Language and Law, Actes du Premier Congrès de
l'Institut international de droit linguistique appliqué, 27-28
avril 1988, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 343-373.
WEIBEL, Ernest. «Les cantons bilingues en Suisse» dans Langue
et droit / Language and Law, Actes du Premier Congrès de
l'Institut international de droit linguistique appliqué, 27-28
avril 1988, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 351-373.
|
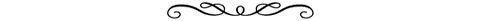
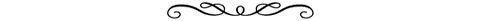
Les
États non souverains
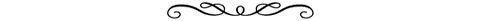
La Suisse